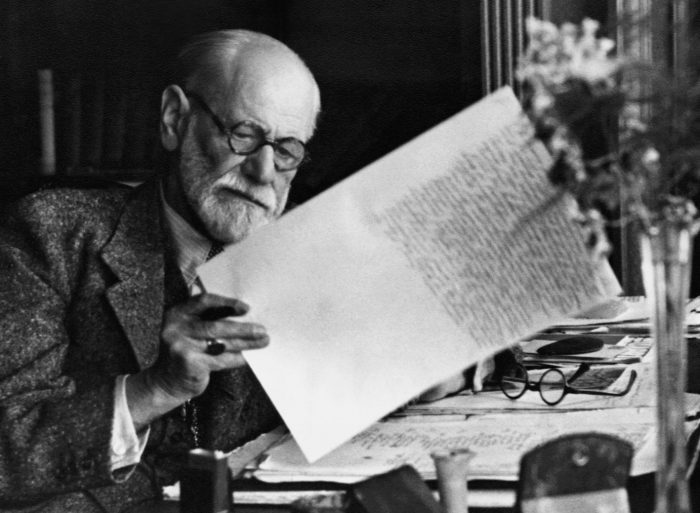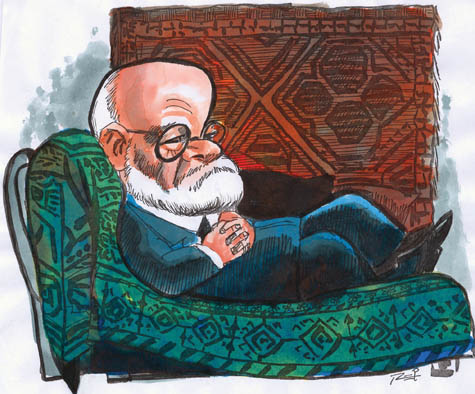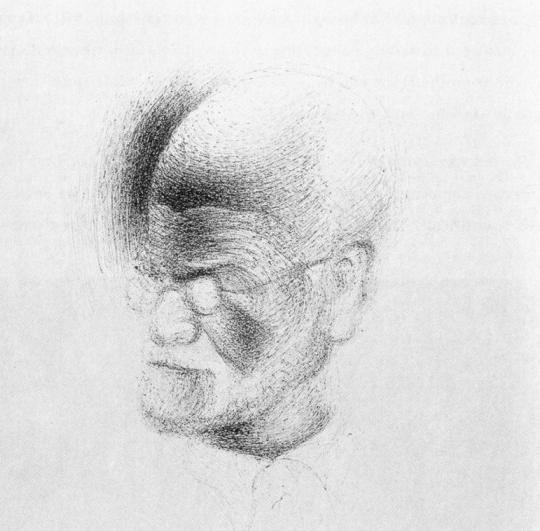Vecteur lectures freudiennes
Collectif, responsable Susanne Hommel
“Une langue entre autres n’est jamais que l’ensemble des équivoques
que son histoire y a laissé persister.” (1)
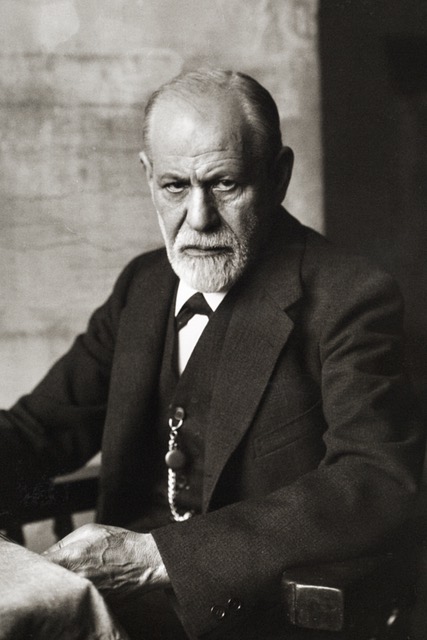 Dans Le moment de conclure Lacan écrit que l’on ne peut pas traduire, qu’on ne parle jamais d’une langue que dans une autre langue. Il nous indique la voie, son attention à transmettre l’inédit de l’événement Freud lorsqu’il le traduit : création au plus près du son, corporéité du mot et de la lettre, primauté logique. En ce sens traduire relève d’une expérience analogue à celle d’une séance analytique, faite de trouvailles, de surprises, de coupures, de pertes. Depuis 40 ans Susanne Hommel s’est attelée à cette tâche de traduire Freud et de le traduire à plusieurs(2). Au fil des groupes qui se font et se défont autour de cette tâche, un choix perdure : rester au plus près du texte freudien et faire valoir l’intraduisible.
Dans Le moment de conclure Lacan écrit que l’on ne peut pas traduire, qu’on ne parle jamais d’une langue que dans une autre langue. Il nous indique la voie, son attention à transmettre l’inédit de l’événement Freud lorsqu’il le traduit : création au plus près du son, corporéité du mot et de la lettre, primauté logique. En ce sens traduire relève d’une expérience analogue à celle d’une séance analytique, faite de trouvailles, de surprises, de coupures, de pertes. Depuis 40 ans Susanne Hommel s’est attelée à cette tâche de traduire Freud et de le traduire à plusieurs(2). Au fil des groupes qui se font et se défont autour de cette tâche, un choix perdure : rester au plus près du texte freudien et faire valoir l’intraduisible.
Chaque mois notre collectif se réunit autour d’un texte de Freud que nous avons choisi de traduire pendant l’année. Il n’est pas nécessaire de comprendre l’allemand pour participer à ce travail, éprouvant par là que traduire répond de l’incompréhensible, du passage entre les langues. Au-delà de la langue des dictionnaires, lalangue de chacun est à l’œuvre, mais aussi les langues. Lorsque nous achoppons sur un terme de Freud, nous convoquons sa traduction en hébreu, anglais, espagnol, portugais, ou telle autre langue familière à l’un d’entre nous, pour trouver là entre les langues, une solution qui nous convienne, une façon peut être de s’extraire « de l’immobilité, de la jouissance et de la soumission à un signifiant »(3). Dans ce babel on entend les choix d’une langue, ses préférences, une topologie même, prenons le français où gît la langue des Lumières, l’allemand où gît le corps et l’espace.
Il y a un enjeu politique et conceptuel à traduire Freud : proposer de traduire Einriss des Ich par fissure du Ich plutôt que par déchirure du moi, le verbe mit-teilen par faire-part plutôt que par communiquer, le verbe verlassen par laissé en plan plutôt qu’abandonner.
Mais aussi s’autoriser à jouer des équivoques et de se laisser guider par le signifiant : Ichveranderung traduit par altération pour garder la correspondance entre Anderung et alter par exemple. C’est aussi oser traduire verliebheit par amourosité, condensant amour et morosité. Nathalie Menier
(1) Lacan J., L’étourdit, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.
(2) Textes publiés : Esquisse d’une psychologie, Paris, Eres, 2011 et « Fétichisme » ainsi que de nombreux articles sur ce travail parmi lesquels : « La langue est battue, la violence dans tout travail avec la langue », Tresses n° 49, décembre 2016-janvier 2017, pp. 67-73.
(3) Ibid., p. 72.
Ces dernières années nous avons traduit sous la responsabilité de Susannne Hommel : Constructions dans l’analyse (1937), Analyse finie et analyse infinie (1937) La division du Ich dans les processus de défense (1938). Ces trois textes écrits par Freud au crépuscule de sa vie ont été publiés chez Eres en 2022 en édition bilingue sous le titre « Fin d’analyse ». Notre vecteur poursuit son travail avec les articles : « Un enfant est battu », « Complément métapsychologique à la doctrine du rêve », « Deuil et mélancolie » en vue d’une nouvelle publication, fort des enjeux cliniques et politiques à traduire Freud à la lettre.
Ce groupe de travail est ouvert à toute personne ayant le désir de traduire Freud, pour participer contacter : lectures-freudiennes@enversdeparis.org
Participants actuels : Niels Adjiman, Antonin Favaro, Christine Hyot, Michèle Laboureur, Brigitte Lehmann, Nathalie Menier.
La passe de lalangue
Conversation avec Susanne Hommel pour Horizon n°
- Horizon tient ici à célébrer la sortie d’un ouvrage issu d’une nouvelle traduction bilingue de trois derniers textes de Freud, intitulé « Freud : derniers écrits » à paraître dans la collection Scripta chez Eres, début 2022. Nous sommes heureux de vous transmettre les échos de la conversation qui a réuni : Susanne Hommel, qui dirige ce séminaire 1, Niels Adjiman, Christine Hyot, Brigitte Lehmann, Nathalie Menier, Lene Scharling et Stella Harrison pour Comment mieux témoigner des questions posées par cette entreprise qui rend tout son sel au texte freudien ?
Stella Harrison – Lire Freud, en français, lorsque j’étais étudiante m’a beaucoup ennuyée. Ce lexique sans mordant me tombait des mains, avec tous ces termes de gestion bancaire, tels que : « investissement », « conversion », « économie psychique »…Serge Cottet 2a très précisément mis l’accent sur les enjeux idéologiques de la traduction, qui convoque des questions cliniques et politiques cruciales. L’exemple qu’il choisit, de « Wo es war, soll Ich werden 3 »-, traduit par Anne Berman en 1978 par « Le moi doit déloger le ça »-,en est une pure illustration. C’est en ce sens que la parution de votre traduction et votre publication bilingue fait événement, vous redonnez leur force aux concepts freudiens.
Niels Adjiman – Une remarque : nous formons un collectif de lecture et non de traduction. Il s’agit de mettre en garde contre l’idée de justesse, qu’on toucherait l’essentiel par la traduction. C’est dans la confrontation du texte allemand avec le texte français et réciproquement que peut surgir quelque chose. J’ai toujours conçu le travail que nous faisons ici non pas comme une nouvelle traduction, mais comme un lien constamment maintenu au texte de Freud, un trajet du texte allemand au texte français et du texte français au texte allemand.
Susanne Hommel – En passant par l’hébreu, l’italien, l’espagnol, l’anglais… Nous avons toujours fait ça dans ce collectif, il y a eu des participants qui parlaient et lisaient Freud dans toutes ces langues, pour saisir quelque chose de l’os des langues, de la lalangue.
N M. – Ce passage entre les langues se renouvelle à chaque fois. À chaque tentative qui rate de traduire, c’est une nouvelle lecture, des trouvailles qui surgissent, sans chercher d’ailleurs à traduire de la belle façon. Parfois c’est plat ou alambiqué, mais c’est la trace de notre tentative de saisir la pensée freudienne.
S H. – Il ne faut surtout pas embellir la langue allemande, ne pas l’enjoliver.
Christine Hyot – C’est ça, on enlève les oripeaux pour garder quelque chose de brut, pour garder quelque chose qui soit le plus proche de la matière de la langue allemande.
Horizon – Dans l’introduction vous évoquez l’accent mis sur les sons.
S H. – De la musique de la langue également, sa matérialité dans la traduction
N M. – Pour illustrer nos choix via le son, il y a Ichveränderung par exemple, traduit jusqu’ici par « modification » ou « changement du moi ».
S H. – Pour ce terme, j’ai proposé « altération du Ich » car dans Veränderung il y a ander-, l’autre, et dans altération, on retrouve alter.
N M. – Nous faisons résonner cette idée, via le son surtout, il s’agit de garder le bout de langue contenu dans le terme allemand.
N A. – C’est exactement ce qui nous a guidés. Par exemple, Susanne a trouvé « cernage » pour le signifiant Bändigung, parce que dans Bändigung il y a Band, qui est le ruban. L’idée est qu’il s’agit de cerner la pulsion plutôt que de « dompter la pulsion », selon la traduction usuelle. Autre exemple : dans « la division du Ich dans les processus de défense », on trouve le terme Einriss que Susanne a choisi de traduire par fissure – terme que Lacan choisira d’ailleurs en une seule occurrence. Dans fissure pour Einriss on entend l’écho entre les deux termes, avec ces deux « s ».
M. –Les œuvres complètes traduisent Einriss par « déchirure du moi ».
H. –Déchirure, c’est très imaginaire, fissure évoque l’atome.
M. –Une chaîne lexicale se déploie alors, autour de diviser, séparer.
Brigitte Lehmann – Dans le dernier chapitre de Analyse finie et infinie, il y a aussi notre choix de « hérissement » pour traduire « sträuben ». Plutôt que « refus » (de la féminité), nous proposons « hérissement ». Une langue vivante respecte les sonorités, cela me fait penser aux homophonies qu’évoque Jacques-Alain Miller dans sa dernière conférence en Russie 4, où il insiste sur une lalangue vivante au plus proche de la motérialité.
M –Il y a aussi Mitteilen, traduit dans les œuvres complètes par « communiquer ». Nous avons traduit au ras du signifiant par « faire part », avec Teil qui signifie la part, et mit-, avec, le travail avec l’analysant, sur lequel insiste Freud dans son article « Constructions dans l’analyse 5».
H – Mitteilen, c’est aussi « diviser-avec », on se parle mais dans la langue on est divisé, on dit toujours autre chose, il y a l’énonciation derrière l’énoncé.
M –À propos de la traduction, Lacan parle de réduction et de perte.
Horizon – Alors, pourquoi ces trois derniers textes ?
H –Je crois qu’après avoir traduit « Esquisse d’une psychologie 6 », le premier texte de Freud, on boucle avec ces trois derniers textes, c’est comme le testament de Freud. Jacques-Alain Miller évoque ces trois derniers textes de Freud, comme ses textes conclusifs.
M –D’autres textes que nous avons traduits restent encore à paraître.
H –Oui, il s’agira d’une autre époque du travail de Freud, ceux écrits pendant la Grande guerre.
A –Dans la pratique de ce travail, il y a une chose essentielle : le fait que ce soit une lecture à haute voix. Ce n’est pas simplement arriver avec le texte allemand, qu’on a tous lu, et se demander comment chacun a traduit. On lit à haute voix et quand on lit à haute voix, il y a une appropriation du texte, le fait de passer par dire ce texte. Ce n’est pas une lecture mutique. On va entendre les signifiants prononcés, d’autant plus que nous n’avons pas, je n’ai pas de familiarité avec la langue allemande ; ce n’est pas ma langue maternelle. La lecture à haute voix me fait m’approprier le texte : on lit en allemand, on discute, on traduit.
H –À un certain moment, un participant a dit qu’il n’avait aucun accès à Freud avant ce groupe de travail, et à partir de là il a eu une ouverture à Freud qui lui était complètement interdite avant.
L –Dans la traduction, on a cherché à garder la tonalité de la langue source : la langue parlée, littéraire, poétique, le langage courant. « Penser entre les langues 7 » exige de respecter la concordance des temps.
H –En allemand, le passé simple ne s’écrit pas.
H –Un exemple, dans l’article « La division du Ich dans le processus de défense », Freud écrit : « À la vue de l’organe génital féminin, l’enfant aurait pu se persuader d’une telle possibilité, mais en ce temps-là l’enfant n’avait pas tiré cette conclusion parce que sa répugnance était trop grande et qu’il n’y avait aucun motif qui l’y forçât 8 », l’articulation des différents temps dans ce texte est cruciale.
M –En français, il existe un temps de la coupure, c’est le passé simple.
H –L’enfant veut l’entendre ou pas, c’est ça qui crée le symptôme. Il y a cette phrase extraordinaire de Freud écrite peu avant sa mort : « Cela créa une fissure qui ne guérira jamais mais qui s’agrandira avec le temps ». Cela dit : la souffrance de cette découverte, qui ne se réduit pas mais s’agrandit. C’était après la mort de son petit-fils Heinerle et de sa fille Sophie. Je vais la dire en allemand : « Ein Einriss im Ich, der nie wieder verheilen sondern sich mit der Zeit vergrössern wird 9 ».
L –Le verbe allemand vient à la fin, cela change énormément de chose, notons aussi que l’allemand confisque ainsi la possibilité de la conversation.
H –Les conversations voltigent en français ; en allemand il faut attendre que l’autre termine pour saisir le sens, donc d’une certaine façon, il n’y a pas de conversation possible en allemand.
N.A – Lisons un passage à haute voix, celui qui concerne gleichzeitig : « Le Ich de l’enfant se trouve donc au service d’une puissante revendication pulsionnelle qu’il a coutume de satisfaire, et il est soudainement effrayé par un événement qui lui apprend que la poursuite de cette satisfaction aura comme conséquence un danger réel, difficile à supporter. Il doit maintenant se décider : ou bien reconnaître le danger réel, s’incliner devant lui et renoncer à la satisfaction pulsionnelle, ou bien dénier la réalité, se faire croire qu’il n’y a pas de raison d’être effrayé, pour pouvoir rester accroché à la satisfaction. C’est donc un conflit entre la revendication de la pulsion et l’objection de la réalité. L’enfant pourtant ne fait aucun des deux, ou plutôt, il fait les deux en même temps ce qui revient au même. Il répond au conflit par deux réactions opposées, toutes deux valables et efficaces. D’une part, il récuse la réalité à l’aide de certains mécanismes et ne se laisse rien interdire, d’autre part, dans le même souffle, il reconnaît le danger de la réalité, il prend sur lui l’angoisse devant cette réalité sous la forme d’un symptôme douloureux et tentera, plus tard, de s’en défendre. Nous devons avouer que ceci est une solution très habile face à la difficulté. Les deux parties qui s’affrontent ont reçu chacune leur part ; la pulsion peut conserver sa satisfaction, la réalité a reçu comme tribut les égards qui lui sont dus. Mais il est connu que seule la mort est gratuite. La réussite a été obtenue au prix d’une fissure dans le Ich qui ne cicatrisera plus jamais, mais qui s’agrandira avec le temps. Les deux réactions opposées au conflit se maintiennent en tant que noyau d’une division du Ich 10 ».
Horizon – Est-ce que la non traduction du Ich est comparable à la non–traduction de jouissance en anglais ? Qu’est-ce que c’est que ce refus de traduire le Ich ?
H –Nous avons fait le choix d’une édition bilingue pour le lecteur. En français, quelque chose trouble, on regarde l’autre page en allemand. On peut travailler entre les deux langues, on peut rester dans cette imperfection, du côté de ce qui hérisse.
L –C’est d’ailleurs difficile à prononcer en allemand ce Ich.
A –Jacques Lacan le traduit peu. Il maintient en suspens la question de sa traduction. C’est une intrusion dans le texte français.
H –Lors de nos soirées, longues et joyeuses, on rit devant ce qui hérisse. Il y a une joie de la découverte, une avancée pour chacun de nous. En français, on est toujours appelé à embellir, un autre exemple : Wunscherfüllung, que nous traduisons par comblement 11 de vœu. Ce n’est pas la réalisation du vœu. N. M – Il y a une argumentation via les notes pour nos propositions de traduction les plus osées.
H –Il y a des gens qui sont partis à cause de cela, de ne pas coller à la belle langue.
H –Niels parlait d’une traduction « râpeuse », de ne pas aseptiser, lisser la langue au détriment de la chair des mots.
Stella Harrison – Je repense ici à Serge Cottet 12 qui insiste sur les incidences politiques, cliniques de la traduction de « Wo Es war, soll Ich werden », cette traduction orientée par l’Ego Psychology.
A –Traduit par « le Moi doit déloger le Ça », alors que Lacan traduit par « là où c’était, (le Je doit) doit Je advenir 13 », on respecte là pour le coup, la construction allemande : soll Ich, là où on aurait traduit : le Moi doit, Lacan traduit : doit Je et parfois le Ich.
H –Dans un article que j’ai écrit, je précise que Lacan a traduit cette phrase de plein de façons. En tous cas doit s’écrit avec un t et non un s, c’est le Je en tant qu’instance qui doit advenir, ce n’est pas la personne, c’est très important, les traducteurs des Œuvres complètes voulaient mettre doiS, c’est une erreur.
Horizon – Je suis contente car mon aversion première pour la traduction française classique s’éclaire ! Elle peut dans ses choix donner à certains d’entre nous une espèce de méfiance à l’égard d’une psychanalyse qui serait corrective, éducationnelle.
S H – C’est le sens de la relecture de Freud par Lacan ; la traduction de Laforgue ne lui convenait pas.
M –« Déloger le Ça », c’est un programme comportementaliste, mais ça n’a pas marché !
A –Oui, avec « communication » par exemple, pour parler du rapport de l’analyste à l’analysant, c’est très problématique, en tous cas. Ça va dans une direction qui est catastrophique. Il n’y a pas de communication entre l’analyste et l’analysant, si on traduit Mitteilen par communiquer ça oriente nécessairement le rapport et l’expérience analytique, nous avons décidé de traduire Mitteilen par « faire part ».
H –Comme je dis : partager c’est diviser-avec, une partition.
A –C’est dans la logique du propos de Freud dans son texte « Constructions dans l’analyse 14», c’est justement de ne pas communiquer.
A –Il y aussi le terme gleichzeitig toujours traduit par « simultanément », ce n’est pas tout à fait faux, mais le « en même temps » est vraiment ce qui rend compte du gleichzeitig. Dans cet article « La division du Ich dans les processus de défense », ça modifie profondément la vision du rapport du jeune garçon, du jeune enfant avec son incapacité à décider, parce qu’il fait en même temps l’un et l’autre, il ne fait pas simultanément. Il fait ça et puis ça.
H –Et c’est comme ça qu’il crée le symptôme, c’est formidable le symptôme vient quand le sujet ne décide pas.
Ce que nous voulons transmettre dans le passage de la langue allemande à la langue française c’est de transmettre vraiment ce qui est l’œuvre de Freud. Dans la traduction, mettre en acte le concept de lalangue qui contient toutes les langues indo-européennes avec leur matérialité et leur brutalité. L’effet de la langue sur le corps, Éric Laurent insiste beaucoup sur le signifiant qui mord sur le corps, sur la morsure du signifiant. C’est pour ça que Freud a inventé la psychanalyse en allemand, en allemand il y a beaucoup d’images, en morceaux de corps mais aussi des mots entiers permettent l’équivoque : Verlassen c’est quitter quelqu’un et compter sur quelqu’un, Versagen c’est refuser mais c’est aussi le lapsus ; il y a beaucoup de mots comme ça, c’est très topologique.
H –Il me semble que lorsque l’on s’intéresse à la traduction cela fait suite à un accrochage à lalangue, sans doute la rencontre d’un signifiant produisant une certaine perplexité, il s’agit de chercher, brutaliser, d’enlever les oripeaux du signifiant.
H –Oui c’est brutal pour moi, parce que c’est ma langue de naissance. Se séparer de quelque chose d’évident pour traverser, pour rendre quelque chose de la langue allemande à la langue française, nécessairement cela fait que je m’arrache quelque chose du corps c’est vraiment ça. Dans notre traduction, on est troués presque, voilà ça troue le corps, parce que ça enlève les certitudes, c’est ça la brutalité.
M –Tu évoques cela dans ton article « La langue est battue 15 », tu dis que pour traduire un poème de Thomas Bernhard 16 il a fallu t’arracher : Die Irren.
H –Oui c’est un grand poème qui s’appelle Die Irren c’est traduit « les fous » ou « les aliénés », mais ça ne me plaisait pas, je voulais quelque chose avec la matérialité de la langue, j’ai mis plusieurs jours et je me suis réveillée dans la nuit, ça a surgi, j’ai trouvé : « les errants » et c’est vraiment la traduction, en français cela dit aussi « les fous » et j’ai gardé les deux « R », c’est cela le style, l’esprit de notre traduction.
[1] Ces travaux sont issus du vecteur « Lectures freudiennes » de L’Envers de Paris, vecteur ouvert à tous et qui se réunit mensuellement https://enversdeparis.org/lectures-freudiennes/. Ce séminaire de traduction de l’Envers de Paris est animé par Susanne Hommel (plus-un) et composé actuelment de : Niels Adjiman, Christine Hyot, Michèle Laboureur, Brigitte Lehmann, Nathalie Menier, Lene Scharling.
[2] Cottet S., L’Inconscient de papa et le nôtre. Contribution à la clinique lacanienne , « Wo es war ? », Paris, Éditions Michèle, 2012, p.45
[3] Cf. Pour cette traduction et ses conséquences : Hommel S., « Wo es war », (1984), L’Histoire du sujet dans l’histoire du siècle, Tours, Soleil Carré, 1993.
[4] Miller J.-A., « L’écoute avec ou sans interprétation », Lacan Web TV, Causerie-Russie mai 2021, disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=F56PprU6Jmk
[5] Freud S., « Constructions dans l’analyse », Résultats, idées, problèmes, tome II, Paris, PUF, 1985, pp. 269-286.
[6] Freud S., Entwurf einer Psychologie, Esquisse d’une psychologie, Toulouse, Eres-Scripta, 2011.
[7] Wismann H., Penser entre les langues, Paris, Albin Michel, 2012, p. 81.
[8] Cf Freud S. « Freud, derniers écrits », Toulouse, Eres, Scripta, 2022, à paraitre.
[9] Freud S., Die Ichspaltung im Abwehrvorgang G.W XVII, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1999, p.60.
[10] Cf Freud S., « Freud, derniers écrits », Toulouse, Eres, collection Scripta, à paraitre en 2022.
[11] Claude Comté a proposé cette traduction.
[12] Cottet S. « Wo es war ? », L’inconscient de papa et le notre, op.cit.
[13] Cf. Lacan J., « La chose freudienne », Écrits, Paris, Seuil, 1 ;1966, p.416-417
[14] Freud S. « Constructions dans l’analyse », Résultats, idées, problèmes II, op.cit.
[15] Hommel S., « La langue est battue, la violence dans tout travail avec la langue », Traduire ? Interpréter ? … et après ?, Tresses n°49, ACF Aquitania, décembre 2016-janvier 2017, p.67-72.
[16] Bernhard T., « Die Irren », Sur la terre comme en enfer, Paris, La Différence Orphée, 2012, p.108, traduit par Susanne Hommel.
Nos rencontres
Une vie de désir
parNathalie Menier
Ce dimanche 22 juin après-midi, parmi les rayonnages de la librairie Tschann et les tableaux de Fred Hommel, une petite foule se pressait pour accueillir la sortie de l’ouvrage de Mickaël Guyader : Suzanne Hommel : une vie de désir
« La puissance redoutable que Freud invoque à nous réveiller du sommeil où nous la tenons assoupie, la grande Nécessité n’est nulle autre que celle qui s’exerce dans le Logos et qu’il éclaire le premier du frisant de sa découverte. »
J. Lacan, Les Écrits, Seuil, 1966, p.367
Désir de dormir et désir du rêve
Par Niels Adjiman
Si Freud s’attache dans L’Interprétation des rêves à cerner l’essence de l’activité psychique du rêve, il ne faudrait pas croire que l’œuvre princeps clôt toute réflexion sur le rêve : elle est le fondement d’un édifice qui ne cesse en réalité de se construire, auquel Freud ajoute régulièrement de nouvelles pierres.
L’AMENTIA
Le groupe Lectures Freudiennes a pu tenir une réunion de travail avant le confinement, le 4 mars. Nous avons continué l’étude du texte de Freud Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre – « Complément métapsychologique à la doctrine du rêve »...
L’AMENTIA
Le groupe Lectures Freudiennes continue son travail autour du texte de Freud « Complément métapsychologique à la Doctrine du Rêve », écrit en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Freud interroge l’amentia. De quelle façon l’épreuve de...
Comme tous les mois depuis plus de dix ans, le groupe Lectures Freudienne reprend le travail de lecture, d’analyse et de traduction des textes de Sigmund Freud notamment le texte rédigé pendant la première Guerre Mondiale, en 1916 « Compléments métapsychologique à la Doctrine du rêve ».
Vecteur Lectures Freudiennes
Nous poursuivons la lecture et la traduction du texte de Sigmund Freud Psychologische Ergänzung zur Traumlehre – Complément métapsychologique à la doctrine du rêve -, rédigé en 1916. Notre prochaine rencontre aura lieu le 6 janvier 2020 à 21 heures chez Susanne Hommel.
Lectures Freudiennes
Nous continuerons à lire, à commenter et à traduire les texte de Sigmund Freud Mmetapsychologische Ergänzung zur Traumlehre – Complément métapsychologique à la Doctrine du Rêve – rédigé par Freud en 1916, donc pendant la Première Guerre Mondiale. Nous désirons transmettre ce que Freud nous a offert, cette ouverture de l’esprit, ce qui suit la Aufklärung, Les Lumières. Goethe est mort en 1832, Freud est né en 1856… Par Susanne Hommel
Lectures Freudiennes
Ce qui est fondamental c’est de distinguer les perceptions d’un côté des représentations remémorées, qu’elles soient très intenses ou non, de l’autre. Pour combler ce trou de l’objet manquant, le sujet hallucine cet objet. Mais la satisfaction fait défaut dans le cas de l’hallucination. Alors le sujet installe ce que Freud a appelé une épreuve de réalité. En quoi consiste-t-elle ? … Par Susanne Hommel
Lectures freudiennes
Nous avons continué de lire et de traduire « Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre » – Complément métapsychologique à la doctrine du rêve -, écrit par Freud en 1916, pendant la Première Guerre Mondiale. Freud y interroge l’hallucination dans le rêve. Si le mystère de l’hallucination n’était rien d’autre que celui de la régression chaque régression intense devrait aboutir à une hallucination avec croyance en la réalité… Par Susanne Hommel