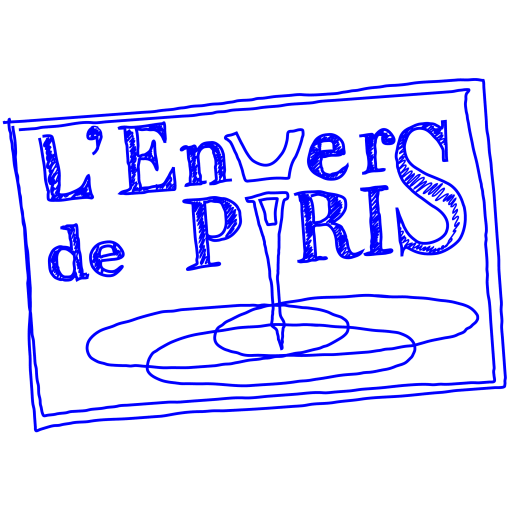Santé mentale et ordre public
Par Jacques-Alain Miller*

La santé mentale n’a pas d’autre définition que celle de l’ordre public. Pour synthétiser ce que paraissent être les suspicions, voire le dédain manifeste pour la notion de santé mentale, tel qu’il peut parfois s’exprimer depuis un point de vue analytique, je vous propose de partir de cette définition de la santé mentale en référence à l’ordre public. En effet, il n’y a pas, me semble-t-il, de critère plus évident de la perte de la santé mentale que celui qui se manifeste par la perturbation de cet ordre.
De quelques standards de la santé mentale
Les patients en santé mentale sont, d’une manière générale, sélectionnés à partir d’une perturbation de ces caractéristiques qui peuvent aller jusqu’à concerner l’ordre privé de la famille, lui-même. C’est-à-dire – et je vous prie de m’excuser si cela peut vous paraître un peu grossier – que le plus important dans la vie, par rapport à la santé mentale, c’est de bien se tenir dans la rue, et plus encore, de la traverser sans se faire renverser. La manière la plus commune que nous avons de dire cela à Paris – le sens commun a toujours raison – c’est qu’un malade en santé mentale est quelqu’un auquel on ne confierait pas son enfant pour traverser la rue. Cela me paraît être un véritable critère de santé mentale.
Ainsi, à la campagne, lorsqu’il n’y avait pas de rues et encore moins de voitures, les standards de la santé mentale étaient beaucoup plus relâchés qu’aujourd’hui dans les villes, où la circulation automobile est plus intense. Plus la circulation est intense, plus la santé mentale est exigeante. Je ne sais si cela se vérifierait par les statistiques. Nous pourrions proposer ce thème à nos amis scientifiques : la corrélation entre les standards de la santé mentale et l’état de la circulation automobile dans les villes.
Il y a aussi ceux qui ne veulent plus sortir de chez eux et nous le savons, cela dérange également l’ordre public, et ce jusque dans la sphère familiale. Qu’un adolescent reste enfermé dans sa chambre, par exemple, peut être un signe important et faire soupçonner quelque chose du point de vue de la santé mentale. Et, même s’il n’a pas de famille, celui qui ne sort jamais dans la rue dérange la concierge — personnage important de la vie citadine, tout le monde sait qu’il faut avoir de bonnes relations avec sa concierge, je plaisante bien entendu. Il n’empêche, retenons qu’avec la santé mentale, il s’agit toujours de l’usage, du bon usage, de la force.
Par ailleurs – et c’est un fait d’expérience, tiré du témoignage de ceux qui travaillent dans les institutions –, le problème fondamental en santé mentale est, semble-t-il, une question d’entrer, de sortir, et de revenir. Si ce n’était pas le cas, nous parlerions en effet de fugues. Revenir, après être sorti, est essentiel à l’ordre public. Rentrer chez soi pour dormir permet, par exemple, d’éviter le divorce. Le problème central dans la pratique de la santé mentale est donc de savoir qui l’on peut laisser sortir et qui peut sortir à condition de revenir prendre son traitement.
Ce sont les travailleurs de la santé mentale qui décident si quelqu’un peut circuler parmi les autres dans la rue, dans son pays, entre les pays ou, au contraire, s’il ne peut plus sortir de chez lui ; s’il peut sortir pour aller à l’hôpital de jour ou s’il doit rester à l’hôpital psychiatrique ; et, au bout du compte, s’il doit être attaché, car dans certains cas la dangerosité est rebelle au traitement.
C’est ainsi que les travailleurs de la santé mentale se reconnaissent proches des travailleurs de la police et de la justice. Cette proximité les offusque et ils essayent de se positionner autrement ; ce qui est tout aussi bien un aveu. Quoi qu’il en soit, la santé mentale garde comme objectif — elle ne peut en penser un autre — de réintégrer l’individu au sein de la communauté sociale.
Cela dit, nous ne pouvons nous contenter d’établir une équivalence totale entre santé mentale et ordre public. La différence entre les catégories de travailleurs montre en effet les insuffisances de cette équivalence. Il y a des perturbations qui incombent à la santé mentale et d’autres qui concernent la police ou la justice. Quel est donc le critère qui situe un individu d’un côté ou de l’autre : du côté de la santé mentale et du côté de l’ordre public ? Ce critère opérationnel, c’est la responsabilité, c’est le châtiment.
Lacan a écrit que la responsabilité, comme châtiment, est une des caractéristiques essentielles de l’idée de l’homme qui prévaut dans une société donnée. Peut-être paraît-il surprenant qu’il y ait parmi les écrits de Lacan un texte surCriminologie et psychanalyse. Lacan y accentue la responsabilité comme un concept essentiel dans la répartition entre santé mentale, ordre public et psychanalyse. La notion cruciale pour le concept de santé mentale est alors celle de la décision quant à la responsabilité de l’individu. Il s’agit de décider si quelqu’un est responsable et peut être puni ou si, au contraire, il est irresponsable et doit être traité. Il me paraît assez évident, à partir de là, que la meilleure définition d’une personne en bonne santé mentale est qu’elle peut être punie pour ses actes. C’est une définition opératoire, non idéale. Ceausescu, par exemple, n’est pas en bonne santé mentale. On ne peut donc le punir. Pourtant, quiconque le dirait paranoïaque, serait enfermé à sa place. Voilà le problème auquel je prétends faire allusion, lorsque l’incarnation du pouvoir de châtier est en position d’échapper au diagnostic de santé mentale.
Que signifie l’irresponsabilité ? Elle signifie que les autres ont le droit de décider pour vous, c’est-à-dire que le sujet cesse d’être un sujet de plein droit. Le terme « sujet » ne s’introduit pas à partir du mental, mais à partir du droit. Nous saisissons, là, l’image même du totalitarisme : c’est toujours l’autre qui décide et, dans un tel État, ce sont tous les autres qui sont fous. La preuve en est qu’ils ne peuvent pas sortir du pays.
Centrons-nous sur cette idée d’irresponsabilité. Est irresponsable celui qui ne peut rendre raison de ses actes, qui ne peut en répondre. Le mot même de responsabilité inclut celui de réponse — c’est la même racine. La responsabilité est la possibilité de répondre de soi-même. Si, pour la psychanalyse, la criminologie est tellement intéressante, c’est qu’elle pose le problème de savoir si la maladie mentale conduit à suspendre le sujet de droit.
Le psychanalyste n’est pas, comme tel, un travailleur de la santé mentale
Nous pouvons maintenant corriger notre première équivalence pour avancer que la santé mentale est une partie, une sous-catégorie, de l’ensemble de l’ordre public. Par exemple, la névrose obsessionnelle est parfaitement compatible avec l’ordre public. Elle l’est à un point tel que nous pourrions même aller jusqu’à nous demander si les inventeurs de l’ordre public n’étaient pas des névrosés obsessionnels. Un juge qui pense tout le temps à l’acte sexuel n’arrête pas pour autant d’agir comme un juge. Il peut parfaitement juger et, en même temps, n’avoir autre chose en tête que des obsessions sexuelles. La paranoïa aussi peut être parfois parfaitement compatible avec l’ordre public — plus dans certaines professions que dans d’autres. C’est uniquement d’un paranoïaque que j’ai entendu dire, dans mon cabinet, qu’il était en parfaite santé mentale. Je ne sais si quelqu’un qui n’est pas paranoïaque pourrait le dire.
Nous en arrivons ici à un point où nous pouvons prendre une position univoque sur le rapport de la psychanalyse et de la santé mentale : le psychanalyste, comme tel, n’est pas un travailleur de la santé mentale. Malgré ce qui peut être pensé ou dit pour justifier son rôle en termes d’utilité sociale, le secret de la psychanalyse c’est qu’il ne s’agit pas de santé mentale.
Le psychanalyste ne peut ni promettre, ni donner la santé mentale. Il peut seulement accueillir, saluer le patient qui vient dans son cabinet. De plus, lorsque tout marche bien, c’est lui qui reste là, enfermé, comme s’il se retirait lui-même de la circulation.
Dans la psychanalyse, bien saluer a beaucoup d’importance. On dit par exemple que la séance lacanienne, dans sa dernière période, se réduisait à un salut. Il se pourrait que l’essentiel ce soit le salut analytique. Nous pourrions opposer ce salut à la santé mentale. Je l’ai constaté dernièrement — quelqu’un que je n’avais pas bien salué m’a, peu de temps après, demandé une analyse. Le salut a donc une incidence sur la pratique, mais sans pour autant que l’on puisse immédiatement en anticiper le résultat. C’est en cela que réside la différence entre psychanalyse et santé mentale.
Poursuivons dans le sens de cette différence et interrogeons l’utilité de la psychanalyse dans la mesure où, du point de vue de l’ordre public, les gens qui s’analysent sont dits en bonne santé. La différence, et peut-être le paradoxe, réside en ceci que la psychanalyse est un traitement qui s’adresse à un sujet de droit comme tel, à un sujet de plein droit. C’est dire que notre travail s’adresse à des maladies mentales — si l’on souhaite continuer à les appeler ainsi — pour lesquelles il y a un sujet de plein droit, un sujet qui répond de ce qu’il fait et de ce qu’il dit, jusqu’au point de savoir, s’il ne peut pas le faire, que les choses ne vont pas bien. Il ne lui apparaît pas comme une bêtise de dire ou faire des choses dont il ne peut pas répondre.
Le sujet défini comme réponse. Un sujet responsable
Ceux qui s’introduisent dans l’enseignement de Lacan peuvent situer le terme sujet à partir de cette dimension de réponse, de cette capacité de réponse. Le sujet de droit pris sur ce versant de la réponse, c’est le sujet de l’énonciation — comme nous le disons en utilisant un terme de la linguistique. C’est le sujet qui répond de son énoncé, ce pourquoi il lui est nécessaire de ne pas se confondre avec cet énoncé.
Ainsi, la condition pour distinguer le sujet de l’énonciation est qu’il puisse prendre de la distance vis-à-vis de ce que lui-même énonce. C’est le sujet qui peut se rendre compte qu’il a dit quelque chose, mais qui ne sait pas pourquoi il l’a dit, ou qui n’y croit pas, ou bien qui sait que c’est une plaisanterie ou, encore, qui pense le contraire de ce qu’il dit. C’est le sujet capable de juger de ce qu’il dit et de ce qu’il fait.
À partir de la connexion entre santé mentale, ordre public, responsabilité, droit et réponse, on peut saisir l’importance, la place éminente que Freud a réservée au concept – surprenant peut-être – de sentiment de culpabilité.
Le sentiment de culpabilité, c’est proprement le pathos de la responsabilité, la pathologie essentielle du sujet. Quel est le sens de ce pathos de la responsabilité ? C’est que je me sens responsable de je ne sais quoi. On peut dire que c’est une condition préalable à la pratique analytique. Constater son existence, ou la produire, c’est d’une certaine manière l’objectif des entretiens préliminaires. Il s’agit du sentiment de culpabilité en tant qu’affect du sujet de l’inconscient. Lorsque nous constatons son existence, nous pouvons dire qu’il y a un sujet capable de répondre.
C’est à tel point que Lacan a défini le sujet, proprement dit, comme une réponse. Nous arrivons dans la psychanalyse jusqu’à cette limite de dire que le sujet lui-même est une réponse. C’est là le fondement du lien social, de ce que Freud a inventé : le point de vue psychanalytique sur la société.
Freud n’a pas défini la société par la santé mentale, mais à partir d’un mythe, et pas n’importe lequel, celui du meurtre primordial à l’origine de la Loi, celui qui dit tous coupables. C’est la réponse mythique auje me sens responsable de je ne sais quoi ; la réponse de la mort du père.
C’est ce qui permet de comprendre pourquoi Lacan conseille de laisser les canailles à l’écart de l’expérience analytique. Le sujet, en tant que canaille, c’est celui qui s’invente des excuses pour tout. C’est ce qui permet également de voir ce que Lacan détachait dans les entretiens préliminaires : la rectification subjective préalable à l’analyse. Le sujet entre en analyse en se plaignant des autres, et cette rectification – l’analyse de Dora en est l’exemple classique – l’amène à percevoir qu’il a quelque chose à voir avec ce dont il se plaint, c’est-à-dire qu’il s’agit aussi de sa faute. En effet, bien que des phénomènes superficiels puissent apparaître d’évidence dans l’expérience, nous savons que le sujet de l’inconscient est toujours un accusé, et c’est pour le démontrer que Freud a inventé le surmoi.
Ne pas reculer devant la psychose est une phrase de Lacan que l’on répète partout, aussi bien au Brésil qu’en Europe ou au Canada. Il ne faut pas reculer devant la psychose, mais avec des exceptions. Nous pourrions en discuter à propos de l’analyse des paranoïaques, car celle-ci présente des difficultés techniques difficiles à surmonter. Celui que nous appelons un paranoïaque est précisément dans la position subjective de l’accusateur, non de l’accusé. Il est persécuté, mais par la faute des autres.
D’autre part, le pervers, le vrai pervers — celui qui présente des comportements que l’on appelle pervers selon la classification psychiatrique — ne demande pas une analyse. Et si par erreur il le fait, il s’en va. Toutefois, s’il avait un quelconque sentiment de culpabilité à propos de son comportement, s’il arrêtait de s’inventer des excuses pour ce qu’il ne peut éviter de faire, le pervers pourrait faire une analyse. La présence de l’affect subjectif de culpabilité a un caractère décisif pour ce qui est de la possibilité de les analyser. Et ceci, même si l’expérience donne plutôt à penser, contrairement au portrait que l’on fait d’eux, que les pervers sont des personnes d’un haut sens moral.
La pulsion, mythe freudien ; le désir, mythe lacanien
Parler à propos du pervers de ce que quelqu’un ne peut pas arrêter de faire, nous permet de justifier le concept de pulsion en psychanalyse. Qu’appelons-nous pulsion ? Nous parlons de pulsion – un autre des mythes freudiens – lorsque les choses se présentent dans cette dimension de « ne pas pouvoir arrêter de les faire ». Le problème, dans ce cas, est alors de savoir s’il y a ou non un sujet de droit. Lacan a pu dire que la pulsion est acéphale et que, par là même, il y a une certaine suspension du sujet de droit.
Si nous parlons de la position subjective dans la pulsion, nous disons alors qu’il s’agit de la relation du sujet avec une demande contre laquelle il ne peut pas se défendre. En ce sens, il y a une connexion entre la pulsion et le surmoi — notons que le mot défense comprend lui aussi une dimension juridique.
Cette perspective que je vous propose permet de localiser l’articulation entre pulsion et désir : la pulsion comme mythe freudien et le désir comme mythe lacanien. Comment les différencier, si ce n’est dans le fait que nous parlons de pulsion quand le sujet se plaint de ne pas pouvoir s’en défendre et de désir quand il se plaint de s’en défendre trop bien ? Précisément, la différence est dans la défense. La défense est interne à la dynamique propre du désir, en ceci que désirer et rejeter le désir sont liés et se font dans le même mouvement. Nous parlons au contraire de pulsion lorsque la fonction subjective est incapable d’introduire la défense.
Mais il peut sembler que ce n’est pas encore ça le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité a aussi des défauts. Dans le deuil pathologique, par exemple, quand le sujet est écrasé par la culpabilité de la perte ; ou dans la mélancolie, à propos de laquelle il y a toujours un malaise, des résistances à la décrire dans le champ même de la psychose, car la présence du sentiment de culpabilité suppose une difficulté. Au contraire, dans le cas du président Schreber, les choses sont claires : le coupable du début jusqu’à la fin, c’est Dieu. C’est lui qui devrait avoir un sentiment de culpabilité pour perturber, non seulement l’ordre public, mais le monde entier. Ce n’est plus exactement la circulation automobile ici, c’est la circulation des astres dans le ciel.
Ainsi, dans l’expérience psychanalytique, le sentiment de culpabilité n’empêche pas la revendication. Au contraire, il la favorise. Il faut saisir la connexion qu’il y a entre culpabilité et revendication, là où elles peuvent paraître s’opposer. Seul un sujet de droit, un sujet qui peut dire j’ai le droit à, peut avoir un sentiment de culpabilité. Et ce j’ai le droit à est le principe même de la revendication. Si l’on pense que la revendication n’est pas quelque chose d’essentiel à la pratique analytique, c’est que l’on ne se rend pas compte de ce que la castration n’a de sens que sur fond de revendication. C’est pour cela que l’état de droit est indispensable à la psychanalyse. L’un ne peut exister sans l’autre. Et, si ce n’était pas le cas, on aurait affaire à une psychanalyse clandestine, comme nous l’expliquait récemment Jean-Pierre Klotz à son retour d’Union Soviétique. Au fur et à mesure en effet que ce grand pays se transforme en un état de droit, la psychanalyse peut y entrer. Notons cette connexion : la psychanalyse et les droits de l’homme vont de pair, sont dans le même temps. Il faut avoir le droit de se taire. Il ne peut pas y avoir de psychanalyse là où existe seulement le droit de parler, et plus encore, le devoir de parler.
Santé mentale et formation des analystes
Il est nécessaire que l’analyste, pour sa propre santé mentale, ait été guéri du sentiment de culpabilité. Autrement, ce serait dangereux de s’adresser à un analyste. Guérir du sentiment de culpabilité pourrait être une réponse à la question de la formation des analystes. Mais cette réponse pourrait elle aussi s’avérer dangereuse dans la mesure où elle rapproche la formation des analystes de la formation des canailles. Il nous faut donc distinguer : il faut guérir les analystes du sentiment de culpabilité en tant qu’ils dirigent la cure et, en même temps – et c’est le plus difficile –, ne pas les en guérir en tant que sujets. Nous avons entendu Lacan se plaindre, dans son Séminaire, de l’exigence de son surmoi. Nous devons penser qu’il devait payer ses dettes, se faire pardonner de nous avoir ouvert les portes de la psychanalyse et qu’il a payé par un travail théorique.
La réaction thérapeutique négative, selon l’expression freudienne que je ne trouve pas très heureuse, a comme objectif de faire passer la culpabilité à l’analyste – Vous ne pouvez pas me guérir –, c’est-à-dire qu’elle déplace la faute sur l’Autre. La castration, impensable dans le pur réel, n’a de sens que pour le sujet de droit, pour celui qui peut dire j’ai le droit à. C’est ce qui constituait, pour Freud, le roc de l’expérience analytique.
Pour l’expliquer en termes de marché, c’est comme si un sujet avait un chèque au porteur qu’il ne peut encaisser. Ce chèque au porteur, c’est ce qu’on appelle le phallus et même, plus précisément, le phallus en tant que symbole, le fondement même de la plainte en psychanalyse — J’ai droit à quelque chose que je ne peux pas encaisser. Le sujet vient toujours à l’analyse pour encaisser, et le psychanalyste est le caissier — Expliquez-moi quel chèque au porteur vous avez. Le résultat, c’est qu’à la fin c’est celui qui venait encaisser qui finit par payer et, cela, pour la seule raison d’avoir présenté le chèque et de n’avoir d’autre possibilité que d’en parler. C’est en cela que la psychanalyse peut paraître une escroquerie et que l’on peut douter de ce que nous ayons une santé mentale suffisante pour jouer à ce jeu.
Le concept freudien de castration serait impensable s’il ne s’agissait pas d’un droit au phallus, aussi bien dans le cas d’un homme que d’une femme d’ailleurs. C’est même plus difficile pour l’homme, du fait qu’il est porteur de l’organe. Nous savons — c’est l’autre secret de la psychanalyse, un secret de Polichinelle — que le chèque ne rentrera jamais en caisse, parce que la caisse est toujours de l’autre côté. C’est ça la castration imaginaire : malgré le fait de détenir le chèque, le porteur a toujours la bourse vide.
La vérité est que ce chèque a des caractéristiques telles que, pour l’encaisser, il n’y a pas d’autre solution à l’horizon que d’occuper la place de l’analyste, c’est-à-dire de se transformer en caissier. Dans ce sens, les analystes sont lesdesesperados du chèque au porteur, ceux qui ont abandonné l’idée de l’encaisser avec le résultat paradoxal qu’ils ont la bourse pleine.
Cela met en évidence que le sujet de la castration est le sujet de droit, celui qui doit découvrir que son chèque au porteur — celui que chacun possède — est impossible à encaisser. Il lui faut parfois essayer avec plusieurs analystes, pour être sûr qu’aucun ne va le lui payer. Mais, comme sujet de droit, il est aussi sujet de devoir, c’est-à-dire qu’il obéit à l’ordre :Tu dois encaisser. Et, Tu dois encaisser se traduit en termes de jouissance, il s’agit d’encaisser de la jouissance. Ce qui se découvre, c’est qu’en présentant le chèque, on en jouit déjà suffisamment, on en jouit en le présentant avec des mots.
Mens sana versus inconscient
Ce qui est en jeu par contre dans la santé mentale, et qui peut nous porter à rire, est de l’ordre de la perturbation structurale du physique, du mental et du social. Comme nous l’a rappelé Hebe Tizio, avec la définition de l’OMS, il s’agit d’être complets dans le physique, le mental et le social. C’est la voix douce de l’impératif impossible, une formule du surmoi moderne, très bien décrit, puisque sont présents les trois termes — physique, mental et social.
Le mental est un organe, qui n’est pas réservé à l’humanité. Il y a du mental chez un être vivant dès le moment où il y a des sens, un appareil sensoriel. Les animaux ont aussi un esprit, qui complète nécessairement le physique de l’être vivant. Cet esprit — voir, penser, se souvenir — leur permet de vivre dans leur milieu, le mental est un organe nécessaire pour l’adéquation du physique au monde.
On en sait beaucoup plus maintenant sur l’esprit en tant qu’organe, depuis que la biochimie du cerveau s’est développée. Le comportementalisme permet de prouver que chez les rats et les pigeons, le mental est un organe utile pour la vie, un guide de vie. Le rat fait partie d’un tout. C’est en quoi Lacan pouvait dire que l’organisme va bien au-delà des limites du corps individuel. L’organisme comprend le mental et le physique – soit l’organisme à proprement parler – plus son monde.
Pourrait-on penser un être vivant sans mental ? Un être vivant qui s’orienterait sur un pur réel ? C’est, en un certain sens, ce que Freud nous présente avec la libido. Le mythe que construit Lacan, à propos de la libido freudienne, c’est celui d’un être vivant sans appareil sensoriel, qui ne connaît rien de la dimension du monde et qui est de l’ordre du pur réel. Avec le nom lacanien de jouissance, il s’agit de quelque chose qui ne veut rien savoir. C’est aussi la question de la pulsion, elle ne veut rien savoir ! Qu’est-ce que l’on cherche dans le savoir ? La libido mythique, mythifiée par Lacan, ne veut rien savoir.
L’animal, comme il a un esprit, ne se dirige pas sur le pur réel, mais il fait du réel une réalité. La différence entre le réel et la réalité, c’est l’interposition du mental. On peut parfaitement décrire, de cette façon, le monde de la mouche. Lacan nous en donne une description telle que l’on a envie d’être cette mouche, tant elle possède une santé mentale parfaite, si nous définissons cette santé comme l’harmonie, l’équilibre de l’Innenwelt et de l’Umwelt.
Mais l’homme aborde le monde par le social et le langage perturbe fondamentalement l’adéquation de l’Innenwelt à l’Umwelt. C’est dire que la maladie mentale est en nous dès le départ. Notre modèle de santé mentale n’est pas celui de l’animal. À notre époque, le meilleur exemple de la santé mentale serait plutôt la machine. C’est pour ça que l’on peut dire de quelqu’un qu’il a disjoncté.
Notre milieu n’a rien de naturel, sinon qu’il est structuré par le langage et rempli de droits et de devoirs. Freud avait déjà indiqué que notre esprit est perturbé par le narcissisme, qui constitue un obstacle fondamental à l’adéquation, qui est le principe et la conséquence même de cette perturbation sur le mental. Nous connaissons son rôle dans l’inhibition, par exemple.
Cependant, chez l’homme, dans l’humanité, tout ce qui n’est pas physique n’est pas pour autant mental. Il y a quelque chose qui n’est pas mental, même s’il le paraît. C’est la pensée nommée par Freud l’inconscient. L’inconscient n’est pas de l’ordre du mental et doit être distingué de lamens — mens sana in corpore sano. Ce qui empêche la mens saine et le corps sain, c’est l’existence dysharmonique d’une pensée.
Quelle est la définition la plus classique de la santé ? La santé se définit par le silence des organes. Mais il y a l’inconscient qui, lui, ne se tait jamais et qui donc n’aide en rien à l’harmonie. Ainsi définie, la santé mentale ne peut nous servir de critère dans la pratique analytique.
La discussion
Revendication et sentiment de culpabilité
Q— J’aimerais que vous précisiez la relation entre revendication et sentiment de culpabilité que vous faites équivaloir, ainsi que le lien qui pourrait être fait avec des positions du sujet rencontrées en clinique quant à la culpabilité et la faute.
Jaques-Alain Miller — J’utilise le terme « revendication » qui est le côté positif, actif, de la frustration, parce qu’il permet de décrire des phénomènes que l’on met en évidence dans la pratique. Par exemple, quand ce que Freud a appelé le roc de la castration prend la forme de la revendication de justice, on pourrait penser que c’est le sentiment de culpabilité qui empêche le sujet d’assumer le poids de ce qui ne va pas bien. Et, d’une certaine manière, avec la rectification subjective, il s’agirait qu’il l’assume, ce poids. Mais, il pourrait aussi arriver, au contraire, que le sujet rende l’analyste responsable de ne pas obtenir satisfaction, pensant encore qu’il y a droit. Ce qui se transforme en un blocage de l’expérience.
Il faut souligner également le droit à la jouissance dans l’expérience. Le point de vue que nous avons adopté à partir de la santé mentale accentue, pour le dire ainsi, la dimension juridique. Mais, du point de vue de sa justification, il faudrait expliquer pourquoi le sentiment de culpabilité dont nous parlons est inconscient, pourquoi il peut se manifester dans ce qu’est, selon Freud, le roc même. Ces remarques amènent la nécessité de mieux articuler le sentiment de culpabilité et le complexe de castration.
Le pervers et l’analyse
Q— Concernant ce que vous avez dit du pervers qui vient à l’analyse pour être déculpabilisé de ce qu’il ne peut pas arrêter de faire, vient-il se déculpabiliser ou vient-il pour qu’on le déculpabilise ? Sa position est problématique en raison de cette déculpabilisation que, selon moi, il viendrait chercher.
JAM— Je crois avoir utilisé l’expression « s’inventer des excuses ». Je ne pense pas que l’on puisse donner une réponse unique à ce que cherche le pervers. Par exemple, que cherche-t-il dans le savoir, dans les œuvres de la culture ? L’on sait la part éminente qui fut celle des homosexuels dans la culture. Nous devons penser que la jouissance obtenue, en obéissant à la pulsion, est suivie pour lui d’une insatisfaction ; c’est-à-dire qu’il s’agit aussi de ce que la jouissance ne soit pas, dans son cas, complètement acéphale. Malgré les comportements pervers, l’analyste pourrait se maintenir si, en quelque endroit, sur le plan même de la jouissance – que le pervers sait bien mieux obtenir que le névrosé –, il y a une défense.
Comme le disait Gide, « il y a plusieurs homosexualités ». Nous parlons de manière grossière de l’homosexualité quand l’objet est du même sexe, mais les pratiques homosexuelles sont suffisamment diverses pour localiser en elles les stigmates de la défense contre la jouissance.
André Gide aimait les garçons jeunes, à la barbe peu fournie. Sa pratique homosexuelle consistait en des masturbations mutuelles. Il avait horreur de la pénétration. Pratique à laquelle pourtant il assistait parfois avec Lord Douglass, l’amant d’Oscar Wilde. Ce en quoi il aurait peut-être été analysable ? Il avait lui-même consulté un psychiatre avant et après son mariage — il pensait que le mariage pourrait le guérir — et était parvenu à débuter une analyse qui ne dura pas longtemps. Mais on peut se demander, à suivre le parcours de sa production littéraire, année après année, si celle-ci ne constituait pas pour lui une cure par écrit.
Malgré le démenti, malgré la dénégation de la castration, dans l’obtention même de la jouissance, il y a une place pour la défense. Je ne pense pas que, dans le cas des pervers, il s’agisse d’obtenir la « normalisation » de la vie sexuelle. Dans ce cas, comme dans d’autres, il s’agit de trouver le désir du sujet qui, occasionnellement, peut être « dysharmonique » avec sa jouissance. Cela dit, nous ne sommes pas pour autant les gardiens de l’ordre public. S’il est passionnant de suivre les faits cliniques, il se peut –une fois isolé l’acte vers lequel le sujet tend, localisées les rencontres infantiles qui marquèrent pour toujours, pour toute une vie, son mode d’obtention de jouissance –, il se peut que le travail analytique s’arrête et que le sujet pervers continue à rechercher ces mêmes situations.
Paranoïa et ordre public
Q— Vous avez affirmé que la paranoïa était compatible avec l’ordre public, ce qui pourrait, selon moi, changer le traitement possible des psychoses. Je m’interroge aussi sur le paradoxe qu’il y a – par le fait même de la castration – de dire que le psychotique est l’homme libre de ce chèque au porteur, en même temps qu’il est un sujet divisé par le langage, car le psychotique parle.
JAM— J’ai parlé du paranoïaque car il est, dans la psychose, celui qui se présente comme un sujet de plein droit. Il se présente pour demander justice ou pour la faire. En ce sens, il est créateur d’ordre public, un inventeur de nouveaux ordres. La paranoïa met en évidence une connexion étroite entre le lien social et le semblable. De fait, il y a beaucoup de choses dans la culture que nous devons à de grands paranoïaques. Le paranoïaque est à tel point sujet de droit qu’il semble s’exclure de la psychanalyse ; de plus, son droit est un droit sans culpabilité.
Psychanalyse et santé mentale
Q— J’ai aimé la métaphore de la rue et de la maison… Peut-être doit-on marquer quelques limites entre la théorie et la pratique en raison de la confusion entre pratique et exercice d’un savoir ?
JAM— Aujourd’hui, beaucoup de pratiques peuvent s’inclure dans le champ de la santé mentale en tant qu’elles s’adressent à l’harmonie du mental et du physique. De plus, « santé mentale » a ce poids de nommer le lieu où travaillent un grand nombre de praticiens. Mais, en raison de sa propre structure, la psychanalyse n’appartient pas à cette catégorie. La psychanalyse ajoute au mental et au physique, la pensée. Plus précisément, elle ajoute la pensée inconsciente, qui n’est ni du mental ni du physique, mais qui a l’efficacité de les mettre en désordre.
Dans ce sens, Lacan et Freud sont sur la même ligne que les philosophes et écrivains du XIXe siècle, qui privilégièrent la psychanalyse pour avoir révélé que l’homme comme tel est un malade. C’est une généralisation, mais cette phrase se rencontre aussi bien chez Hegel que chez Nietzche et fait partie de tout ce qui prépare et accompagne la découverte freudienne. C’est ce qui a permis à la psychanalyse de prendre son orientation, car s’il en est ainsi, si l’homme est un animal malade, notre tâche est de le guérir.
Aux États-Unis, ils n’ont aucune difficulté pour inclure le psychanalyste dans les pratiques de santé mentale. Mais, en Europe, bien que notre position ne soit pas de simple exclusion, la dialectique complexe que nous entretenons avec la santé mentale – qui en pratique n’est pas très opérative – ne permet pas une discrimination qui aille bien au-delà de savoir si l’on peut ou non traverser une rue avec un enfant.
*Conférence prononcée en clôture des IIIes Journées du Champ freudien à Séville en 1988. Publiée dans Uno por uno n°36 de juillet-septembre 1993, dans Mental nº 3 de janvier 1997, et dans une publication de l’ICF et l’université de Grenade en 2010. Traduction de l’espagnol reprise pour PIPOL NEWS par Guy Briole en janvier 2011, relue par Monique Kusnierek.