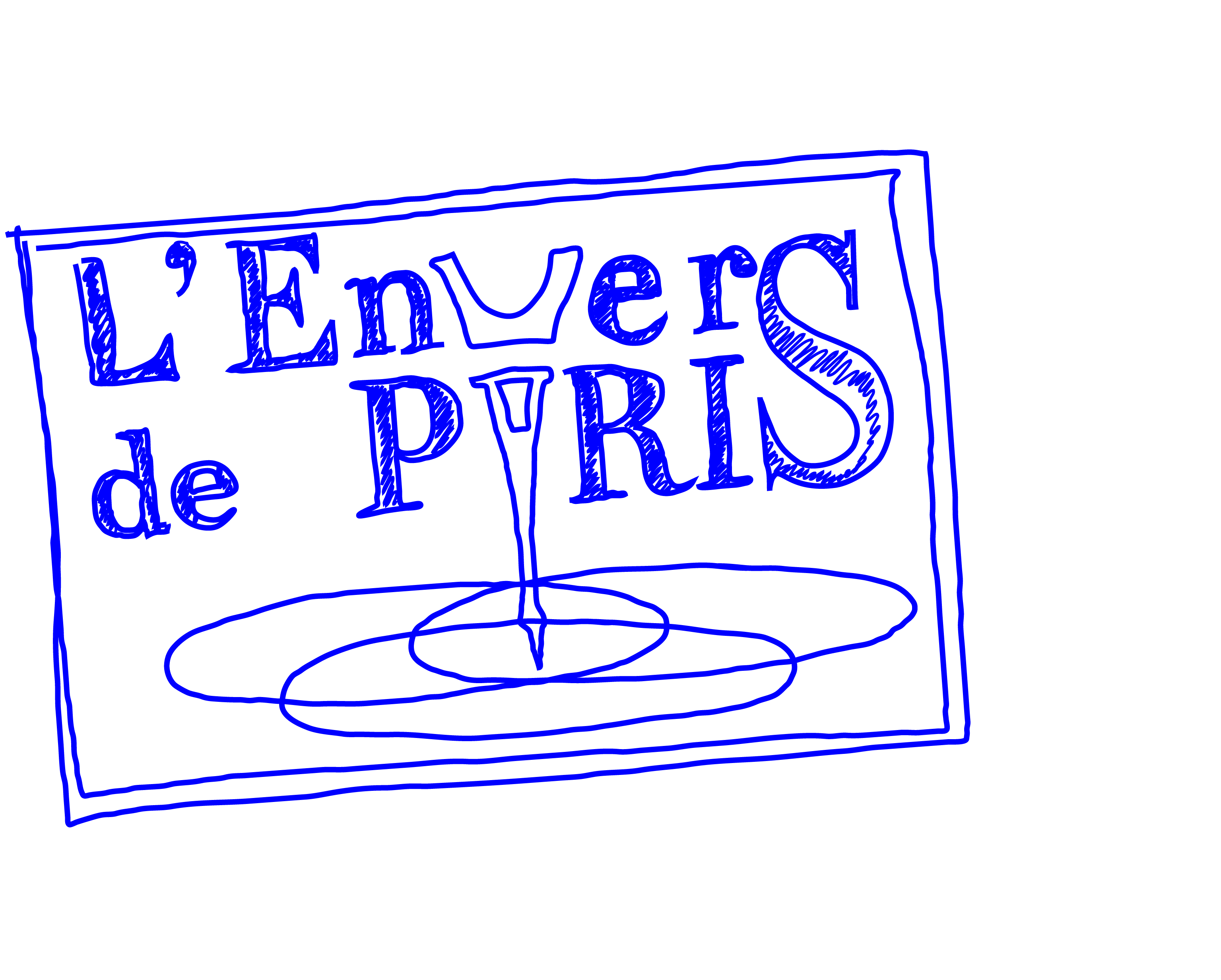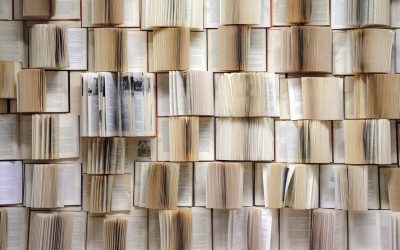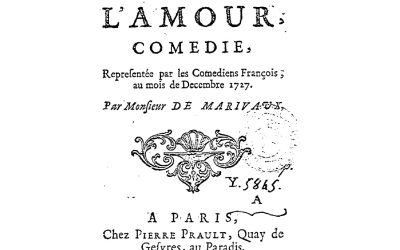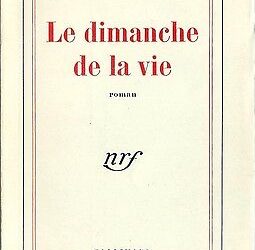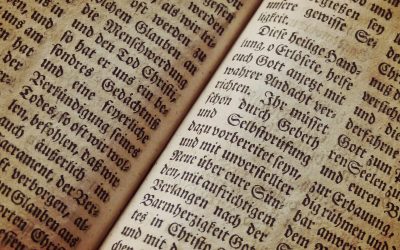Littérature et psychanalyse
Vecteur, responsable Marie-Christine Baillehache
« Ce qui parle à notre cœur-enfant est ce qu’il y a de plus profond.
J’essaie d’aller par là. J’essaie seulement. »
Christian Bobin1
C’est avec assiduité, sérieux et enthousiasme que durant l’année 2019-2020, les six membres du vecteur Psychanalyse et Littérature se sont réunis mensuellement pour approfondir et préciser la fonction de la Lettre et son pouvoir inouï de création. Les romans, les poèmes, le travail calligraphique de François Cheng et son dialogue soutenu avec Lacan ont été riches d’enseignement sur le savoir faire de cet écrivain avec le mystère du corps jouissant dont le sujet ne peut se passer pour habiter sa propre langue et lui donner vie. Plus que dans l’Autre du sens, c’est dans la motérialité de la lettre – le son, le ton, le rythme, le silence, le suspens des mots et des phrases – que F. Cheng trouve « cette ivresse de re-nommer les choses à neuf, comme au matin du monde »2.
C’est par son travail incessant de la lettre que l’écrivain s’assure de son traitement singulier de la jouissance de son objet a par le signifiant. C’est par l’introduction de l’énonciation de son propre dire dans son écriture qu’il la diversifie, l’ouvre, la fragmente et l’invente.
Durant cette année 2020-2021, notre vecteur travaillera à démontrer comment Pascal Quignard, Christian Bobin, Nathalie Sarraute, par leur écriture de la lettre qui touche au réel de leur jouissance la plus intime et la plus singulière, s’opposent radicalement à « la société des consommateurs [qui] prend son sens de ceci, qu’à ce qui en fait l’élément entre guillemets qu’on qualifie d’humain, est donné l’équivalent homogène de n’importe quel plus-de-jouir qui est le produit de notre industrie, un plus-de-jouir en toc pour tout dire. »3
Comme chaque année, le désir de savoir et le transfert à l’École de Lacan orienteront et animeront les lectures et les productions écrites de chacun.
Pour se joindre à nous : Marie-Christine Baillehache> 06 43 37 04 97.
- Bobin C., Un bruit de balançoire, Paris, L’iconoclaste, 2017, p. 6.
- Cheng F., Le Dialogue, Desclée de Brouwer, 2002, p. 38-39.
- Lacan J., Séminaire XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 92-93.
Nos rencontres précédentes
Annie Ernaux, Une femme à la recherche d’une vérité perdue.
Annie Ernaux, Une femme à la recherche d’une vérité perdue.
par Valérie Chevassus-Marchionni
Quand la douleur s’écrit, pas sans la honte.
Quand la douleur s’écrit, pas sans la honte.
par Rosana Montani-Sedoud
Annie Ernaux : Le rendez-vous de l’objet
Alain Françon et La Seconde surprise de l’amour, de Marivaux
par Bernadette Colombel
Alain Françon et La Seconde surprise de l’amour, de Marivaux
Alain Françon et La Seconde surprise de l’amour, de Marivaux
par Bernadette Colombel
La dérision du Dimanche de la vie
La dérision du Dimanche de la vie
par Marie-Christine Baillehache
Zazie, un plus de vie !
Par Gabrielle Vivier
Lacan s’appuie sur la linguistique saussurienne moderne qui a démontré qu’un signifiant, S1, ne peut se soutenir que du renvoi à un autre signifiant, S2. Il met en évidence que cette structure différentielle, qu’il nommera le grand Autre, préexiste au sujet et le détermine.
Zazie, le réveil !
Par Philippe Doucet
La phrase de Roland Barthes sur le roman Zazie dans le métro : « Par sa clausule irrespectueuse, Zazie […] possède la littérature (au sens argotique) exactement comme la Littérature possède le réel qu’elle chante » , indique bien dans quelle tension Raymond Queneau place son usage de la Littérature.
Le savoir de Zazie
Par Rosana Montani
Raymond Queneau est un auteur présent dans le premier enseignement structuraliste de Jacques Lacan. Lacan et Queneau se sont rencontrés à maintes reprises, notamment entre les années 1927 et 1939, tant dans le groupe des surréalistes qu’aux cours d’Alexandre Kojève sur Hegel.
La lettre, tou-jours…
Par Gabrielle Vivier
Avec « Lituraterre » , Lacan établit la lettre comme littoral entre les deux registres radicalement hétérogènes du savoir et de la jouissance. Elle est illisible et « se décompose en une face signifiante et une face réelle, en S1 en tant qu’il fait trou dans le savoir et que a le comble ». D’un côté, la lettre borde le trou de l’Autre du savoir et, d’un autre côté, elle invoque l’objet a sans pour autant en résorber l’énigme. Son usage non seulement fait équivoquer le langage mais également produit un effet de jouissance de a.
Taka l’Dire. Quand l’écriture résonne
Par Isabelle Otechar et Marie-Christine Baillehache
Nathalie Sarraute travaille le langage avec le goût de la langue. Dans son livre Ouvrez, elle met ce goût à l’œuvre dans un roman où les personnages sont les mots eux-mêmes.