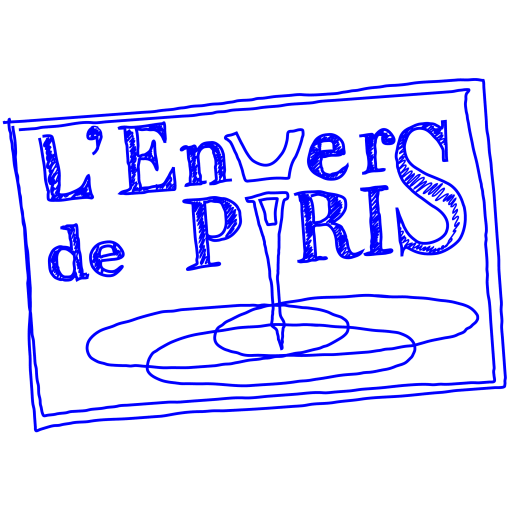Zazie, le réveil !

Zazie, le réveil !
Par Philippe Doucet
La phrase de Roland Barthes sur le roman Zazie dans le métro : « Par sa clausule irrespectueuse, Zazie […] possède la littérature (au sens argotique) exactement comme la Littérature possède le réel qu’elle chante »[i], indique bien dans quelle tension Raymond Queneau place son usage de la Littérature. En rupture avec les romans qui entretiennent l’illusion référentielle, son écriture romanesque ne cesse d’affirmer que la langue ne peut pas dire tout de la réalité dont elle parle, qu’elle échoue à la représenter et qu’il faut toujours le rappeler au lecteur pour qu’il puisse se décoller de cette croyance référentielle qui fige toute chose. Dans Zazie dans le métro, le personnage de Gabriel le rappelle à sa manière : « Paris n’est qu’un songe, Gabriel n’est qu’un rêve (charmant), Zazie le songe d’un rêve (ou d’un cauchemar) et toute cette histoire le songe d’un songe, le rêve d’un rêve, à peine plus qu’un délire tapé à la machine par un romancier idiot (oh ! Pardon). »[ii]
On sait également qu’une des fins possibles qu’avait imaginée R. Queneau pour son roman faisait dire à Zazie dans sa dernière réplique, en lieu et place de J’ai vieilli – J’ai écrit un roman. Cette façon de déstabiliser en permanence son lecteur, ce pas-de-côté éminemment quenien qui lui fait comprendre que le personnage n’est qu’une marionnette, une poupée creuse remplie de langage, a une fonction salutaire de réveil. Comme son personnage affirme avec force « Mon cul ! », Queneau affirme avec force que l’écrivain « assume le masque littéraire, mais en même temps […] le montre du doigt »[iii].
Ce double mouvement de construction/déconstruction est parfaitement repérable dans le langage employé par R. Queneau dans ce roman qui reproduit ou fait mine de reproduire le langage parlé populaire, mais pas à la façon d’un Zola ethnographe qui, carnet en main, notait le vocabulaire, les expressions imagées, la syntaxe à intégrer à son récit pour favoriser justement l’illusion référentielle. Une des innovations langagières de R. Queneau consiste à reproduire phonétiquement un mot mais à cette différence que, justement, ce n’est pas une traduction à l’aide de l’alphabet phonétique, ce qui n’aurait en littérature aucun intérêt. La phonétique quenienne est écrite : l’irruption d’un mot ou expression avec son orthographe baroque, voire loufoque, toujours drôle vient subvertir le discours ordonné, lisse, domestiqué. Doukipudonktan, premier mot du roman, vient trouer d’emblée la belle trame textuelle à laquelle on s’attendait. Ce mot énigme qui est aussi bien un mot manifeste, vient déchirer le tissu même du texte littéraire dans sa propension structurale à imposer un ordre lexical, syntaxique fixe. Ce premier mot au sens d’abord obscur confirme la prééminence du signifiant sur le signifié. Doukipudonktan est comme un pur signifiant qui s’impose d’emblée avec force. Dans sa création littéraire, R. Queneau est très original, car il ne crée pas un banal néologisme, soit un grand S, signifiant, sur petit s, signifié. Dans ce premier mot, il crée un signifiant, S, et met sous la barre, non un signifié, mais une suite de signes qui forment une phrase, ordonnée par une syntaxe populaire. Le signifié de Doukipudonktan n’apparaît que dans l’après-coup après une opération mentale, ce qui signifie concrètement que lorsque le lecteur le lit, il y a un trou à la place du signifié, ce qui est une exemplaire démonstration de l’autonomie du signifiant qui produit des effets indépendamment du signifié, à la manière de la lettre volée.
L’originalité de R. Queneau est de fabriquer un signifiant qui remet en perspective la linguistique structurale. Chaque mot est composé d’une combinaison de phonèmes et le phonème est la plus petite unité distinctive de son qui, en soi, n’a pas de sens. Or ici, R. Queneau attribue à chaque phonème un son et un sens, soit un signe, voire même une association de signes :
Dou = d’où ki = qu’ils pu = puent donk = donc tan = tant
On remarque d’ailleurs l’espièglerie de R. Queneau qui utilise deux K pour mieux perdre son lecteur et produire un rythme puissant. La saveur de ce signifiant pur est bien liée à l’écrit et sa graphie. Contrairement à la métaphore ou à la métonymie qui restent parfaitement compréhensibles à l’oral, le néologisme quenien prend sa saveur d’un rapport à l’écrit même s’il se donne des airs d’oral populaire. De la même façon, cet autre syllogisme de Gabriel : « Skeutadittaleur »[iv] n’est drôle qu’à l’écrit qui, en évacuant le signifié, laisse le signifiant produire seul son effet de signifiant vide. À noter bien sûr que c’est dans la reconnaissance après coup de la subversion que surgit l’aspect comique, qui a toujours à voir avec une chute phallique. La belle langue a été sacrément malmenée… Au fond, R. Queneau fait passer sous la barre de la signification, non plus un signifié, mais une phrase entière d’un parler populaire. Il fait passer sous la barre ce qui relève de la structure syntaxique, de l’aspect différentiel de la langue, sauf qu’ici dans un premier temps les signifiants sont collés entre eux, ne sont plus distincts et ils ne seront reconnus que dans un après-coup. Cet après-coup sidérant est tout aussi bien celui dont l’analysant est affecté quand il entrevoit les effets d’un signifiant singulier dans son roman personnel.
Ce premier mot Doukipudonkktan avec lequel R. Queneau introduit son roman Zazie dans le métro est placé là comme un manifeste pacifique et une invitation complice à se méfier du sens qu’on va construire en tant que lecteur. La fiction est un jeu de langage que ni l’auteur ni le lecteur ne maîtrisent tout à fait. Nous sommes des êtres parlés et ce premier mot de R. Queneau semble nous dire que c’est la langue qui gouverne notre parole et que la littérature est ce lieu où cela peut s’énoncer.
[i] Barthes R., Essais critiques, Seuil, 1964, p. 129-135.
[ii] Queneau R., Zazie dans le métro, Gallimard, 1972, p. 115.
[iii] Barthes R., op. cit., p. 129-135.
[iv] Queneau R., op. cit., p. 13.