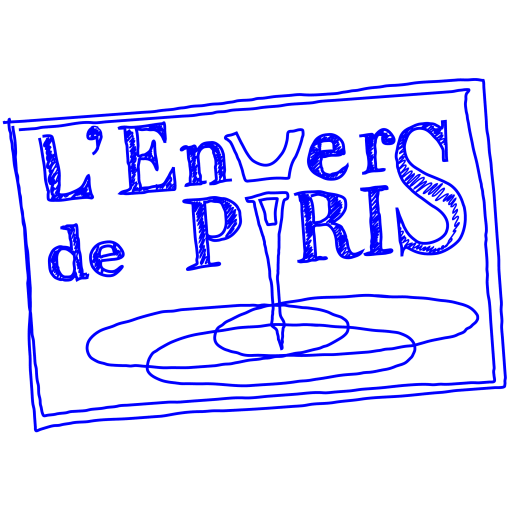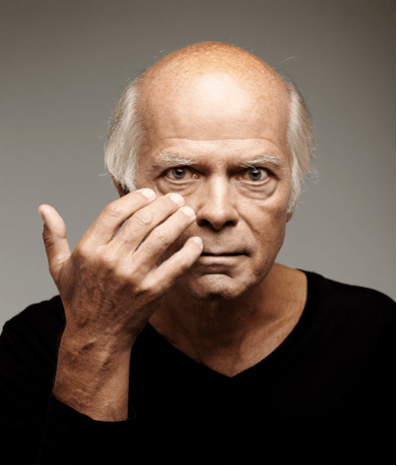Au-delà du fantasme, la musique de l’écriture
Pascal Quignard : au-delà du fantasme, la musique de l’écriture
Dans son roman autobiographique de 1993 Le nom sur le bout de la langue, Pascal Quignard écrit combien le langage lui fut dés le début problématique. Il connut sa première crise de mutisme au moment où, commençant tout juste à parler, il perdit sa nourrice allemande qui s’occupait de lui pendant que sa mère était alitée et malade : « parce que me quittait une jeune femme allemande qui s’occupait de moi […] et que j’appelais MUTTI. Je devins mutique »(1). Si d’un coté, cette perte réelle entraina chez lui enfant une défaillance de la parole, d’un autre côté, elle fut ce qui fut à l’origine de son écriture littéraire. « J’ai écrit pour survivre. J’ai écrit parce que c’était la seule façon de parler en se taisant. »(2) Ecrire, pour P. Quignard, vise à préserver le silence au cœur de la langue pour en faire faillir l’emprise et à retrouver dans ce défaut même le vivant de l’infans avant la perte. Le silence est constitutif de l’écrit. Il est ce qui paradoxalement lui donne sa part de vie la plus irrésistible, la plus rêvée, et ce qui commémore une perte irrémédiable.
Ce paradoxe du silence est au centre son roman de 1991 Tous les matins du monde. Dés ses premières pages, la perte de l’objet aimé se lie à la création artistique musicale et à la vie solitaire. « Au printemps de 1650, Madame de Sainte Colombe mourut. […] Monsieur de Sainte Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse. Il l’aimait. C’est à cette occasion qu’il composa le Tombeau des Regrets. […] Cependant le souvenir de cette dernière était intact en lui. Au bout de trois ans, son apparence était toujours dans ses yeux. Au bout de cinq ans, sa voix chuchotait toujours dans ses oreilles. […] Sainte Colombe s’enferma chez lui et se consacra à la musique »(3). Cette épouse perdue est « un morceau de joie »(4) à jamais perdu et cet objet-joie, cet objet-joui est avant tout un objet ouï. Il est cet objet musical indissociablement lié à l’objet a voix que Lacan a introduit comme étant « l’altérité de ce qui se dit »(5). La voix « résonne dans un vide qui est le vide de l’Autre comme tel […]. La voix répond à ce qui se dit, mais elle ne peut pas en répondre »(6).
Dans Tous les matins du monde, P. Quignard lie la musique au drame que fut pour Monsieur de Sainte Colombe la perte de son épouse dont « la voix chuchotait toujours dans ses oreilles ». La musique, que celui-ci compose et qui fait sa renommée, joue le rôle d’une catharsis, d’un apaisement par le plaisir dont Lacan interroge la fonction : « quel est donc ce plaisir auquel on fait retour après une crise qui se déploie dans une autre dimension, qui à l’occasion le menace, car on sait à quels extrêmes peut porter la musique enthousiasmante ? »(7) Cette menace que comporte la musique est celle que Lacan nomme avec Aristote « L’arrachement dionysiaque »(8) et qui n’est autre qu’une passion mortelle. Monsieur de Sainte Colombe choisit, comme le fit Antigone, de s’enfermer vivant dans un tombeau, lorsque, dans sa barque qui « avait l’apparence d’une grande viole »(9) il goute plus que tout « le balancement que donnait l’eau, le feuillage des branches des saules qui tombaient sur son visage et le silence »(10) et, songeant à sa femme, « à l’entrain qu’elle mettait en toutes choses » (11), écoute « les chevesnes et les goujons s’ébattre et rompre le silence d’un coup de queue ou bien au moyen de leurs petites bouches blanches qui s’ouvraient à la surface de l’eau pour manger l’air »(12) ; lorsqu’un jour, il alla jusqu’à rêver « qu’il pénétrait dans l’eau obscure et qu’il y séjournait »(13) ; lorsqu’une nuit, alors qu’il s’était isolé dans sa cabane pour jouer de la viole, il vit apparaitre « une femme très pâle […] qui lui souriait tout en posant le doigt sur son sourire en signe qu’elle ne parlerait pas […] C’était sa femme et ses larmes coulaient »(14). Cette exaltation, cette passion, cette folie qui donne du bonheur à Monsieur de Sainte Colombe, c’est bien de la musique que P. Quignard la fait naître et agir telle une catharsis se concluant par une grande quiétude. Après chaque visitation de son épouse morte, Monsieur de Sainte Colombe « au fond de lui, […] avait le sentiment que quelque chose s’était achevé. Il avait l’air plus quiet »(15).
Ainsi, l’objet a voix cause du désir est-il propre à aspirer ce désir au-delà du principe de plaisir et à porter l’amour à l’illimité. Il est ce qui fait désirer le sujet à partir d’un trou hors-sens dans l’Autre et à partir d’un manque de jouissance. « C’est en cela que toute fonction du a ne se réfère qu’à la béance centrale qui sépare, au niveau sexuel, le désir du lieu de la jouissance, et nous condamne à cette nécessité qui veut que pour nous la jouissance ne soit pas, de nature, promise au désir. Le désir ne peut faire que d’aller à sa rencontre, et, pour la rencontrer, il ne doit pas seulement comprendre, mais franchir le fantasme même qui le soutient et le construit. »(16) Dans son rapport à la jouissance, le désir en tant que tel ne peut qu’en appeler à la castration et construire un scénario fantasmatique où l’Autre est l’agent même de la castration qui soutient le désir : Le père bat l’enfant que je hais, Le père me bat, On bat un enfant. Dans Tous les matins du monde, P. Quignard fait de la perte de la voix de Marin Marais, au moment du surgissement pubertaire, le moment où le sujet perd son objet a voix et s’en trouve divisé. « Il était né le 31 Mai 1656 et à l’âge de six ans, avait été recruté à cause de sa voix pour appartenir à la maîtrise du roi dans la chantrerie de l’église qui est à la porte du château du Louvre. […] Puis, quand sa voix s’était brisée, il avait été rejeté à la rue ainsi que le contrat de chantrerie le stipulait. Il avait honte encore. Il ne savait où se mettre ; […] La blessure qu’il avait reçue à la gorge lui paraissait aussi irrémédiable que la beauté du fleuve »(17). Cette perte de l’objet a voix qui faisait son identité, le sujet Marin Marais parvient à la recouvrir en se construisant un scénario fantasmatique. A l’appel unitaire du fantasme, les coups castrateurs du père ne manquent pas pour garantir au sujet, au moment où plus rien dans l’Autre n’assure sa consistance de sujet et réponde de son Moi, l’appui de l’objet a comme perte de jouissance, comme misère, comme détresse, comme solitude. « Il avait le cœur plein de nostalgie. Il se sentait seul, comme une bête bêlante, le sexe épais et poilu pendant entre les cuisses. […] il n’avait pu retenir plus longtemps ses sanglots et était monté avec précipitation s’enfermer dans la pièce où on disposait le soir les paillasses, au-dessus de l’atelier où son père travaillait. Son père, l’enclume ou bien la forme en fer sur la cuisse, ne cessait de taper ou de râper le cuir […] ces coups de marteau lui faisaient sauter le cœur et l’emplissaient de répugnance »(18). C’est en s’assurant du scénario de son fantasme qui met en jeu son rapport à son objet a que le sujet unifie son Moi et son discours. « C’est alors que [Marin Marais] s’était dit qu’il allait à jamais quitter sa famille, qu’il se vengerait de la voix qui l’avait abandonné, qu’il deviendrait un violiste renommé. » (19) C’est ce fantasme qui le conduit chez Monsieur de Sainte Colombe qui « avait conçu un instrument en bois qui couvrait toutes les possibilités de la voix humaine : celle de l’enfant, celle de la femme, celle de l’homme brisée, et aggravée »(20).
Mais si Marin Marais rencontre Monsieur de Sainte Colombe par le prisme de son fantasme, c’est à la musique s’enracinant dans un reste de jouissance silencieuse hors sens qu’il se voit confronté. De ce maître en maniement de la viole, il apprend aux dépens de son fantasme que « la véritable musique » travaille à « faire naître une émotion dans nos oreilles »(21) et que le regard nuit à la musique, cet art « simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler »(22). Pour P. Quignard, cette « chose invisible » et hors sens est ce que tout artiste « hèle »(23) à lui/l’ouï. Elle est cette part de jouissance qui, au-delà scénario fantasmatique la recouvrant d’imaginaire, fait fixion d’un réel non objectivable, non nommable comme tel, non imaginarisable et dont il s’agit de faire fiction autrement que l’Autre du langage établi. Dans sa propre visée littéraire de produire du nouveau, P. Quignard privilégie les dimensions musicales de son écriture : reprises, entrelacements des thèmes, échos, résonnances, variations des tons, … C’est l’audition qui prime. « J’obéis, je fais tout à l’oreille. […] Que ça sonne comme il faut pour le Surmoi pour lequel j’écris. J’écris pour le premier royaume. J’écris in aurem »(24). Cet objet a voix à la puissance surmoïque est à la fois délice agalmatique et déchet immontrable, mais toujours objet cause de désir. « On raconte que nous répétons ainsi des expériences plus anciennes qui, quoi qu’elles nous soient, pour ainsi dire, complètement échappées des mains, nous passionnent comme un très vieux goût aigre, délicieux et sans nom – et dans lesquelles nous nous fourrons – telle une mouche à ver dans un dépôt d’ordures, ou tel le papillon d’Irénée Bergé dans la bouche de mademoiselle Aubier. »(25) Cet objet indicible est l’enjeu majeur de l’écriture de P. Quignard. Au-delà de sa valeur imaginaire dont le fantasme complète le sujet, il est ce vide érogène qui est dissident à l’Autre du langage déjà là. C’est à cet objet réel chargé d’une jouissance en plus non prise dans la jouissance phallique du fantasme que s’encre/s’ancre l’écriture littéraire de P. Quignard. Son art littéraire commémore la perte de l’enfance et traite le réel de jouissance faisant intrusion dans le corps en le nouant au langage de façon nouvellement symptomatique.
La littérature est cette expérience qui ouvre chaque sujet, qu’il soit écrivain ou lecteur, à une éthique de la responsabilité de son mode singulier de jouissance. Marie-Christine Baillehache
(1) Quignard P., Le nom sur le bout de la langue, Gallimard, 1993, p. 61.
(2) Ibid., p. 62.
(3) Quignard P., Tous les matins du monde, Gallimard, 1991, P. 9-11-12.
(4) Ibid., p. 16-17.
(5) Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 318.
(6) Ibid., p. 318.
(7) Ibid., p. 288.
(8) Ibid., p. 288.
(9) Quignard P., Tous les matins du monde, op. cit., p. 34.
(10) Ibid., p. 34.
(11) Ibid., p. 34.
(12) Ibid., p. 35
(13) Ibid., p. 35.
(14) Ibid., p. 35-36.
(15) Ibid., p. 39.
(16) Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p. 383.
(17) Quignard P., Tous les matins du monde, op. cit., p. 41-42.
(18) Ibid., p. 43.
(19) Ibid., p. 44.
(20) Ibid., p. 45.
(21) Ibid., p. 64-65.
(22) Ibid., p. 113.
(23) Ibid., p. 74.
(24) Argand C., « L’entretien : Pascal Quignard », Lire, février 1998, p. 89.
(25) Quignard P., Le salon de Wurtemberg, Gallimard , 1986, p. 29.