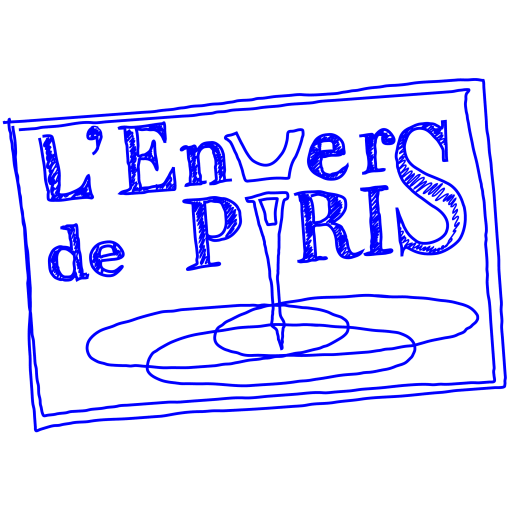Éclats de Paris
Autour du vide, Pina Bausch
par Marie-Christine Baillehache
Dansez, dansez, dansez, sinon nous sommes perdus… »
Pina Bausch
C’est avec Kurt Joos, que P. Bausch expérimente la combinaison de la danse expressive, de la musique, du théâtre et de la primauté nouvelle donnée au sentiment. Kurt Joos est le père de l’expressionisme en danse né en Allemagne après la boucherie de la guerre de 1914-1918 et l’effondrement de la culture de la vieille culture bourgeoise européenne. Ce mouvement prend sa source artistique dans l’œuvre tourmentée du peintre norvégien Edward Munch et dans celle du peintre néerlandais Vincent Van Gogh. Leur vision tragique et désespérée de l’homme influence toute la danse moderne de ces années d’après la première guerre mondiale.
Née en 1940 dans l’Allemagne marquée par la violence et la mort de la deuxième guerre mondiale et marquée dés son enfance par la destruction massive des fondements de l’humanité, P. Bausch s’engage dans la « danse-théâtre » où « chaque mouvement doit être clair, avoir une raison d’exister. Si le mouvement n’a pas de sens il devient divertissement. » [1]
Pour P. Bausch, la visée de sa danse tient à la vérité des liens d’amour et de haine entre les hommes. Dés les années 70, elle centre ses chorégraphies de Gluck « Iphigénie en Tauride », « Orphée et Eurydice » et de Stravinsky « Le sacre du printemps », sur les liens d’engagement intime de l’homme avec sa société. « Je travaille sur la réalité de notre époque. » affirme-t-elle pour définir sa « Danse-Théâtre ». Sa méthode de travail est de questionner ses danseurs, tous choisis pour leur forte personnalité, sur leur quotidien et sur des questions existentielles. A partir de leurs réponses et parce qu’elle ne croit plus à la narration qui donne une cohérence à une vie qui l’a perdue, elle compose des fragments de tableaux aussi doux que cruels, aussi beaux que tristes, aussi compréhensibles qu’obscures. Et ses tableaux, elle les adresse au public directement. Il s’agit que le spectateur participe : Il regarde, il pense, il ressent quelque chose. ». Ne le laissant pas ignorant de la haine qui git au fond de l’homme, elle affirme vouloir « lui offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus : des moments d’amour pur. »
Sa chorégraphie de 1986 « Viktor » nous plonge pendant 3 heures dans les désirs et les peurs, les fêlures et l’énergie de vie de l’être humain. Dans l’espace d’une carrière cernée de hautes falaises de terre brune, d’où un homme jette régulièrement des pelletées de terre, P. Bausch met-en-scène dans une suite de fragments le désarroi de femmes et d’hommes genrés, nous emmenant jusqu’à des sentiments mêlés de désespoir et d’espoir. Cet espace vide et clos de la carrière, elle le remplit de la violence des places assignées à chaque sexe et de la brutalité de leurs rapports contraints à un jeu de rôles pesants. Mais elle y donne très vite toute sa place à la rencontre avec l’altérité singulière du hors-norme. Dans cet espace vide, sa « volonté de création à partir de rien, volonté de recommencement »[2] met-en-scène de nombreux tableaux où la gravité et l’espièglerie, la tragédie et l’humour, le rêve et le cauchemar, le céleste et le cauchemar, la vie et la mort se juxtaposent. Un homme seul écoute l’histoire d’un petit garçon n’ayant plus personne sur terre et décidant de voyager jusqu’aux étoiles ; une femme se balance, si heureuse, à travers tout l’espace ; un homme vêtu d’un grand manteau brun, le visage caché dans l’ombre de son chapeau traverse l’espace en silence ; des couples formant une ribambelle joyeuse dansent au rythme des valses et des chants traditionnels italiens ; des femmes tartinent des petits pains de confiture et les offrent au public ; une femme hurle « foutez le camp ! Dégagez ! » ; un personnage vouté sur un bâton et entièrement voilé d’un drap noir arrête répétitivement la danse pleine d’énergique vitalité des danseurs ; … dans une très belle danse finale, la troupe des danseurs assis s’avance vers le public avec de véhéments et incantatoires mouvements de bras. Dans cet espace vide, les robes fleuries et les chevelures magnifiques des femmes, la bande son aussi riche que sublime, le foisonnement débordant des gestes, des formes et des paroles à la métrique précise, la cohérence du travail et de la pensée de la « Danse-Théâtre » de P. Bausch, la perte maitrisée de tout repère garanti, font naitre le sentiment pénétrant que le vase a bien cette fonction signifiante de représenter la création « vers le haut pour recevoir, par rapport à la terre dont il élève quelque chose. » [3]
Contre le monde où elle est née et qui n’était pas beau à voir tant il était celui de la destruction radicale de la haine de l’homme, P. Bausch n’a pas cessé de créer sa barrière singulière, celle de ses très belles chorégraphies dont la richesse foisonnante est si emblématique de son univers. Et lorsqu’en 1983, Fellini lui fait jouer le rôle d’une cantatrice aveugle faisant un voyage sur un paquebot de croisière dans son film « E la nave va », ne fait-il pas d’elle l’artiste capable d’échapper aux apparences pour dresser par son expérience esthétique « la vraie barrière qui arrête le sujet devant le champ de la destruction du désir radical pour autant qu’il est le champ de la destruction absolue. » [4]
[1] Raimund Hogue, « la danse expressionniste allemande », eldablog.com, p. 9.
[2] J. Lacan, Séminaire VII « L’éthique de la psychanalyse », 1959-1960, Ed. Seuil, 1986, p. 251.
[3] J. Lacan, Idem, p. 145.
[4] J. Lacan, Idem, p. 256.