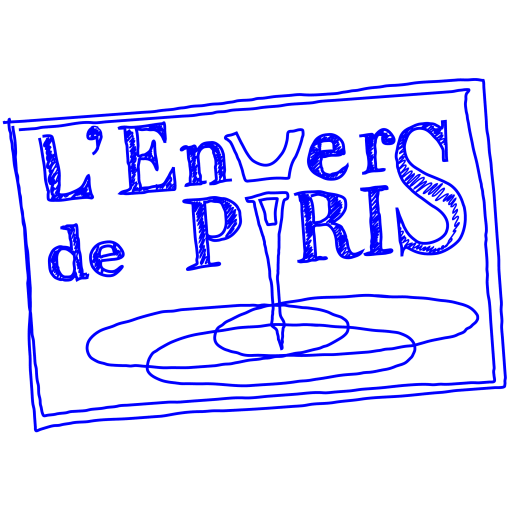Entre psychiatrie et neurosciences quel avenir pour le diagnostic ?
L’Envers de Paris et l’ACF Ile-de-France ont organisé une série de cinq conversations. C’était l’occasion d’ouvrir un dialogue entre psychiatres, psychanalystes membres de l’ECF, et professionnels exerçant des fonctions diverses dans des hôpitaux et autres lieux de soins.

La 4e Conversation s’est tenue le mercredi 17 avril 2019 au 92 bis Bld du Montparnasse, 75014 Paris.
Elle avait pour thème : Entre psychiatrie et neurosciences quel avenir pour le diagnostic ?
Entre psychiatrie et neurosciences : où est le sujet ?
par Patrick Almeida
En guise de soirée préparatoire au congrès PIPOL 9 « L’inconscient et le cerveau : rien en commun », l’Envers de Paris et l’ACF Île-de-France ont organisé la 4e conversation sur le thème « Psychanalyse et psychiatrie » le mercredi 17 avril. Éric Laurent et Patrick Landman ont abordé la question : « Entre psychiatrie et neurosciences, quel avenir pour le diagnostic ? »
Avec le terme de « translation diagnostique », É. Laurent désigne la période de l’histoire de la psychiatrie qui succède au cycle de recherche fondamentale en psychiatrie fondé sur le système de classification DSM (Diagnostic and Statistical Manual). La perspective translationnelle s’inscrit dans le hiatus entre les recherches psychiatriques actuelles et le projet de langue unique promu par le DSM. La recherche translationnelle est une recherche traductionnelle qui vise à traduire en applications concrètes les sciences dites appliquées, les théories scientifiques et les découvertes de laboratoires, dans le but d’obtenir des résultats plus probants.
L’arrivée du DSM-5 marque le début de la fin des ambitions DSM qui prétendaient gérer la définition psychopathologique, guider les études concernant l’évaluation des effets médicamenteux et définir les balises de la recherche en psychiatrie. C’est la fin de l’utopie d’une langue commune et unique. La conséquence en est la scission entre les chercheurs et les praticiens qui étaient auparavant unifiés par la langue unique. Dans cette nouvelle perspective, nous sommes passés d’un modèle qui visait l’unification à un autre où toute une série de modèles concurrentiels et hétéroclites s’affrontent désormais. C’est un effet de multiplication des discours.
Après cet état des lieux de ce nouveau syntagme qu’est la translation diagnostique, É. Laurent isole cinq questions que cela implique.
1/ Où est l’impasse du diagnostic du DSM ? C’est du DSM-5 que les anciens chercheurs, responsables du projet, se désolidarisent, à l’instar d’Allen Frances directeur du DSM-IV. Est en effet reconnue une impossible logique qui résiste à l’utopie des classifications stables. Comme le notait finalement Freud, « nous sommes tous plus ou moins névrosés » – formule radicalisée par Lacan, tout le monde est fou, c’est-à-dire, tout le monde délire. La puissance de Big Pharma, à partir de son lobby publicitaire et du marketing direct, a également déclenché une inflation du diagnostic et une surmédicalisation, voire même la promotion d’un modèle de vie régi par la médicalisation généralisée. C’est ce qu’É. Laurent qualifie de « problèmes de croyance civilisationnelle ».
Ainsi, la langue univoque et contrôlée du DSM n’a nullement empêché cette bulle de l’inflation diagnostique. Et le DSM-5, selon l’épistémologue Steeves Demazeux, a injecté des mots nouveaux sans pour autant pouvoir stabiliser leur signification alors qu’aucun marqueur biologique n’a été trouvé entretemps. Le DSM-5 s’est finalement réduit à un projet botanique dans le champ de la folie.
2/ Jusqu’où la science peut rendre compte des diagnostics ? Étant donnée la crise des modèles de recherche, il n’y a pas de science dans le DSM-5, puisqu’il n’y a pas de validité scientifique, et ce en dépit de la mesure statistique de l’homogénéité des jugements formulés par plusieurs évaluateurs face à une même situation qui reste le point fort du DSM. Comme l’indique É. Laurent, « la langue est parfaite, mais elle ne veut rien dire dans la mesure où elle a complètement oublié qu’elle doit mesurer autre chose qu’elle-même ».
Pour remplacer le DSM-5, le NIMH (National Institute of Mental Health) a lancé voici quelques années le projet nommé RDoC (Research Domain Criteria) qui vise à agréger plusieurs méthodes pour la recherche d’objectivité en psychiatrie : collecte de marqueurs génétiques probables, neuro-imagerie, analyse de la cognition, émotion, etc. En somme, l’ambition est de modéliser le cerveau, et ce malgré les difficultés d’intégration de données – dans une tentative affolée de traduire ensuite les avancées génétiques en résultats thérapeutiques. Mais il reste encore du chemin à faire car jusqu’à présent, il n’y a aucun principe organisateur.
3/ Le troisième point concerne l’examen de la boucle de justification du diagnostic via le remède psychotrope. Autrement dit, c’est la bijection {diagnosticX®traitementX} et son retour qui justifie qu’un diagnostic se pose. Exemple : pour le diagnostic de la dépression, le traitement est l’antidépresseur qui produit ainsi un savoir sur la dépression – la dépression se définirait alors par ce que l’antidépresseur soigne. Néanmoins, Stephen Weichman, ancien directeur du NIMH, notait dès 2012 qu’après 50 ans d’usage de neuroleptiques le pic d’efficacité n’a jamais été élucidé et que leur mécanisme d’action n’a jamais été compris non plus. Le NIMH a ainsi mis en garde contre la prescription constante de neuroleptiques et leurs conséquences funestes à long terme. Big Pharma et les grands laboratoires ont donc laissé la place à de plus petites structures pour faire reconnaitre des nouveaux remèdes.
4/ L’espoir du diagnostic qu’offre Big Data entraîne une difficulté majeure en psychiatrie : il y a trop de petites séries de cas homogènes, ce qui explique le peu de reproductibilité des études en neurobiologie psychiatrique sans que le recours à la méta-analyse parvienne à suppléer ce défaut fondamental. Cet espoir a cependant toute sa place dans ce champ, puisque Big Data permet de se passer d’une théorie biologique : à partir du moment où l’on se sert de l’efficacité de l’algorithme, plus besoin de théorie. É. Laurent conclut : « c’est l’attestation du passage de l’ère épistémologique du Pourquoi (et de la relation de causalité), à celle de l’ère du Quoi (de la simple corrélation) ».
Avec cette injection de mathématique et d’algorithme, c’est le principe d’acquisition d’une autorité morale par les sciences cognitives qui est ainsi mise en marche. On assiste à la formation d’un fort lobby capable de modifier la clinique et les praticiens – comme l’atteste en France la Fondation FondaMental et son projet de médecine personnalisée en psychiatrie dans ses Centres Experts et leur clinique mathématique translationnelle.
5/ Où passe le sujet dans cette translation diagnostique ? Comment le localiser dans cette querelle entre psychiatrie et neurosciences ? À l’heure où la psychiatrie connaît une chute spectaculaire du nombre de médecins, dans un champ psychiatrique où règne le manque d’investissement, les patients se sentent de plus en plus abandonnés, livrés aux excès de médication, laissés à la rue, voire en prison. Face à ces abandons, le sujet s’accroche à des diagnostics qui lui donnent accès à des soins tout en le stigmatisant le moins possible.
Il reste néanmoins deux aspects de la question du sujet par rapport au diagnostic : ou bien le sujet trouve une place dans une classification (des sujets qui parlent alors d’eux-mêmes dans la langue des spécialistes, voire apprennent à « vivre avec » tel diagnostic, dans un effort « d’exercice d’autonomie » – A. Ehrenberg dixit ; ou bien le sujet se manifeste comme échappant à toute classification.
Le sujet de l’inconscient échappe à la classification, à l’assignation d’une place. Tel le rêveur, le sujet se refuse à se définir comme place ; il est la marque de la non-place et est repérable à partir de ce qui dysfonctionne. Le sujet lacanien, radicalisant la perspective freudienne, se manifeste foncièrement par ce qui rend instable toute classification, toute identité ou identification, en les subvertissant. Le sujet en fait toujours un usage hors-assignation d’identité.
Dans le translationnel qui est le nôtre, conclut É. Laurent, chaque sujet se loge non pas dans une catégorie ni un nom commun, mais dans la façon dont il réussit à loger sa mentalité au sens lacanien. Dans le translationnel psychanalytique, le sujet a une chance de réussir à loger sa mentalité et de se faire un nom bien au-delà de toute étiquette possible. É. Laurent insiste sur ceci : le sujet dit ce qu’il a à dire en faisant tout dysfonctionner.
Quant à l’analyste, il se positionne de façon zen : le plus vide possible pour que ça advienne, en ne faisant pas du sujet qui est en face de lui un psychotique, catégorie universelle, mais un sinthome. Cela implique de s’orienter à partir du montage tissant réel, symbolique et imaginaire propre à chaque sujet, toujours singulier et sinthomatique. Cela est tout l’apport de la dernière clinique de Lacan, nous dit É. Laurent, subversive en tant qu’elle nous amène à repenser autrement les classifications diagnostiques.
Le sujet brouille les cartes par rapport à ces questions de cérébro-lésés par Aurélie Pascal
Quand l’IRM objective des lésions cérébrales, dans le cadre de traumas, de post AVC, de maladies neuro-dégénératives… est-ce que le sujet s’en trouve lui aussi atrophié, l’inconscient, nécrosé ?
Ce n’est pas le pari de l’analyse, quand bien même l’on peut se demander si « penser » sans cerveau est possible…Si la pensée est celle d’un parlêtre affecté par le langage, marqué par la morsure du signifiant sur le corps, pourquoi le sujet devrait-il être localisé dans un organe en particulier ? Tant qu’il y a un corps, il y a de la jouissance nous dit Lacan, donc, des manifestations de l’inconscient : « N’est-ce pas là ce que suppose proprement l’expérience analytique ? – la substance du corps, à condition qu’elle se définisse seulement de ce qui se jouit. »(1).
Un cerveau qui « fonctionnerait » moins bien, ralentit certes les fonctions exécutives : langage, mémoire, raisonnement…, il y a des troubles visibles. Mais, dans ce que l’on entend de ses manifestations, tout n’est pas à mettre du côté de la pathologie ”neuro”.
Comme l’a énoncé Patrick Landman ce mercredi 17 avril, lors de la 4e conversation « Entre psychiatrie et neurosciences, quel avenir pour le diagnostic ? », organisée par l’Envers de Paris et l’ACF Île-de-France(2) : « il y a des choses tout à fait intéressantes, de voir comment le sujet brouille les cartes par rapport à ces questions de cérébro-lésés. […] par exemple quand on écoute des cérébro-lésés ou même des sujets Alzheimer, étiquetés comme tels, parce que c’est très compliqué cette histoire d’Alzheimer, on peut faire la distinction entre des troubles de la mémoire qui sont d’origine organique ou le refoulement, si on est un peu attentif, spécialisé en quelque sorte dans l’écoute de ce genre de patient ».
Cette phrase est particulièrement parlante, lorsqu’on rencontre dans la clinique orthophonique avec des adultes souffrant de troubles neurologiques, des signes dont on peut faire le pari de les attribuer au sujet si l’on s’oriente de la psychanalyse. Prenons par exemple le phénomène appelé « persévération », c’est-à-dire un mot, une phrase qui revient et qui n’est pas la réponse ”attendue” ou ”adaptée”, que l’on classe donc du côté de l’erreur en neuro. Il est intéressant de voir que chez certains sujets, ce serait plutôt du côté de l’itération, du côté du corps, de la ”mansion” du dit, à savoir quelque chose qui insiste à se dire, comme une marque singulière de jouissance : « Cette dit-mension – je me répète, mais nous sommes dans un domaine où justement la loi, c’est la répétition »(3)
Ensuite, lorsque P. Landman évoque la complexité de l’étiquette ”maladie d’Alzheimer”, là encore, cela résonne. Ce diagnostic, souvent posé après la passation de batteries de tests neuro-psychologiques (avec éventuellement repérage d’une atrophie de l’hippocampe détectable à l’IRM), a ses limites. On ne peut valider entièrement le diagnostic de cette maladie que par vérification d’un certain marqueur biologique (la protéine Tau en augmentation chez les personnes malades), la méthode la plus fiable étant la biopsie post-mortem. Cette maladie, nous échappe ; la tentative de vouloir attraper le réel par la science, échoue. Science, dont les seules certitudes peuvent être établies post-mortem, ce qui en dit long sur son rapport au désir et à la vie. Comme le montre Gérard Wajcman dans son livre Les experts, la police des morts, nous sommes entrés dans les monde de l’expertise, où la science promet de tout expliquer. Seulement, cette promesse rate, et ratera encore dans ses propres limites à différencier le neurologique du psychique. D’autant que les futurs médecins, scientifiques… n’entendront plus parler de l’inconscient au lycée et auront pour seul éclairage la perspective cognitiviste. Comme Laurent Dupont l’écrit dans Lacan Quotidien, « réduire l’humain à un algorithme sans inconscient est et restera un rêve scientiste […] Ce rêve, comme il y en eut d’autres, n’a pour but que de nier ce qui de l’homme restera toujours énigme ou opacité : soit que c’est un corps vivant parlant et que, dans son cerveau, rien n’a été prévu pour rencontrer l’Autre »(4).
C’est cette énigme posée par l’inconscient, que l’on tente de faire disparaître en collant trop vite une étiquette de type « Alzheimer » par exemple, lorsqu’on a un faisceau de signes suffisant, correspondants aux critères du DSM-5(5). Mais ces signes, rien ne nous dit qu’ils soient imputables à une maladie neuro-dégénérative. La clinique montre nombre de cas d’effondrement subjectif brutal, de perte quasi immédiate du langage, de la mémoire épisodique après le deuil d’un époux, le départ en retraite… événements qui peuvent provoquer de vrais cataclysmes dans la vie d’un sujet qui avait trouvé de quoi tenir dans le monde ou se débrouiller avec son symptôme de parlêtre. C’est ainsi qu’un traumatisme psychique peut entraîner des symptômes qui s’apparentent à des lésions neurologiques, comme les fameuses « amnésies », que Freud a découvertes chez Charcot, chez les hystériques. Donc le sujet brouille les cartes dans la névrose, mais aussi dans la psychose lorsqu’il y a une tonalité mélancolique par exemple : face à une dépression soudaine, on n’est pas sûr de pouvoir l’expliquer par la symptomatologie Alzheimer, « que le substrat biologique du sujet soit dans l’analyse intéressé jusqu’en son fond, n’implique nullement que la causalité qu’elle découvre y soit réductible au biologique. »(6)
Enfin, comme l’a énoncé P. Landman, même lorsque le trouble cognitif est avéré, est-ce un oubli dû à l’atrophie de l’hippocampe (aire cérébrale située dans le lobe temporal impliquée dans des processus de mémoire) ? Ou est-ce un refoulement, à savoir une manifestation du sujet de l’inconscient ? Freud en a donné un exemple très parlant avec son propre oubli du nom Signorelli, que Lacan reprend : « c’est que signor, avec le Herr, le Maître absolu, est aspiré et refoulé par le souffle d’apocalypse qui se lève dans l’inconscient de Freud aux échos de la conversation qu’il est en train de tenir »(7).
Alors, c’est pour mettre le sujet au cœur du débat que Pipol 9 se tiendra cet été, afin que la brèche ouverte par cette question neuro/psy reste vive. Brèche dans laquelle l’acte analytique, soutenu par le désir de l’analyste, ne se laissera pas « flinguer »(8).
(1) Lacan J., Le séminaire, livre XX, Encore (1972-1973), Paris, Seuil, p. 26.
(2) soirée préparatoire au Congrès Pipol 9 « L’inconscient et le cerveau, rien en commun », invités : Éric Laurent, Patrick Landman.
(3) Lacan J., Le séminaire, livre XX, Encore, op. cit., Paris, Seuil, p. 101.
(4) Dupont L., « La dignité de l’énigme », in Lacan Quotidien n° 834 : Intraitables !
(5) cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association Américaine de Psychiatrie, février 2018.
(6) Lacan J., « La psychanalyse vraie, et la fausse », 1958, Autres Écrits, Paris, Seuil, p.166.
(7 Lacan J., « La psychanalyse et son enseignement », 1957, Écrits, Paris, Seuil, p. 447.
(8) Cf « Le ministre Blanquer flingue Marx et Freud », Lacan Quotidien.