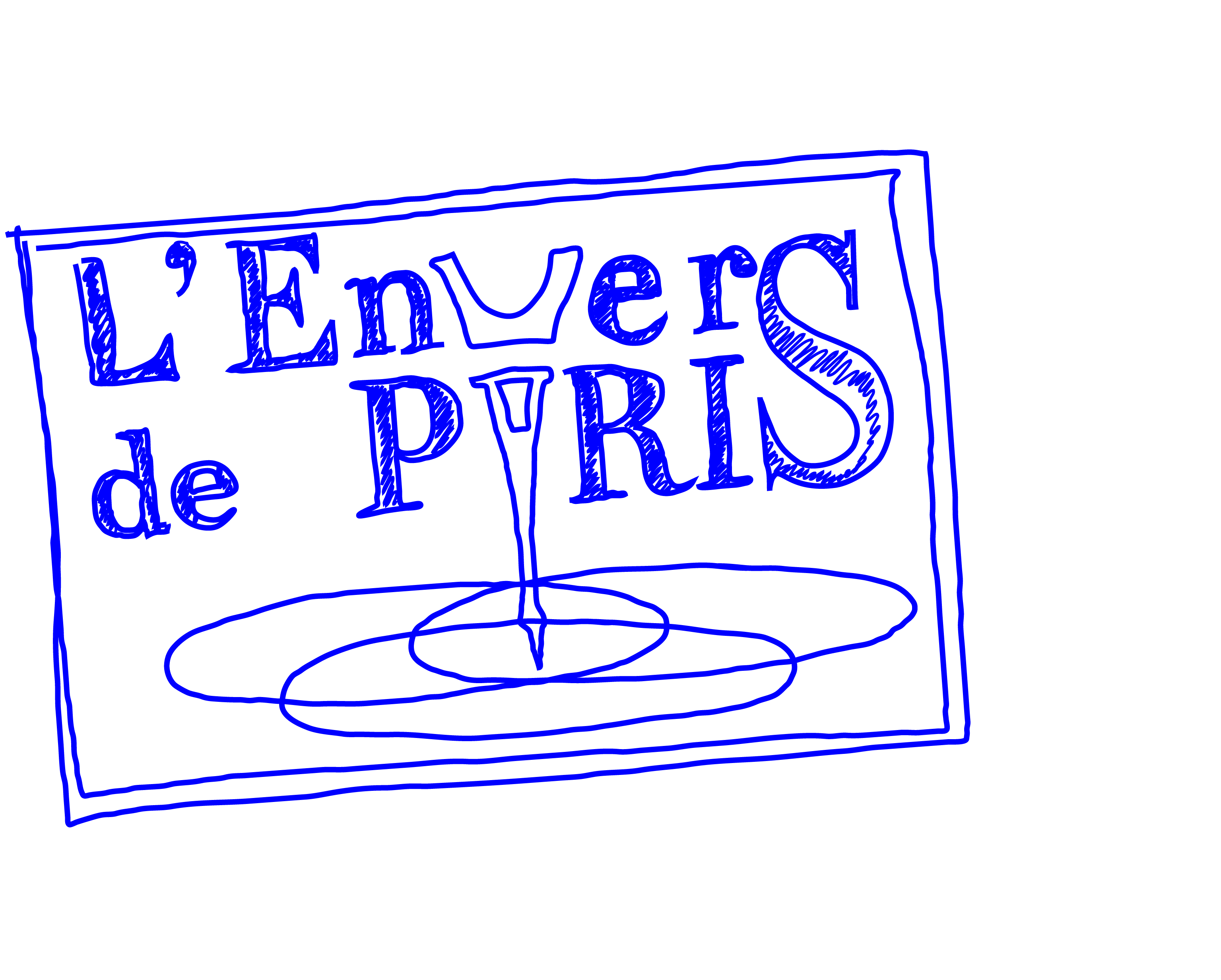littérature & psychanalyse

« Frère d’âme » : penser/panser le réel
par Marie-Christine Baillehache
Avec Frère d’âme, prix Goncourt des Lycéens 2018, David Diop porte un regard singulier sur les horreurs de la Guerre Industrielle de 14-18 qui a envoyé des millions de jeunes hommes se faire massacrer par le feu des mitraillettes et des obus allemands. Il rappelle que la France coloniale du 20e Siècle a arraché de jeunes africains à leurs terres natales pour les envoyer, sous le nom générique de Tirailleurs Sénégalais, sur une terre qu’ils ne connaissaient pas et que la guerre avait déjà dévastée. Dans son livre, D. Diop raconte ce double exil en faisant parler le soldat Alfa, à la première personne, de ses pensées, de ses sensations, de ses cauchemars de tirailleur sénégalais pris dans l’enfer de cette guerre. C’est après avoir lu Paroles de poilus : lettres et carnets du front (1914-1918) de l’historien J.-P. Guéno, en avoir ressenti « une intense émotion »(1) et après avoir constaté qu’aucune lettre de soldats africains n’y étaient recueillies, que D. Diop décide d’écrire ce roman « comme une lettre » qui révèlerait le lien intime de ce soldat africain à l’enfer de cette Grande Guerre. Faisant entrer son lecteur de plein pied dans l’extrême violence de cette Grande Boucherie, il nous livre un texte dur où la répétition psalmodique de certaines formules, de certains mots, de certaines phrases donne à son écriture une dimension poétique et une impression d’étrangeté.
Avec Frère d’âme, D. Diop expose ce qui, à l’envers de l’Idéal, est un débordement de jouissance hors-sens et révèle que le réel incandescent de la guerre de 14-18 renvoie au réel de notre civilisation française colonialiste et raciste. La république française a eu un empire colonial et un double discours. A son discours démocratique égalitaire, elle a adjoint un discours colonial du travail obligatoire. Pendant sa guerre de 14-18, elle a joué de la peur que la sauvagerie nègre provoquait chez les soldats allemands qui y répondirent en massacrant les tirailleurs sénégalais chargés du nettoyage au corps à corps de leurs tranchées.
Alfa s’engage à la guerre par amitié pour son « plus que frère » Mademba qui, très tôt, lors d’un assaut, meurt dans ses bras, éventré. Par trois fois, Alfa refuse d’achever Mademba qui le supplie de le délivrer de ses atroces souffrances. Son refus lui est fatal : il tombe dans sa propre folie meurtrière. « Je n’aurais pas du te laisser souffrir comme un vieux lion solitaire, dévoré vivant par des hyènes, le dedans dehors. »(2) Désormais, après chaque combat au corps à corps, il revient, « toujours vivant, toujours souriant », en rapportant un « butin de guerre sauvage […], un fusil ennemi avec la main qui allait avec »(3). Par sept fois, il répète ce geste de sauvagerie inhumaine, reflet nu de l’horreur de la Grande guerre. D’abord, les autres soldats et leur capitaine sont confortés dans leurs représentations colonialistes et racistes de l’homme africain courageux et sanguinaire. « Je jouais à leur place le sauvage exagéré, le sauvage en service commandé. »(4) Mais au bout de la quatrième main, Alfa devient « l’ami véritable de la mort, son complice, son plus que frère »(5). « J’ai su que le bizarre était devenu le fou, puis que le fou était devenu le sorcier. Soldat sorcier. »(6) Alors que la guerre veut une folie temporaire qui s’arrête quand l’attaque est terminée, les sept mains coupées et exhibées font d’Alfa un « malintentionné »(7), « un dëmm, un dévoreur d’âme […], un mangeur du dedans des gens »(8).
Cette atroce fracture intime qui l’a envahi, Alfa la reconnait aussi chez le capitaine qui « aime la guerre, comme on aime une femme capricieuse. […] Il la couvre de cadeaux, il la fournit sans compter en vies de soldats. Le capitaine est un dévoreur d’âmes […], un dëmm qui a besoin de sa femme, la guerre, pour survivre, tout comme elle avait besoin d’un homme comme lui pour être entretenue »(9). Mais si le capitaine veut ignorer l’horrible jouissance qu’il prend à sacrifier la vie de millions de jeunes hommes en les envoyant sur un seul coup de sifflet se faire massacrer par les obus et les mitraillettes de cette Guerre industrielle, Alfa, avec l’aide du « docteur François [qui] regarde le dedans de nos têtes »(10), n’ignore pas que sa propre fracture était déjà là avant qu’il n’arrive à la guerre : fils d’un père agriculteur et d’une mère nomade, il est divisé entre deux mondes irréconciliables ; seul, Mademba, son « plus que frère » le maintenait en équilibre. « Ce n’est que lorsque Mademba est mort que mon esprit s’est ouvert pour le laisser observer ce qui s’y dissimulait. […] une souffrance nouvelle y a rejoint une souffrance ancienne. Les deux se sont envisagées, les deux se sont expliquées l’une avec l’autre, les deux se sont entre-donné du sens »(11). N’ayant plus besoin des sept mains-vengeresses, il les enterre et avec elles la haine, la violence et la mort de la guerre. De son expérience de sa propre furie guerrière, Alfa garde « des cicatrices qui racontent [son] histoire »(12). Ses cicatrices sont les traces du réel impossible à résorber par le symbolique, mais qui ouvrent au sens et lui permettent d’inventer un nouveau sens : celui du conte allégorique de la princesse capricieuse qui, ayant voulu épouser un prince sans cicatrice, fut tenue en esclavage par lui sur une terre sans nom et sans histoire et s’en libéra grâce à un chasseur couvert de cicatrices qu’elle épousa. Cette fable pleine de sous-entendus soutient la vérité qui n’est pas Une mais double, voire triple : la mort et la vie y sont, comme Alfa et Mademba, le « plus que frère » l’une de l’autre. Il s’agit par la libération des jeux de langage de mettre en jeu le sujet de l’énonciation : « la petite voix venue de très, très loin dans ma tête me l’a laissé deviner. La petite voix a senti que mon corps ne pouvait pas tout me révéler sur moi-même. La petite voix a compris que mon corps m’était équivoque »(13).
Si avec Frère d’âme, D. Diop touche au réel mortifère de la guerre et de notre civilisation colonialiste et raciste, c’est en tant que son écriture littéraire pense et panse les traumas subjectifs et sociaux vécus singulièrement. Il répond par le symbolique à la monstruosité de l’homme à la fois en donnant à cette jouissance obscure sa dimension fictionnelle et à la fois en rythmant son écriture de répétitions de mots, de phrases, de formules qui laissent sa place à l’indicible cause de son désir vivant d’écrire : « La guerre violente fait partir de la vie et donc la vie peut dépasser cette violence. »(14)
(1) Diop D., interview de J-M Devésa du 26-01-2019, Librairie Mollat, YouTube.
(2) Diop D., Frère d’âme, R. Laffont, 2018, p. 15.
(3) Ibid., p. 26.
(4) Ibid., p. 42.
(5) Ibid., p. 44.
(6) Ibid., p. 43.
(7) Ibid., p. 43.
(8) Ibid., p. 53.
(9) Ibid., p. 92-93.
(10) Ibid., p. 115.
(11) Ibid., p. 136.
(12) Ibid., p. 168.
(13) Ibid., p. 167.
(14) Diop D., interview de J-M Devésa, op. cit.