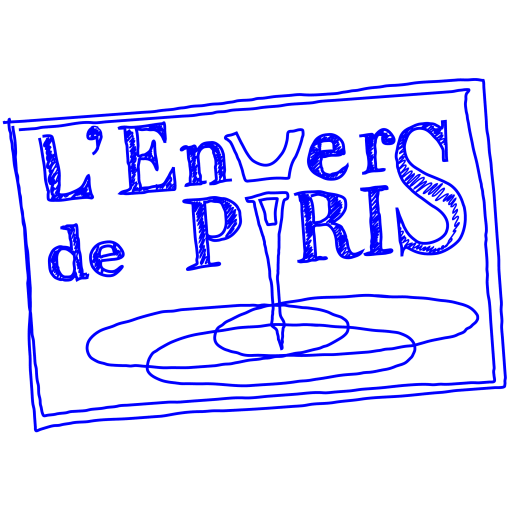Sans asile contre le coronavirus. Continuer à travailler dans l’humanitaire en temps de pandémie

Par Lore Buchner
Je travaille depuis un an comme psychologue au sein d’une structure d’hébergement pour 160 demandeurs d’asile et réfugiés dans le cadre du Pôle d’accueil des réfugiés d’une association humanitaire, dont le financement provient de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et de la Préfecture.
La population qu’on accueille fait partie des « invisibles » de notre société, de ceux qui ne sont d’ailleurs que des chiffres pour l’administration. Notre travail d’accompagnement – du moins de la façon dont je le conçois – est donc un travail d’humanisation, de redonner à la subjectivité de chacun une dignité ; et cela même au-delà des parcours singuliers qui les ont menés à demander à l’État français cette reconnaissance qu’est l’asile, qui n’est que la reconnaissance du risque que comporte pour leurs vies le retour à leurs pays. Car l’asile se dit « politique » dans un sens bien étroit du terme, en oubliant souvent que la misère ou le manque d’opportunités relèvent aussi du domaine du politique.
Les rencontrer, tous les jours, laisse pour moi terne ce syntagme de « demandeurs d’asile » venant les nommer sans cesse. Ils sont Salim, Ahmed, Hasib, Fatima, Ammar, Mamadou… Toujours moins des victimes de tortures atroces, moins des proies d’une pauvreté abjecte, moins des survivants de la Méditerranée, que des êtres humaines dans la poursuite d’un lieu possible pour eux dans le monde. Et c’est dans ce quotidien que j’apprends à chaque fois combien l’exil peut être conçu plutôt comme un pari encore pour la vie, là où la pulsion de mort a tout ravagé sur son passage.
On accueille donc ces parieurs. Et on parie sur eux. On parie sur leurs paris. On garantit des conditions dignes de logement, on propose une orientation juridique, on veille au respect de leurs droits, on assure leur accompagnement santé, on les guide vers leur insertion, et surtout on les écoute… De sorte que parfois on peut même oublier à quel point est risqué de vouloir le bien de l’autre, de croire qu’on sait à quoi ça consiste, d’en devenir les martyres, les héros. Être avertis de cette limite de l’impossible à sauver, de l’inconsistance de notre « acte héroïque », me semble un horizon fondamental à garder dans notre travail, faute de quoi lui-même il devient impossible.
Et il s’avère que dernièrement il l’est devenu, dans ce temps sans asile ni frontières contre l’épidémie inarrêtable du COVID-19. Notre équipe a été appelée à se constituer « en exception » face au commandement du confinement annoncé le 17 mars dernier par le gouvernement français. Le télétravail n’étant pas envisageable, il fallait, d’une part, assurer des missions d’urgence, telles que la distribution alimentaire pour les jours à venir, mais aussi d’autre part suivre des directives visant à garantir malgré tout nos missions habituelles, même quand elles restent irréalisables. Et ce sont surtout nos corps qui sont appelés à être là – dans la rue, dans le métro, dans les logements des résidents, dans nos bureaux – où la norme générale interdit qu’ils le soient ; cette fois-ci au nom d’un autre commandement, celui de « ne pas abandonner nos protégés ». On se retrouve alors dans cette position paradoxale où nous-mêmes ne sommes pas protégés. La distribution de masques, le gants, gel hydro-alcoolique, toutes ces mesures restant prioritaires pour les soignants en première ligne ; nous, nous n’y avons pas le droit. Cette décision de distribution prioritaire vient aussi nous rappeler que ce n’est pas à nous de rester là pour sauver des vies, que ce n’est pas à ce front que se jouent nos possibles.
Lorsque le réel maraude dans chaque coin, nous « les protecteurs » non-confinés devenons les agents potentiels de sa propagation auprès de ceux que nous sommes censés protéger. Là où tout acte héroïque cloche, c’est avec notre chair qu’on vient payer son échec. Cette fois-ci, c’est nous qui attendons un pari pour ces vies qui sont les nôtres.
Paris, le 23 mars 2020.