L’argument des prochaines Journées de l’ECF, transmis par la Directrice Laura Sokolowsky, est désormais disponible !
Ce document offre un éclairage précieux sur cet événement majeur qui se déroulera, le 15 et 16 novembre prochains, aux Palais des Congrès de Paris, sous le titre Le Comique dans la clinique.
Ce thème n’intéresse pas seulement les psychanalystes, il invite également tous les acteurs du champ culturel et social à participer aux Journées 55. Les interlocuteurs habituels de L’Envers de Paris y sont ainsi conviés : artistes, enseignants, éducateurs, chercheurs, ainsi que des professionnels du théâtre et du cinéma, des arts figuratives, de la musique, de la littérature..
Édito octobre 2025
Édito avril 2025
Édito mars 2025
Mars est aussi le mois du printemps et de son réveil ; nous sommes sensibles à tous les types de réveils, car c’est le réveil qui nous oriente avec les effets du réel et ses irruptions. L’émergence du réel est précisément ce qui nous réveille, le réel affecte le corps et produit des tensions insupportables, dues au fait qu’on se cogne à l’impossible. Même s’il nous est impossible de nous réveiller complètement, nous pouvons néanmoins avoir un désir de réveil et énoncer avec Jacques-Alain Miller que cet impossible « n’interdit pas de le prendre pour fin, ce réveil…
Édito janvier 2025
Avec le bureau je tiens à vous présenter, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit une année pleine de rencontres, d’activités et de surprises, pour tout un chacun. Notre association repart, après la pause de fin d’année, chargée de nouvelles énergies et pleine de projets intéressants. Nous continuons à travailler sur le thème Fantasmes contemporains du corps, à interroger avec ce prisme de lecture, l’actualité, le cinéma, le théâtre, la littérature, la clinique et à tisser les connexions entre la psychanalyse et la cité, selon la vocation de L’Envers de Paris.
ÉDITO DÉCEMBRE 2024
Les 54es journées de l’École de Cause freudienne se sont terminées depuis peu avec succès et leur richesse clinique et théorique est maintenue vivante afin de poursuivre la réflexion et l’étude de la psychanalyse au sein de notre association.
ÉDITO NOVEMBRE 2024
Le mois de novembre est très important pour notre École, car nous nous retrouverons au Palais des Congrès de Paris, finalement en présence après plusieurs années, pour participer aux 54es Journées d’étude de l’École de la Cause freudienne. Le thème de ces Journées, Phrases marquantes, a su capter, ces derniers mois, l’intérêt de beaucoup de personnes, car il s’agit d’un thème qui nous concerne tous. Il touche un point intime de l’histoire de chacun, là où une phrase, une expression, prononcée, adressée, lue, entendue ou attendue, a touché et marqué le sujet d’une manière particulière et indélébile. Pour cette raison ces 54es Journées de l’ECF ne sont pas réservées qu’aux professionnels, mais à tous ceux qui ont fait l’expérience de comment une phrase peut frapper, caresser, blesser, faire rêver, toucher des cordes sensibles et laisser des traces de jouissance dans le corps.
Édito octobre 2025
Édito février 2025

Cinzia Crosali,
directrice de l’EdP
Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le mois d’octobre s’ouvre sous le signe d’initiatives vivantes et porteuses, à L’Envers de Paris, ainsi qu’avec une intensification de la préparation des Journées 55 de l’École de la Cause freudienne qui se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains, au Palais des Congrès de Paris, sous le titre : Le comique dans la clinique.
Le lien que vous trouverez ci-dessous vous permettra de lire l’argument de sa directrice, Laura Sokolowsky, dont j’extrais la phrase finale, qui éveille notre appétit de savoir :
« Le comique dans la clinique est-il la voie royale pour saisir l’ampleur du malaise dans la culture ? Est-il l’index pointant l’inexistence du rapport entre les sexes dans l’inconscient ? Les 55es Journées de l’École de la Cause freudienne sont ouvertes à tous. Soyez nombreux à ce grand rendez-vous de la psychanalyse, le plus sérieusement comique. »
Édito février 2025
dans l’enseignement de Lacan ?
« Dans une analyse, un mot vous échappe ; vous vouliez dire quelque chose et vous dites le contraire ; un acte manqué vise juste au niveau du désir inconscient et une interprétation vous déroute et vous ne la comprenez pas. Tout cela ne passe pas par la comprenette. Il n’est pas rare d’en rire sur le moment ou en sortant de la séance. Le comique surgit donc dans la clinique quand le sens est déplacé, subverti, mis sans dessus dessous ».
Laura Sokolowsky, “Sur le vif”, Lacan Web TV
Édito octobre 2025
 Nous continuons également, et avec un enthousiasme renouvelé, la préparation de la Journée d’étude, Fantasmes contemporains du corps, en collaboration avec l’ACF en IdF.
Nous continuons également, et avec un enthousiasme renouvelé, la préparation de la Journée d’étude, Fantasmes contemporains du corps, en collaboration avec l’ACF en IdF.
Vous êtes invité(e)s à vous y inscrire le plus tôt possible et à réserver la date du 6 décembre 2025.
Nous recevons de plus en plus, dans nos cabinets, des patients aux prises avec leur rapport inquiet au corps. Corps qui leur échappe, qui se présente comme étranger, insatisfaisant, et qui fait souvent un obstacle à l’inscription du sujet dans le lien social comme dans l’expérience amoureuse. « Qu’il serait beau d’être beau, séduisant, athlétique, parfait » : tel est le fantasme immémorial de l’humanité. Mais aujourd’hui, il est redoublé par les promesses de la science appliquée à la médecine et à la chirurgie, qui prétendent offrir la jeunesse éternelle, voire l’immortalité.
Et pourtant, la clinique nous enseigne que, sous le voile du fantasme, c’est le réel qui insiste. Alors, entre le voile du fantasme et l’illusion de sa réalisation, c’est le réel du corps qui sera au cœur de notre réflexion lors de notre Journée d’étude.
Nous vous y attendons nombreux, le 6 décembre, pour interroger, avec nos invité(e)s, cette énigme contemporaine.
Édito février 2025
Cartels
Édito octobre 2025
 Le comique dans la clinique, lectures en cartel
Le comique dans la clinique, lectures en cartel
Un cartel est une occasion unique de rencontrer l’enseignement de Lacan et de Freud, un réveil du désir de savoir. Il ne s’agit pas de se faire enseigner par un autre, ni d’enseigner ce que l’on sait déjà. Un cartel, c’est une confrontation à la castration, à son « Je ne comprends rien », « Je ne veux rien savoir », une remise en cause du savoir totalisant, tel qu’on se l’imagine. Se réunir en cartel, c’est s’adjoindre à d’autres solitudes, devenir « cartellisants », former un petit groupe comme « essaim 1 », afin que s’éclairent les concepts de la psychanalyse.
tit groupe de quatre plus-un est une invitation à « l’élaboration provoquée 2 ». Il peut permettre une rencontre surprenante avec l’enseignement de Lacan et de Jacques-lain Miller. Cette rencontre, qu’elle soit première fois ou non, est une ouverture vers un bout de savoir nouveau.
C’est ainsi que la soirée de rentrée des cartels de l’ECF, vers les prochaines Journées de l’ECF, Le comique dans la clinique, a invité Chloé Fernando et Bénédicte Jullien. Elles nous exposeront leurs travaux. Entre désir, équivoque et trait d’esprit, nous risquons de rire sérieusement ! Hélène Bonnaud, psychanalyste membre de l’ECF a accepté d’être notre extime. Nous procéderons, en fin de soirée, au tirage au sort des nouveaux cartels. Nous vous attendons avec joie, le jeudi 16 octobre 2025 à 21h, au local de l’École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, 75006 Paris.
1. Miller J-A., « Cinq variations sur l’élaboration provoquée », intervention lors de la soirée des cartels de l’ECF du 11 décembre 1986, la lettre mensuelle, n°61, juillet 1987, p. 5-11.
2. Ibid.
Contacts :
Stéphanie Lavigne : enversdeparis-cartels@causefreudienne.org
Laurence Maman : acf.dr-idf@causefreudienne.org
Vecteur Lectures freudiennes
Édito octobre 2025
Nous nous retrouverons chez Susanne Hommel, le mercredi 8 octobre 2025 à 21h,
Contact : lectures-freudiennes@enversdeparis.org
Seminario Latino
Édito février 2025
 Une passionnante soirée a été organisée par le Seminario Latino, le 24 septembre 2025 ; à la Maison de l’Amerique Latine, en présence de Domenico Cosenza, membre de la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi et de l’Association Mondiale de Psychanalyse, autour de son livre, Clinique de l’Excès. Sophia Guaraguara, Jorge Farah, Flavia Hofstetter, Nayahra Reis et Eleonora Renna ont dialogué avec l’auteur sur les points cruciaux de son ouvrage : les troubles alimentaires, les toxicomanies, les déconnexions-hyperconnexions à l’adolescence… Un débat animé s’en est suivi avec le public.
Une passionnante soirée a été organisée par le Seminario Latino, le 24 septembre 2025 ; à la Maison de l’Amerique Latine, en présence de Domenico Cosenza, membre de la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi et de l’Association Mondiale de Psychanalyse, autour de son livre, Clinique de l’Excès. Sophia Guaraguara, Jorge Farah, Flavia Hofstetter, Nayahra Reis et Eleonora Renna ont dialogué avec l’auteur sur les points cruciaux de son ouvrage : les troubles alimentaires, les toxicomanies, les déconnexions-hyperconnexions à l’adolescence… Un débat animé s’en est suivi avec le public.
En octobre, le Seminario Latino de L’Envers de Paris poursuit son cycle d’études, Signifiants dans l’air du temps, et prépare sa dernière soirée de l’année, consacrée au thème de la liberté et de l’autonomie. Plus de renseignements à venir.
Responsables : Flavia Hofstetter et Nayahra Reis
Contact : seminario-latino-de-paris@enversdeparis.org
Vecteur Lectures cliniques
Édito février 2025
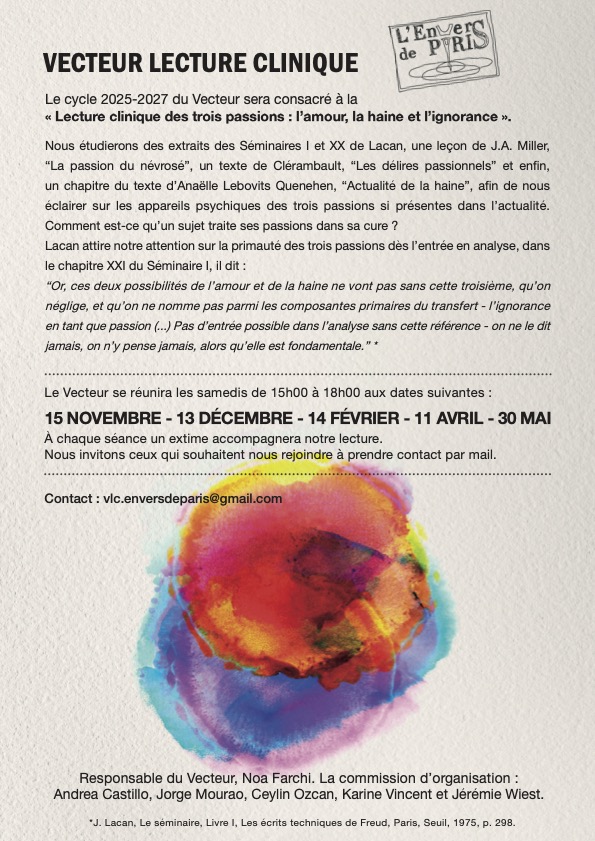 Le prochain cycle du vecteur, consacré au thème « Lecture clinique des trois passions : l’amour, la haine et l’ignorance » commence son activité en octobre. Le groupe d’organisation va se réunir pour préparer le 1er rdv du samedi 8 novembre, date à laquelle notre extime, Camilo Ramirez, sera présent. Pour ce rdv, nous préparons une lecture du Séminaire I de J. Lacan, leçon XXI « La vérité surgit de la méprise », partie 3 (pp. 408-414), et leçon XXII « Les concepts de l’analyse », partie 2 (pp. 419-425).
Le prochain cycle du vecteur, consacré au thème « Lecture clinique des trois passions : l’amour, la haine et l’ignorance » commence son activité en octobre. Le groupe d’organisation va se réunir pour préparer le 1er rdv du samedi 8 novembre, date à laquelle notre extime, Camilo Ramirez, sera présent. Pour ce rdv, nous préparons une lecture du Séminaire I de J. Lacan, leçon XXI « La vérité surgit de la méprise », partie 3 (pp. 408-414), et leçon XXII « Les concepts de l’analyse », partie 2 (pp. 419-425).
Le vecteur se réunira cinq fois cette année, le 8 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 11 avril et 6 juin, chaque fois en présence d’un invité extime. Il reste des places pour rejoindre ce cycle de deux ans.
Contact : vlc.enversdeparis@gmail.com
Responsable : Noa Farchi
La commission d’organisation : Andrea Castillo, Jorge Mourao, Ceylin Ozcan, Karine Vincent et Jérémie Wiest.
Vecteur Psychanalyse et littérature
Édito février 2025
Le travail de Rosana Montani a précisé la fonction de coupure et de fixation du symbolique en tant que la coupure est ce qui « instaure dans la vie de l’homme la présence même du langage 1 » et que ce que le signifiant fait surgir, il « l’arrête comme une chose fixe à travers tout flux de transformations possibles 2 ». Notre vecteur poursuivra son avancée sur l’opération de la coupure signifiante en mettant en lumière ses liens avec la pulsion. Pour déplier comment la coupure signifiante permet d’engendrer « le monde du sujet qui parle 3 », Françoise Burlot et Valérie Chevassus nous présenteront leurs lectures des chapitres V et VI du Séminaire L’Angoisse de Lacan. Leur travail nous permettra de dégager précisément ce qui relie la coupure signifiante à l’objet cause du désir et de rendre compte de la façon dont Chantal Thomas use de cette opération articulant le symbolique et le réel pour produire son écriture de son ouvrage Comment supporter sa liberté 4.
Si la recherche du vecteur Psychanalyse et Littérature vous intéresse et que vous désirez l’enrichir de vos questions et de vos trouvailles, contacter M.-C. Baillehache à : litterature@enversdeparis.org
1 Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 325
2 Ibid., p. 324-325.
3 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller Paris, Seuil, 2004, p. 92.
4 Thomas C., Comment supporter sa liberté, Paris, éd. Rivages poche, 2000.
Vecteur Le corps, pas sans la psychanalyse
Édito octobre 2025
Prochaine rencontre : 8 octobre à 20h30, au 76 rue des Saints-Pères.
Membres du vecteur : Geneviève Mordant, Pierre-Yves Turpin, Guido Reyna, Martine Bottin, Isabelle Lebihan, Marie Faucher-Desjardins, Ana Dussert, Anne-Marie Rieu-Foucault, Baptiste Jacomino.
Responsable : Baptiste Jacomino
Contact : corpsy@enversdeparis.org
Vecteur Psynéma
Édito février 2025
 La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film Gens de Dublin (The Dead) de John Huston.
La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film Gens de Dublin (The Dead) de John Huston.Projection prévue le samedi 4 octobre à 14h00 au Patronage Laïque Jules Vallès, 72 Av. Felix Faure – Paris 15e.
Discussion qui sera animée par Élisabeth Gurniki (membre de l’ECF et du vecteur Psynéma).
GENS DE DUBLIN (THE DEAD), film de John Huston (1987), avec Anjelica Huston et Donal McCann.
Le dernier film de John Huston, The Dead, sorti six mois après sa mort, couronne sa carrière de réalisateur en 1986. Il s’agit d’une adaptation et interprétation de la dernière nouvelle – The Dead – du recueil « Dubliners » de James Joyce publié en 1914.
Dans le huis-clos d’un bal annuel à la période de Noël, il donne vie aux personnages de Joyce avec une chaleur et une tendresse teintées d’humour. Il insuffle du désir aux Dubliners que Joyce avait décrit minutieusement sur un mode naturaliste teinté d’ironie. Il fait résonner la poésie et la musique gaëliques avec des échos du conflit insulaire entre la culture britannique et la religion catholique.
Pour clôturer le bal il suit le glissement de Joyce dans the stream of consciousness à la fin de la nouvelle : la chaleur de la fête s’éteint dans les rues de la ville enneigée, avec le retour de Gabriel et Gretta à leur chambre d’hôtel. Dans cette scène finale Huston s’éloigne plus précisément de la mélancolie de l’auteur en interprétant le monologue de Gabriel du côté de la nostalgie quand Gretta s’absente dans son sommeil.
Là où, chez Joyce, Gabriel est happé par la mort dans les souvenirs de la femme avec qui il fait Un, pour Huston, rêve, perte et nostalgie se jouent au champ de l’Autre.
Programmation 2025-2026, en partenariat avec le Patronage Laïque sur le site : (entrée libre sur réservation dans la rubrique « ciné-débat »)
Programmation 2025 en partenariat avec le cinéma Les 7 Parnassiens sur le site « Multiciné » avec les liens pour l’achat d’un billet.
Prochaine réunion pour discuter du film de Kenji Mizoguchi Les musiciens de Gion (projection prévue au cinéma Les 7 Parnassiens le 27 nov.) Date de la réunion non encore fixée.
Responsables du vecteur Psynéma : Marie Majour et Leila Touati.
Nous contacter à : vecteur.psynema@gmail.com
Vecteur Théâtre
Édito octobre 2025
 Le vecteur Théâtre et psychanalyse organise une rencontre, le dimanche 19 octobre à 15h, avec Éric Feldman, l’auteur et interprète de sa pièce, On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie.
Le vecteur Théâtre et psychanalyse organise une rencontre, le dimanche 19 octobre à 15h, avec Éric Feldman, l’auteur et interprète de sa pièce, On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie.
Philippe Benichou sera notre invité pour débattre avec Éric Feldman à l’issue de la représentation.
Les places sont disponibles sur la billetterie du site du Théâtre de La Porte Saint- Martin, avec le code promo « ENVERSPETANQUE », qui vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 23 euros au lieu de 30 euros.
Vous pouvez également réserver vos places par téléphone au 01.42.08.00.32 en précisant le code avantage.
Responsable du vecteur : Hélène de La Bouilleri
Contact : theatreetpsychanalyse@gmail.com
Vecteur Clinique et addictions
Édito février 2025
Le vecteur Clinique & Addictions reprendra ses travaux dès le 15 octobre
prochain, sous la houlette de ses deux nouvelles responsables, Mathilde Braun et Coralie Haslé. Le thème de l’année : « Créations ».
Les conversations ont lieu les mercredis : 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril, 21 mai et 17 juin.
REVUE HORIZON
Édito février 2025
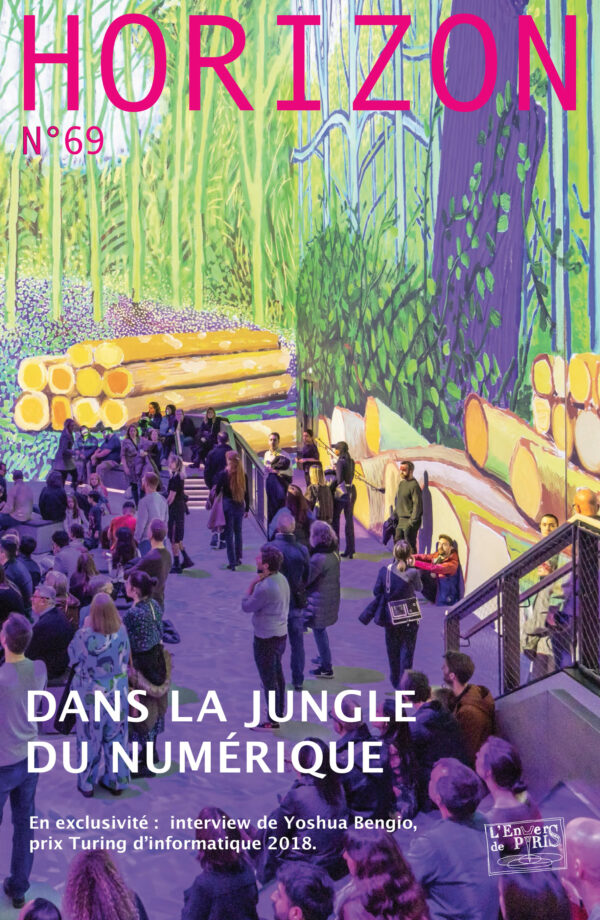 Le dernier numéro de notre bulletin, Horizon 69 est disponible à la librairie de l’ECF.
Le dernier numéro de notre bulletin, Horizon 69 est disponible à la librairie de l’ECF.
Édito février 2025
Nous vous souhaitons un très beau mois d’octobre et nous vous attendons aux nombreux évènements de L’Envers de Paris.
Cinzia Crosali,
directrice de L’Envers de Paris.

 Ce dimanche 22 juin après-midi, parmi les rayonnages de la librairie Tschann et les tableaux de Fred Hommel, une petite foule se pressait pour accueillir la sortie de l’ouvrage de Mickaël Guyader : Suzanne Hommel : une vie de désir
Ce dimanche 22 juin après-midi, parmi les rayonnages de la librairie Tschann et les tableaux de Fred Hommel, une petite foule se pressait pour accueillir la sortie de l’ouvrage de Mickaël Guyader : Suzanne Hommel : une vie de désir 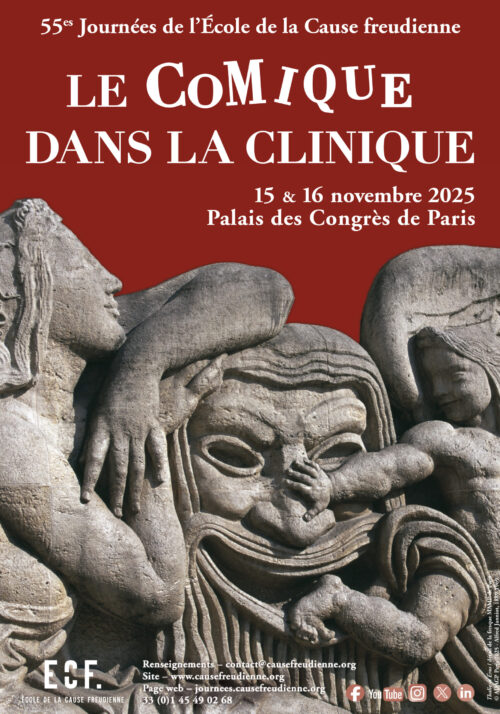
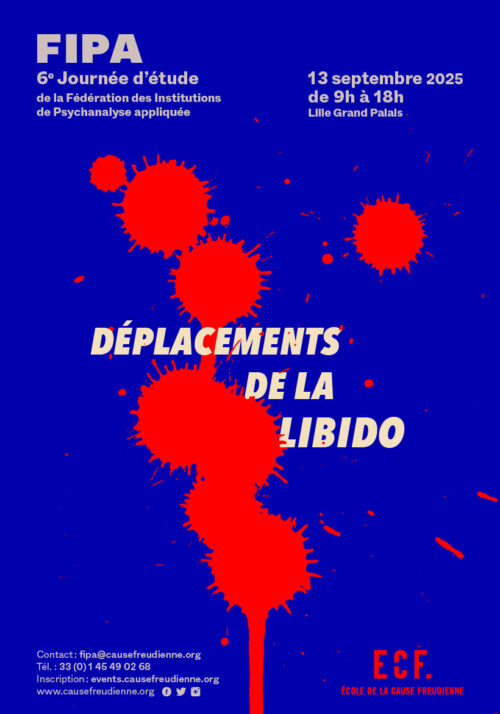
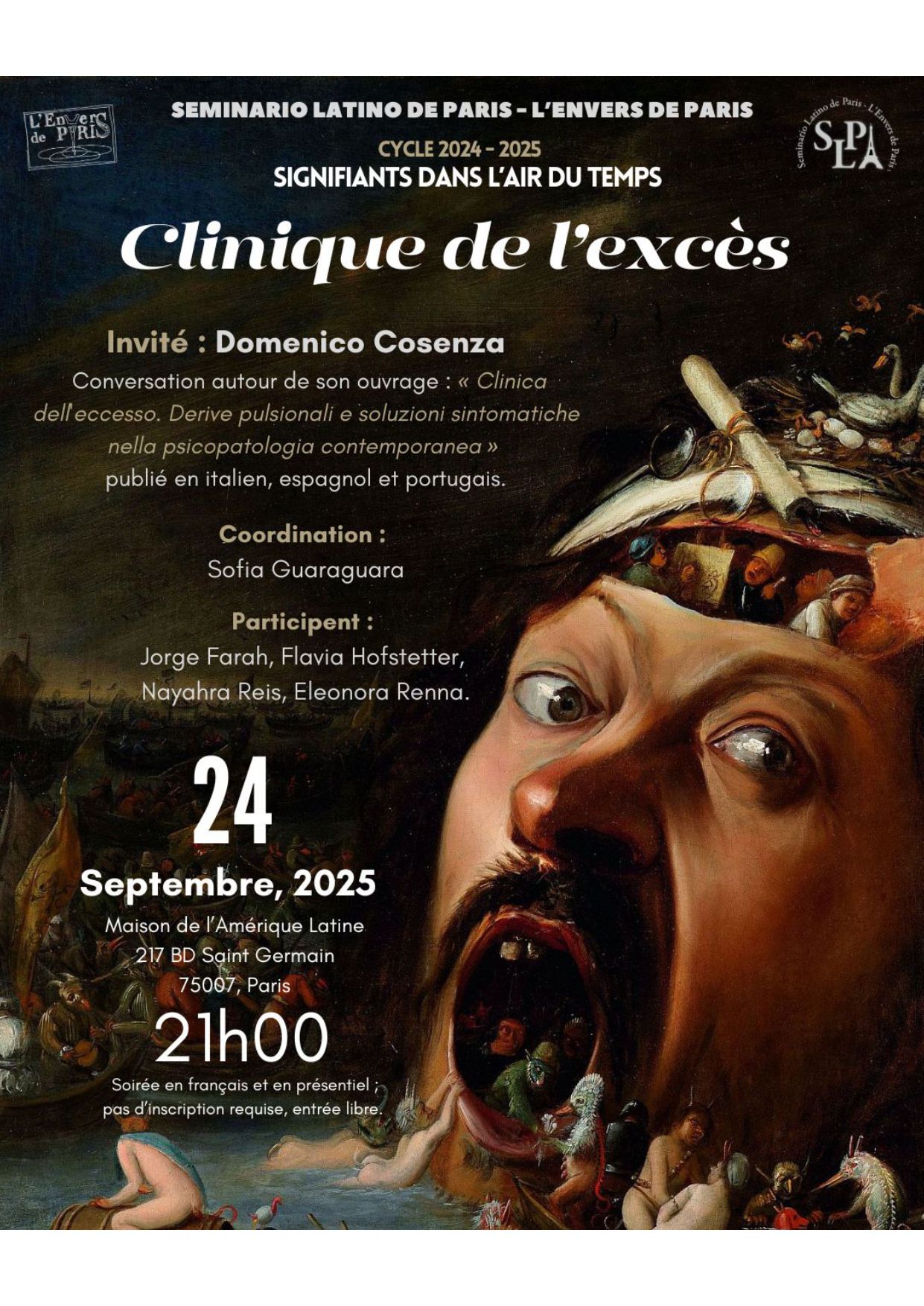

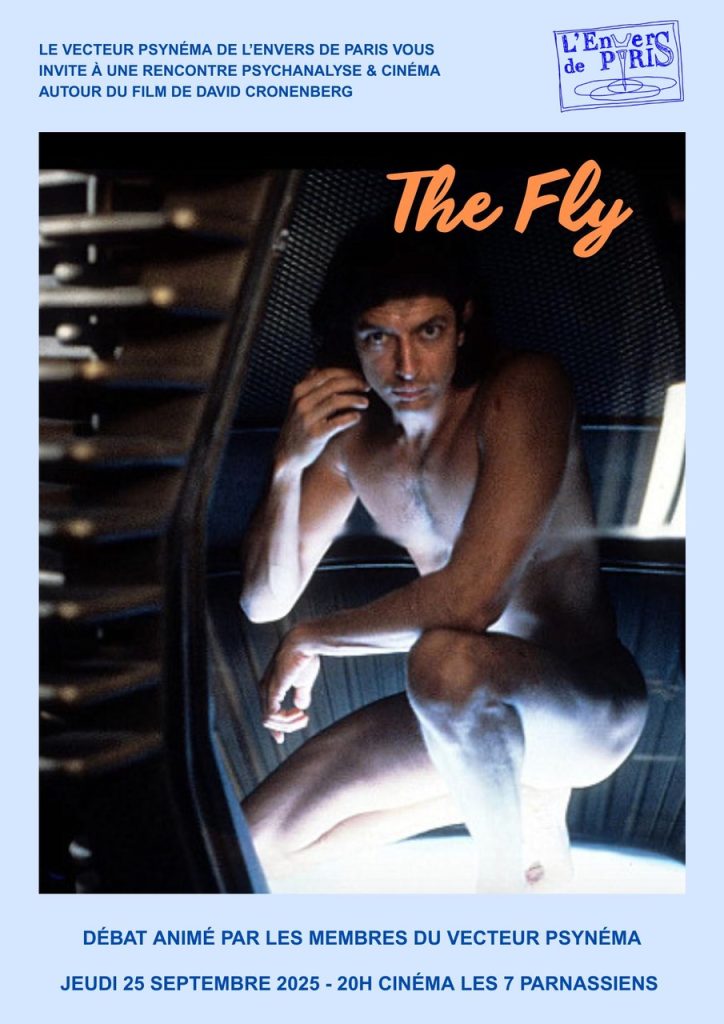 La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film
La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film