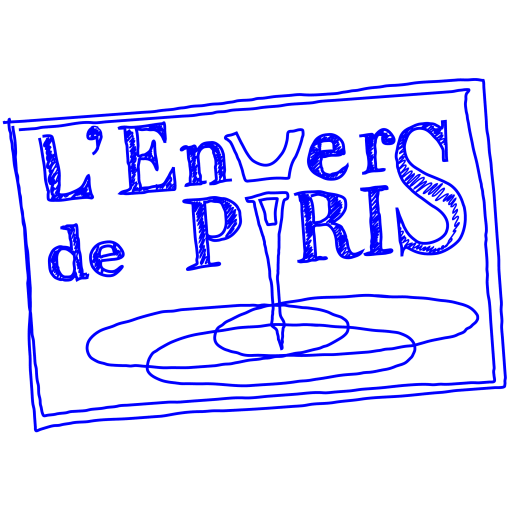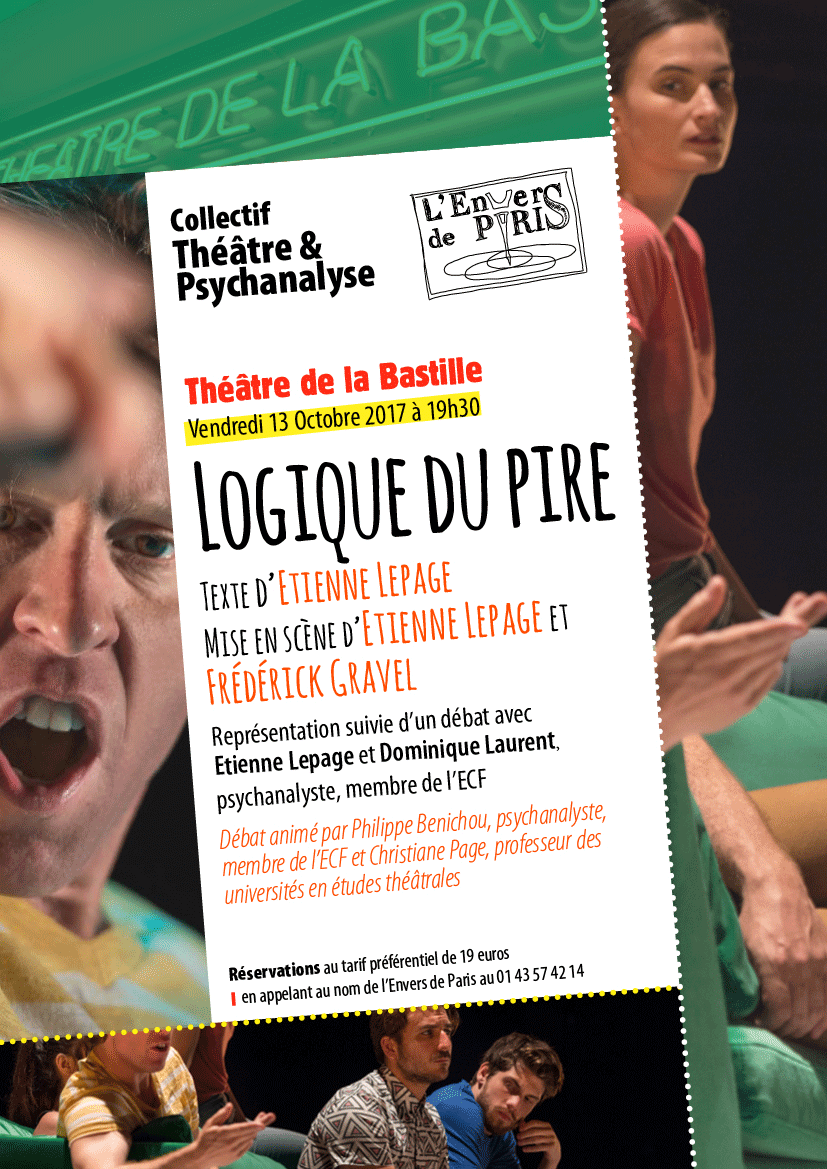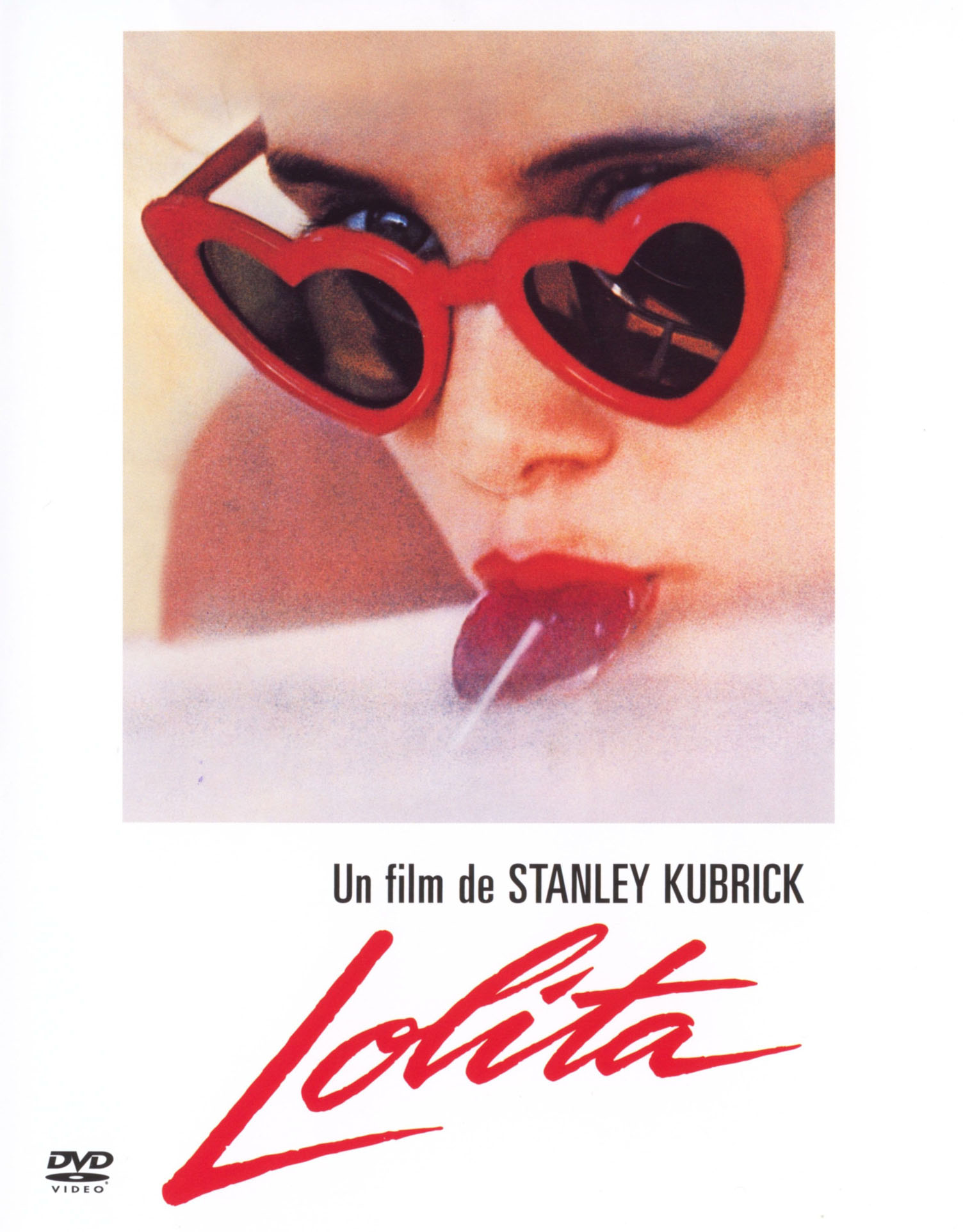Pour qu’advienne la parole de l’enfant. Ce que nous enseigne “La Nuit du Chasseur de Charles Laughton”.
Pour qu’advienne la parole de l’enfant. Ce que nous enseigne “La Nuit du Chasseur de Charles Laughton”.
par Baptiste Jacomino
John se tait. Il a juré à son père qu’il ne trahirait pas son secret. Avec sa sœur, il fuit en silence sur une petite barque le long du fleuve noir, jusqu’à ce qu’un matin, Rachel Cooper les réveille et les recueille.
Le soir, elle raconte des récits bibliques aux enfants. John se reconnaît dans la figure de Moïse livré au hasard du fleuve. Il se met à parler en se soutenant de cette Parole. Il y trouve de quoi relire sa propre histoire.
En recourant au récit, Rachel prend le contre-pied du faux prophète qui poursuit les enfants. Lui cherchait à faire cracher le morceau à John. Rachel lui permet de parler en ne le lui demandant pas. Le mythe biblique est un mi-dire qui permet à l’enfant de sortir de l’alternative dans laquelle il est enfermé : tout dire ou ne rien dire.
Rachel raconte l’enfance de Moïse dans la posture de ma mère L’Oye : assise sur une chaise et entourée d’enfants. Ce n’est là qu’un conte, semble-t-on nous dire. Sans doute est-ce ce qui autorise à y apporter si aisément des changements. Quand John dit à Rachel qu’il y a deux rois dans l’histoire, elle commence par le corriger, mais elle cède rapidement : oui, c’est vrai, il y en a deux. « Ne pas errer, dit Alexandre Stevens, c’est accepter de se faire dupe de semblants. […] Ce qu’il s’agit d’obtenir chez les enfants décrochés de l’Autre et de ses semblants, ce n’est pas qu’ils rentrent dans le rang, qu’ils obéissent à la règle, qu’ils se soumettent à la loi, c’est qu’ils commencent à se faire dupe de l’un ou l’autre semblant. C’est par cette douceur qu’il s’agit de procéder : les introduire au semblant. » 1 L’histoire de la Bible que Rachel conte est de cet ordre-là : une opération de raccrochage aux semblants après une si longue errance sur le fleuve noir.
« Rencontrer un Autre qui le croit sur son trauma est un évènement dans la vie d’un sujet, écrit Clotilde Leguil. Un évènement qui peut tout changer. Car, enfin, une porte s’ouvre où il peut dire sans être jugé sur la conformité de ses dires avec la réalité, mais en étant accueilli depuis la vérité que sa parole tente d’articuler, la vérité de ce qui s’est produit pour lui, et pour lui seul. » 2 John n’a pas été cru. Sa mère, sous l’emprise du faux prêcheur, ne l’entendait pas. Avec Rachel, il rencontre enfin quelqu’un qui le croit, au sens où l’attention qu’elle lui porte vise à favoriser sa parole et à accueillir la vérité qui convient, « pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas » 3.
Rachel ne se contente pas d’écouter, de croire et de raconter. Elle fouette. Rien qui fasse mal aux enfants. Mais il n’en reste pas moins que, quand elle les découvre endormis dans une barque, comme ils ne veulent pas la suivre, elle arrache quelques tiges pour s’en faire une badine et elle fouette John et Pearl pour qu’ils avancent. John a été bercé jusqu’au sommeil par le cours de la rivière, par le chant répétitif et lointain du prêcheur et par le monde aux allures oniriques au sein duquel il voguait. Autour de lui, les siens dormaient. Rachel interrompt le cours de cette jouissance par une nouvelle jouissance, inattendue, un peu violente. À la manière de la scansion, dont Lacan dit qu’« elle ne brise le discours que pour accoucher la parole » 4, Rachel brise le cours du discours du prêcheur, le cours de son chant et le cours de l’eau pour accoucher la parole de John.
C’est une condition nécessaire, quoique non suffisante, pour qu’advienne une parole du sujet et non une parole sous hypnose, un discours de somnambule. Tandis que le faux prêcheur hypnotise les foules par ses récits épiques, ses prêches enthousiastes et ses chants envoûtants, Rachel évite toute séduction par un abord sec et légèrement brutal. C’est la sécurité dont John a besoin pour parler : être délivré de toute tentative de suggestion, d’emprise, de mainmise. Aux mains toujours trop proches du faux prêcheur succèdent les mains frêles de Rachel, tenues à distance par les longs instruments qu’elle saisit : une tige ou un fusil.
À l’heure où la parole de l’enfant est souvent traitée comme une ressource infiniment disponible qu’il suffirait de laisser jaillir, La Nuit du Chasseur nous enseigne qu’il faut parfois permettre à cette parole d’advenir par les détours paradoxaux du silence, du mi-dire ou de l’interruption.
1. Stevens A., « Un cadre ou un bord ? », La petite Girafe, n°5, 2019, p. 150.
2. Leguil C., Céder n’est pas consentir, Paris, PUF, 2021, p. 142-143.
3. Lacan J., « Télévision » (1973), Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 8.
4. Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 316.