Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le mois d’octobre s’ouvre sous le signe d’initiatives vivantes et porteuses, à L’Envers de Paris, ainsi qu’avec une intensification de la préparation des Journées 55 de l’École de la Cause freudienne qui se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains, au Palais des Congrès de Paris, sous le titre : Le comique dans la clinique.
Édito décembre 2025
Édito novembre 2025
Édito octobre 2025
Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le mois d’octobre s’ouvre sous le signe d’initiatives vivantes et porteuses, à L’Envers de Paris, ainsi qu’avec une intensification de la préparation des Journées 55 de l’École de la Cause freudienne qui se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains, au Palais des Congrès de Paris, sous le titre : Le comique dans la clinique.
Édito novembre 2025
Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le mois d’octobre s’ouvre sous le signe d’initiatives vivantes et porteuses, à L’Envers de Paris, ainsi qu’avec une intensification de la préparation des Journées 55 de l’École de la Cause freudienne qui se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains, au Palais des Congrès de Paris, sous le titre : Le comique dans la clinique.
Édito octobre 2025
Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le mois d’octobre s’ouvre sous le signe d’initiatives vivantes et porteuses, à L’Envers de Paris, ainsi qu’avec une intensification de la préparation des Journées 55 de l’École de la Cause freudienne qui se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains, au Palais des Congrès de Paris, sous le titre : Le comique dans la clinique.
Édito septembre 2025
Le mois de juin s’ouvre à L’Envers de Paris avec nombreux évènements, en lien avec notre sujet de recherche : Fantasmes contemporains du corps. Nous poursuivons notre travail sur ce thème, en nous appuyant sur la notion du fantasme, dans sa double fonction : d’une part, faire barrière à la jouissance, et d’autre part, permettre de récupérer des bribes de jouissance, comme on peut le voir dans la construction que Freud fait du fantasme…
Édito décembre 2025

Édito février 2025
Cinzia Crosali,
directrice de l’EdP
Chers membres et ami(e)s de L’Envers de Paris,
Le moment est enfin arrivé ! Dans quelques jours se tiendra le grand évènement organisé par notre association en collaboration avec nos amis de l’ACF-ÎdF, intitulé : Fantasmes contemporains du corps. Vous trouverez ci-dessous l’affiche, l’argument ainsi que le programme de cette journée exceptionnelle, dédiée à l’exploration des fantasmes du corps à l’ère de l’intelligence artificielle, des transitions de genre, des mirages du transhumanisme, ainsi que des avancées remarquables de la science et de la technique.
Vous êtes déjà nombreux à avoir confirmé votre présence. Il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire et nous rejoindre, le samedi 6 décembre, au 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris.

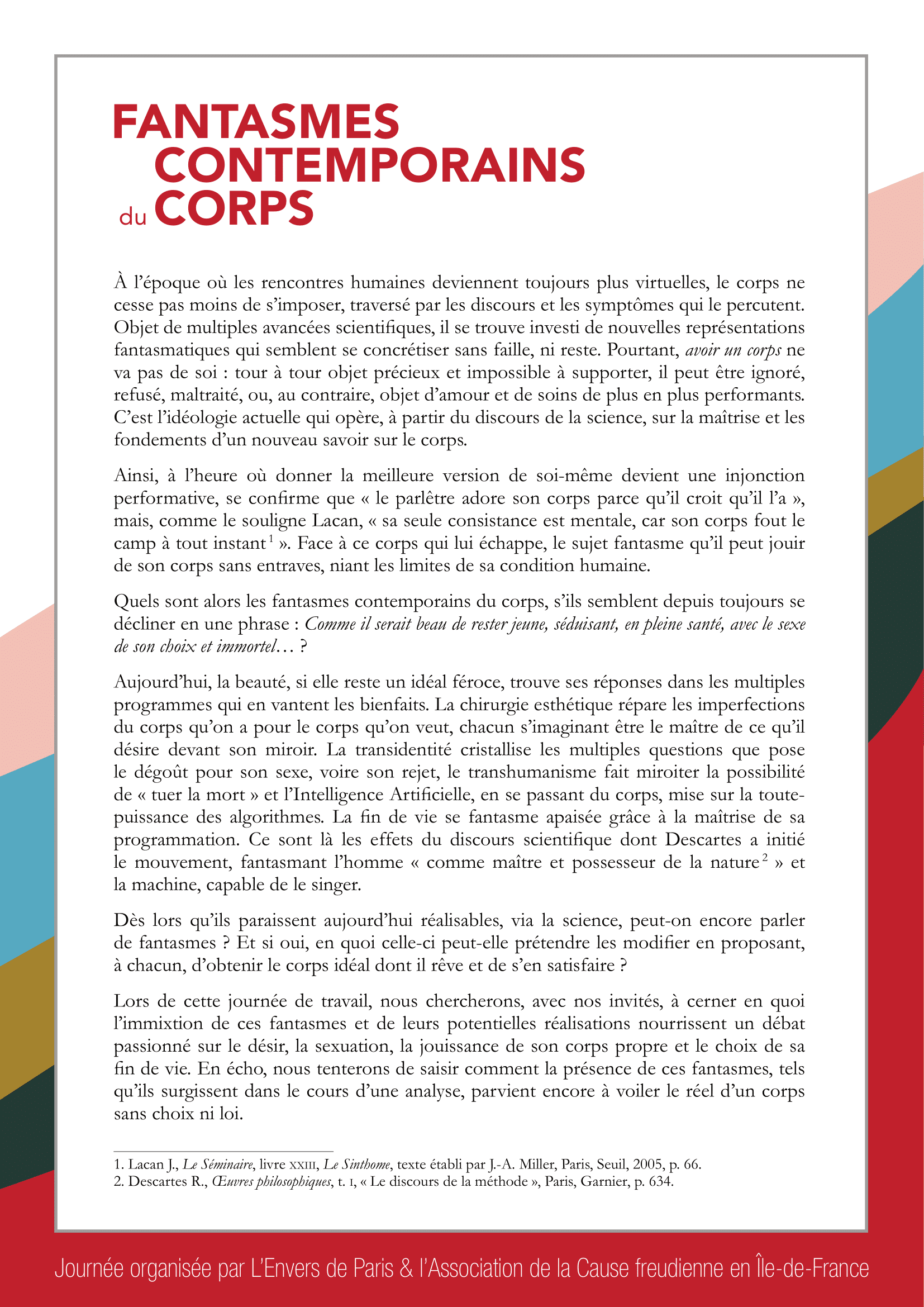
Édito octobre 2025
La parole maintenant à la déléguée des Cartels pour L’Envers de Paris, Stéphanie Lavigne, et aux responsables des vecteurs :
Cartels
Édito octobre 2025
Notre dernière soirée de rentrée des cartels, organisée sous le titre, « Comique dans la clinique, lecture en cartel », a permis la formation de huit nouveaux cartels. Cet événement annuel est l’occasion d’échanges à la fois sérieux et joyeux autour d’un franchissement du « je ne veux rien savoir », vers un désir qui produit des bouts de savoir, élaborés en cartel.
Je vous propose de découvrir le texte de Nayahra Reis, qui nous fait part des moments forts de cette belle soirée : Cliquez ici
Contact : Stéphanie Lavigne enversdeparis-cartels@causefreudienne.org
Vecteur Lectures freudiennes
Édito octobre 2025
Dans les dernières pages de son article « Ein Kind wird geschlagen – un enfant est battu », Freud fait trois assertions :
1/ S’il n’y a qu’une seule libido, les mouvements pulsionnels ne sont pas pour autant sexués, la première théorie de la bisexualité psychique issue du travail avec Wilhem Fliess réapparaît ici.
2/ La théorie de la protestation virile d’Adler se démontrerait plutôt dans ce fantasme d’être battu.
3/ C’est chez la fille qu’elle trouve pleinement son effectuation.
Citons Freud dans notre traduction :
« Au fond nous voyons seulement ceci que, chez les individus masculins et féminins se produisent des mouvements pulsionnels aussi bien masculins que féminins et que ceux-ci peuvent pareillement par refoulement devenir inconscients. La théorie de la protestation virile semble s’affirmer bien mieux face à l’épreuve des fantasmes d’être battu. Chez le garçonnet comme chez la petite fille le fantasme d’être battu correspond à une position féminine, donc à une installation sur la ligne féminine, et les deux sexes s’empressent de se détacher de cette position par le refoulement du fantasme. Toutefois la protestation virile ne semble aboutir à un plein succès que chez la fille, ici se construit un exemple vraiment idéal de l’effectuation de la protestation virile. »
Nous nous retrouverons chez Susanne Hommel, le mercredi 3 décembre à 21h. Contact : lectures-freudiennes@enversdeparis.org
Seminario Latino
Édito février 2025
 En décembre, le Seminario Latino de L’Envers de Paris poursuit son cycle d’études, « Signifiants dans l’air du temps » et prépare sa dernière soirée de l’année. Celle-ci aura lieu le mercredi 3 décembre en présence d’Adriana Campos comme invitée et sera consacrée au thème de la liberté et de l’autonomie.
En décembre, le Seminario Latino de L’Envers de Paris poursuit son cycle d’études, « Signifiants dans l’air du temps » et prépare sa dernière soirée de l’année. Celle-ci aura lieu le mercredi 3 décembre en présence d’Adriana Campos comme invitée et sera consacrée au thème de la liberté et de l’autonomie.
La quête d’autonomie en tant qu’idéal ne date pas d’hier. Le concept est connu depuis la Grèce antique, inaugurant l’idée d’autonomie politique de la Cité. L’autonomie s’orientera par la suite vers l’individu, notamment à partir de Kant et du siècle des Lumières, rendant chacun responsable de se gouverner lui-même.
Cette idée, d’abord pensée comme une émancipation, s’est transformée en norme sociale. Aujourd’hui, l’État, représenté par l’Éducation Nationale, les établissements de santé ou encore par les services d’accompagnement socio-professionnel, pousse les individus à devenir « autonomes » : chacun doit être capable d’assumer seul ce qui relevait autrefois des autorités ou de la collectivité.
L’impératif contemporain d’autonomie reconfigure notre rapport à l’Autre : la solitude se mue en isolement et les mouvements d’émancipation des années soixante à soixante-dix se réduisent à des revendications individuelles ou communautaires. Une confusion entre liberté et autonomie nous amène à nous poser la question de notre lien à l’Autre.
Sommes-nous passés de l’aspiration à l’injonction de l’autonomie ?
Comment penser cette injonction à l’autonomie au regard de la psychanalyse ? L’autonomie telle qu’elle est valorisée aujourd’hui favorise-t-elle un renforcement du surmoi contemporain ? Comment cet impératif d’autonomie fait-il symptôme dans notre clinique ?
Responsables : Flavia Hofstetter et Nayahra Reis
Contact : seminario-latino-de-paris@enversdeparis.org
Vecteur Lectures cliniques
Édito février 2025
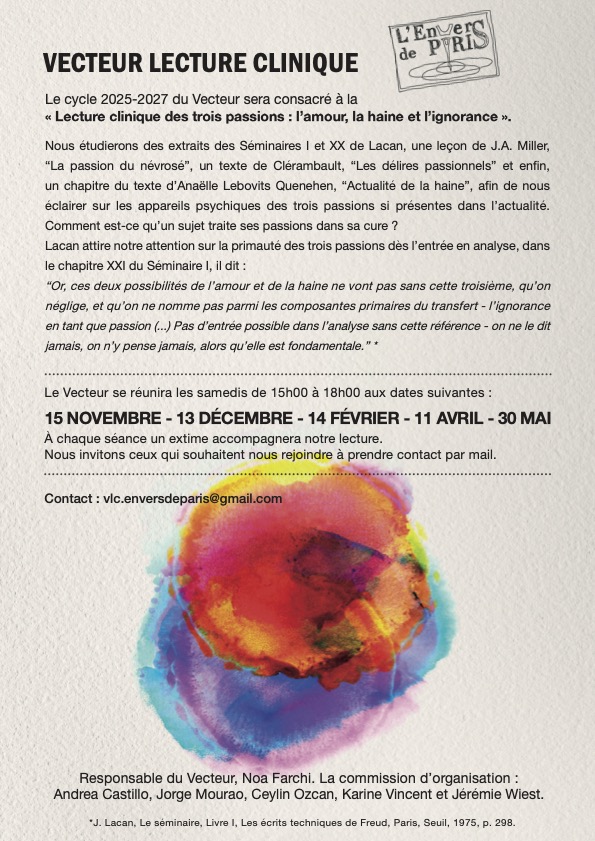 La prochaine réunion du vecteur lectures cliniques, en présence de Ève Miller-Rose, porte sur le texte de Jacques-Alain Miller « La passion du névrosé 1 ». Lors de la réunion du vecteur en novembre, avec Camilo Ramirez, nous avons lu et discuté des extraits du Séminaire I de Jacques Lacan. Dans ses leçons XXI et XXII, Lacan évoque les trois passions de l’être – l’amour, la haine et l’ignorance comme une triade constituant trois modalités du transfert. L’accent qu’il y donne à la passion de l’ignorance pour « la réalisation de l’être », son rapport à la fonction de la parole, et de ce fait, comme déterminant pour l’entrée en analyse est inattendu. Nous nous sommes penchés sur ces éléments, les travaux de Mara Volpi, d’Isabelle Servant et le cas de Margot Della Corte, qui ont donné des appuis essentiels pour avoir une saisie sur ce qu’est « la passion de l’ignorance ».
La prochaine réunion du vecteur lectures cliniques, en présence de Ève Miller-Rose, porte sur le texte de Jacques-Alain Miller « La passion du névrosé 1 ». Lors de la réunion du vecteur en novembre, avec Camilo Ramirez, nous avons lu et discuté des extraits du Séminaire I de Jacques Lacan. Dans ses leçons XXI et XXII, Lacan évoque les trois passions de l’être – l’amour, la haine et l’ignorance comme une triade constituant trois modalités du transfert. L’accent qu’il y donne à la passion de l’ignorance pour « la réalisation de l’être », son rapport à la fonction de la parole, et de ce fait, comme déterminant pour l’entrée en analyse est inattendu. Nous nous sommes penchés sur ces éléments, les travaux de Mara Volpi, d’Isabelle Servant et le cas de Margot Della Corte, qui ont donné des appuis essentiels pour avoir une saisie sur ce qu’est « la passion de l’ignorance ».
Nous allons poursuivre cette étude, le 13 décembre 2025, avec les commentaires d’Athina Georgaraki et de Vassilis Plageras sur « La passion du névrosé » de J.-A. Miller et autour d’un cas clinique que présente Aline Bemfica.
1. J.-A. Miller, La Cause du désir, n° 93, septembre 2016, p. 112-122.
Contact : vlc.enversdeparis@gmail.com
Responsable : Noa Farchi
La commission d’organisation : Andrea Castillo, Jorge Mourao, Ceylin Ozcan, Karine Vincent et Jérémie Wiest.
Vecteur Psychanalyse et littérature
Édito février 2025
Pour Chantal Thomas, « Le bord de l’eau – cette marge de contact où sable et eau s’entremêlent – est indissociable de [son] sentiment de l’existence ». Cette présence toujours là et continuellement changeante du littoral près duquel elle a passé son enfance et qui suffisait à sa jouissance de corps sans qu’elle rêve d’un ailleurs, est ce qui ne cesse pas de lui donner le gout d’écrire et de recommencer autrement. Et si pour elle, « on nage comme on écrit » c’est qu’elle trouve dans ces deux activités « un bonheur du corps » et « une incroyable puissance poétique du langage1 ». A partir du plaisir solitaire et exclusif pour la nage de sa mère et du gout pour les marches silencieuses de son père taciturne qui la constituent, Chantal Thomas assure son écriture en passant du pôle du silence au pôle de l’instant.
C’est ce que notre vecteur éclairera et démontrera par ses lectures partagées de Souvenirs de la marée basse 2 et de De sable et de neige 3.
Le vecteur Psychanalyse et Littérature se réunira, le lundi 22 décembre à 20 h, par Zoom.
1. Thomas C., L’étreinte de l’eau, Paris, éd. Artaud, 2023, p. 9-57.
2. Thomas C., Souvenirs de la marée basse, Paris, Seuil, 2017.
3.Thomas C., De sable et de neige, Paris, éd. Mercure de France, 2021.
Le vecteur Psychanalyse et Littérature reste ouvert.
Contact : M.-C. Baillehache : 0642233703, litterature@enversdeparis.org
Vecteur Le corps, pas sans la psychanalyse
Édito octobre 2025
Lors de notre réunion de novembre nous avons reçu Luc Schuhmacher (https://lucschuhmacher.com/), artiste qui nous a présenté certains de ses travaux. En écho au thème de la suture qui nous occupe cette année, nous avons notamment été attentifs à trois pièces. La première était constituée d’un « livre-monstre » intitulé Histoire sans anesthésie qu’on ne peut pas ouvrir parce que les pages en ont été cousues. D’autres pièces relèvent de ce que Luc Schuhmacher appelle des « couchés sur le papier ». Ce sont des écrits illisibles notés dans le noir qui s’apparentent à des lignes étroitement liées entre elles. La troisième pièce est sonore : elle est enregistrée en « tourné-monté » de sorte que l’ensemble est à la fois décousu et cousu. En nous parlant, il arrive que Luc Schuhmacher dise : « il faut que je retrouve le lien » : de ça et du reste nous pourrons rediscuter lors d’une nouvelle rencontre à son atelier dans quelques mois.
Prochaine rencontre : 2 décembre à 20h30 au 76 rue des Saints-Pères. La rencontre portera sur un texte d’Éric Laurent sur la suture.
Membres du vecteur : Geneviève Mordant, Pierre-Yves Turpin, Guido Reyna, Martine Bottin, Marie Faucher-Desjardins, Jaison Karukuttiharan, Ana Dussert, Anne-Marie Rieu-Foucault,Marilena Moustaka, Baptiste Jacomino (coordinateur).
Responsable : Baptiste Jacomino
Contact : corpsy@enversdeparis.org
Vecteur Psynéma
Édito février 2025
 La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film LES INNOCENTS de Jack Clayton.
La prochaine projection organisée par le vecteur Psynéma, suivie d’un débat, sera consacrée au film LES INNOCENTS de Jack Clayton.
Projection prévue le samedi 13 décembre à 14h au Patronage Laïque Jules Vallès : 72, Av. Felix Faure, Paris 15e.
Les Innocents, film de Jack Clayton (1961), avec Deborah Kerr et Michael Redgrave.
Les Innocents est un film britannique réalisé par Jack Clayton, adapté de la célèbre nouvelle d’Henry James, Le Tour d’écrou.
Engagée par un riche célibataire (Michael Redgrave) pour s’occuper de sa nièce Flora et de son neveu Miles, devenus orphelins, Miss Giddens (Deborah Kerr) arrive au manoir de Bly House, en Angleterre. L’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, dans un monde puritain qui n’est pas sans laisser transparaître une violence du désir à peine contenue.
Miss Giddens, s’occupant tendrement des deux enfants, pressent néanmoins très vite – d’abord imperceptiblement – qu’une atmosphère inquiétante règne dans le labyrinthique et spacieux Bly House : un regard fantomatique et évanescent semble en effet la fixer de nulle part. Elle se persuade peu à peu que les deux enfants sont possédés par les esprits malfaisants de l’ancienne gouvernante et de son amant, le valet Peter Quint, morts depuis peu. Commence alors une spirale de tourments et de vertiges…
Ce remarquable film est sans doute la meilleure adaptation cinématographique de la nouvelle d’Henry James. S’y nouent singulièrement la vie, la mort et la perte de l’innocence, dont Freud s’est avisé avec son « concept » de pulsion de mort. Dans un esprit un peu joycien nous sommes, avec ce film, transportés dans un lieu de rencontre impossible, où les morts visitent les vivants pour leurs délivrer leur énigmatique message…
Responsables du vecteur Psynéma : Marie Majour et Leila Touati.
Nous contacter à : vecteur.psynema@gmail.com
Vecteur Théâtre
Édito octobre 2025
 Le vecteur Théâtre et psychanalyse a eu le plaisir de rencontrer Éric Feldman, dans le cadre de sa pièce : « On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie », le 19 octobre dernier au Théâtre du Petit Saint-Martin. Ce fut une rencontre enseignante, permettant de cerner les ressorts et maniements du comique dans la transmission du lourd héritage de la Shoah et ce, dans la perspective des 55e Journées de l’ECF. Le comédien et interprète a également pu témoigner de l’articulation entre sa création et son expérience de la psychanalyse.
Le vecteur Théâtre et psychanalyse a eu le plaisir de rencontrer Éric Feldman, dans le cadre de sa pièce : « On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie », le 19 octobre dernier au Théâtre du Petit Saint-Martin. Ce fut une rencontre enseignante, permettant de cerner les ressorts et maniements du comique dans la transmission du lourd héritage de la Shoah et ce, dans la perspective des 55e Journées de l’ECF. Le comédien et interprète a également pu témoigner de l’articulation entre sa création et son expérience de la psychanalyse.
Bord de scène avec Éric Feldman, interviewé par Eva Carrere Naranjo et Philippe Benichou
Le vecteur a aussi organisé un bord plateau le 23 novembre à l’issue de la représentation d’ Oh les Beaux jours de Beckett, avec le metteur Alain Françon et le comédien Alexandre Ruby. La discussion fut vivante et passionnante nous montrant à quel point l’écriture de Beckett restait inédite encore aujourd’hui. Des ponts entre psychanalyse et théâtre ont ainsi pu se tisser à partir d’une certaine extimité.
Nous organiserons une prochaine rencontre du vecteur en janvier et ce afin de finaliser ensemble la programmation des spectacles de 2026 qui est toujours en cours.
Responsables du vecteur : Hélène de La Bouillerie, Bellanco Olivia et Eva Carrere Naranjo.
Contact : theatreetpsychanalyse@gmail.com
Vecteur Clinique et addictions
Édito février 2025
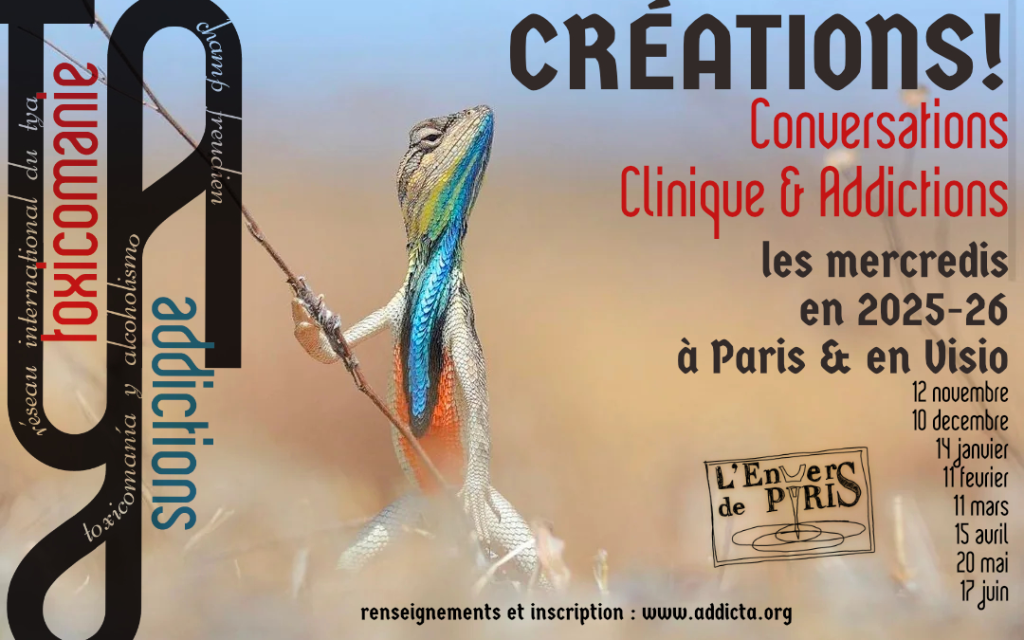 Le vecteur Clinique et Addiction a tenu sa première conversation de l’année en novembre, qui a réuni environ 25 personnes. À partir d’un cas clinique présenté par Mathilde Braun, nous avons lancé le thème de l’année « Créations ! » et proposé comme fil rouge le texte de Jacques-Alain Miller, « le Salut par les déchets ». Pour poursuivre, nous nous retrouverons le 17 décembre avec un cas clinique présenté par Coralie Haslé, texte intitulé « Assonances et métonymies : de l’impasse psychique à l’escabeau », qui mettra en avant la place qu’occupe l’atelier théâtre chez un patient complètement empêché, en donnant une place à sa lalangue.
Le vecteur Clinique et Addiction a tenu sa première conversation de l’année en novembre, qui a réuni environ 25 personnes. À partir d’un cas clinique présenté par Mathilde Braun, nous avons lancé le thème de l’année « Créations ! » et proposé comme fil rouge le texte de Jacques-Alain Miller, « le Salut par les déchets ». Pour poursuivre, nous nous retrouverons le 17 décembre avec un cas clinique présenté par Coralie Haslé, texte intitulé « Assonances et métonymies : de l’impasse psychique à l’escabeau », qui mettra en avant la place qu’occupe l’atelier théâtre chez un patient complètement empêché, en donnant une place à sa lalangue.
Mathilde Braun et Coralie Haslé, co-responsables du vecteur.
REVUE HORIZON
Édito février 2025
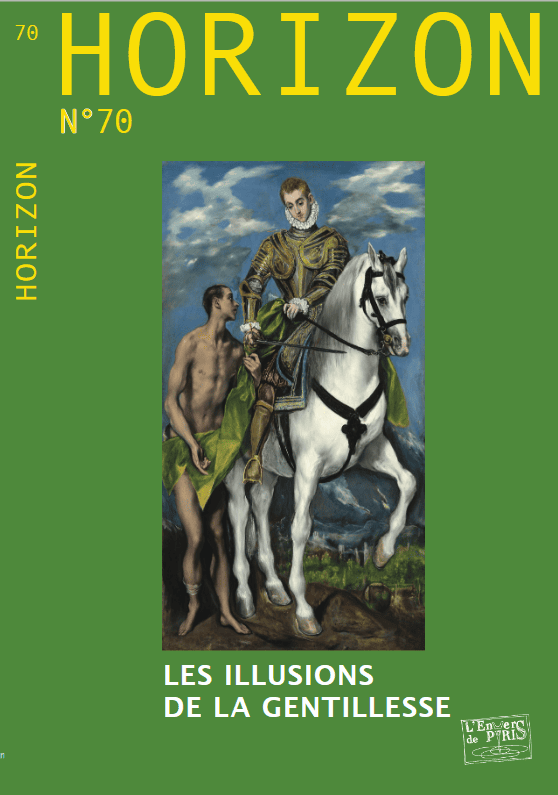 Nous avons le plaisir d’annoncer l’imminente parution du nouveau bulletin : Horizon 70, sous le titre subversif : Les illusions de la gentillesse.
Nous avons le plaisir d’annoncer l’imminente parution du nouveau bulletin : Horizon 70, sous le titre subversif : Les illusions de la gentillesse.
Lisons la présentation de ce numéro d’Agnès Vigué-Camus, rédactrice en chef, de la publication :
« Alors que la méchanceté de l’Autre affleure dans les discours et devient un sujet d’angoisse, – on s’arrache L’heure des prédateurs de Giulino Da Empoli dans les librairies – il peut sembler incongru de s’intéresser aux « illusions de la gentillesse ». Pourtant ce titre dit bien l’époque : une gentillesse en trompe-l’œil, tramée d’empathie, de bienveillance, dont nous sommes accablés. Ne voilà-t-il pas que le consentement des amateurs de pratiques SM doit maintenant être scruté avant et pendant, et que l’accès à des pommades, onguents et autres couvertures doit leur être ménagé ? [1] Toutefois, derrière ces voiles, on distingue quelque chose de plus sombre. L’instant de voir n’est plus qu’un clin d’œil, qui suffit à dissiper l’illusion d’optique. La gentillesse pourrait bien prendre une valeur contraphobique face à l’inquiétude qui s’empare des foules et s’immisce au plus profond des corps. Les appels à venir en aide à son prochain, en effet, n’ont jamais été aussi pressants. L’on constate d’ailleurs que cette exigence se propage dans le domaine social via un certain nombre de pratiques. L’empathie, tant prônée aujourd’hui, suppose une attention, une présence au prochain perçu comme un autre moi-même. Freud rejetait l’idée d’amour du prochain.
Le discours analytique permet-il une certaine clairvoyance à l’égard de quelques des illusions de notre époque ? Ce nouveau numéro d’Horizonpropose au lecteur de s’aventurer dans le vif d’une recherche ».
[1] Cf. l’article de Stella Harrison dans ce numéro.
Édito février 2025
Ce mois de décembre marque la fin de notre mandat. Ces deux années se sont écoulées à une grande vitesse, riches en évènements, en rencontres marquantes, portées par un désir joyeux de savoir et de transmission. Ma première pensée va à la présidente de l’ECF et de L’Envers de Paris, Anaëlle Lebovits-Quenehen, que je remercie pour la confiance qu’elle m’a accordée ; ainsi qu’à la vice-présidente de l’ECF Laura Sokolowsky, pour son écoute attentive et son soutien constant. J’adresse également ma profonde reconnaissance aux membres du bureau : Olivier Miani, trésorier, Chicca Loro, secrétaire et Stéphanie Lavigne, déléguée des cartels, pour leur engagement et leur collaboration tout au long de ces deux années partagées, faites de travail à plusieurs et d’invention pour orienter l’association. Je souhaite souligner particulièrement l’apport précieux d’Olivier Miani, dont l’investissement a largement dépassé les limites de sa fonction.
Un grand merci va aussi aux responsables des vecteurs et des groupes de travail, sans qui L’Envers de Paris n’existerait pas : leur capacité remarquable à fédérer, animer et orienter le désir des adhérents, ainsi qu’à organiser des évènements dans la cité, a été essentielle pour la diffusion et l’étude de la psychanalyse. Je remercie tout autant les responsables des différentes commissions – relecture des textes, diffusion de proximité et sur les réseaux sociaux, gestion des réunions en Zoom.
Je souhaite exprimer mes félicitations et mes remerciements chaleureux à la rédactrice en chef, Agnès Vigué-Camus, ainsi qu’à son équipe, pour l’excellent travail accompli dans la réalisation des numéros 69 et 70 de notre Bulletin Horizon, références majeures par leur qualité rédactionnelle, leur rigueur et leur richesse thématique.
À tous les membres et amis de L’Envers de Paris qui se mobilisent pour animer les évènements et faire vivre l’association, j’exprime ma profonde reconnaissance. Merci également à Franck Ragot et à Éric Le Maire pour leur expertise informatique et graphique.
Enfin, je tiens à remercier toutes les équipes mobilisées pour l’organisation de la journée du 6 décembre prochain : Fantasmes Contemporains du corps. Plus de quarante personnes œuvrent avec générosité pour assurer le succès de cette journée. Un merci particulier à Hélène Bonnaud, notre extime éclairée, et à tous les membres du Cartel de travail.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de décembre riche de moments partagés au sein de notre association, ainsi que de très belles fêtes de fin d’année.
Cinzia Crosali
Directrice de L’Envers de Paris
