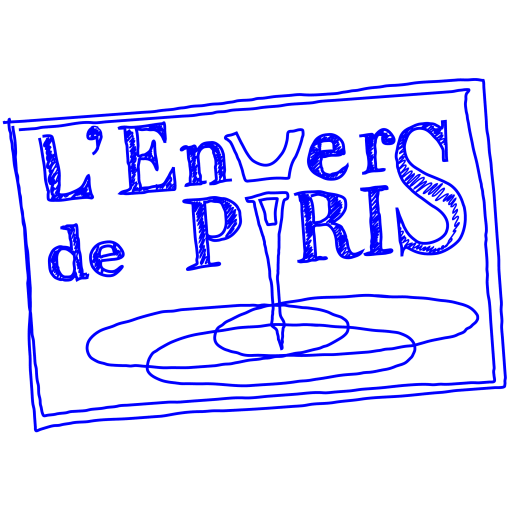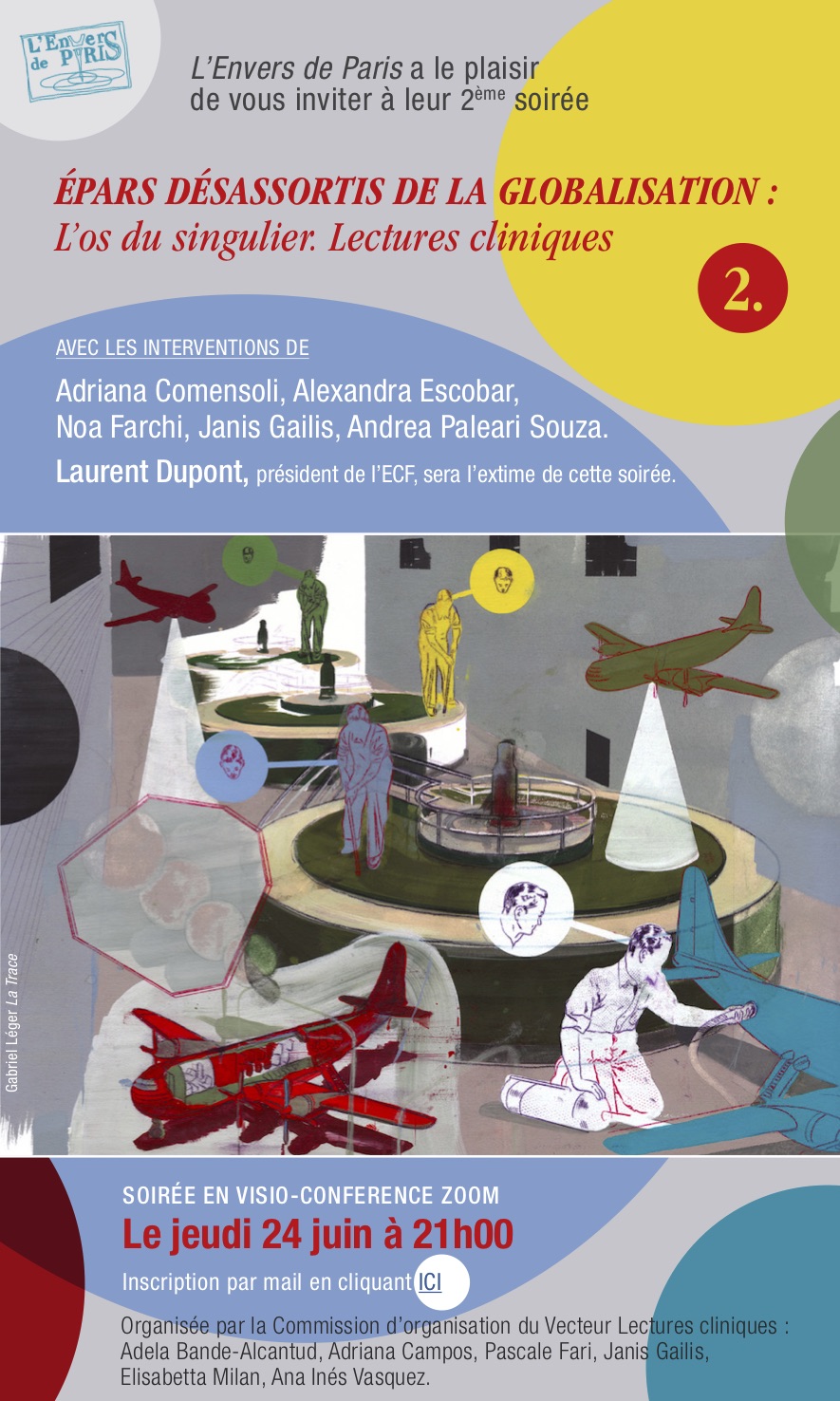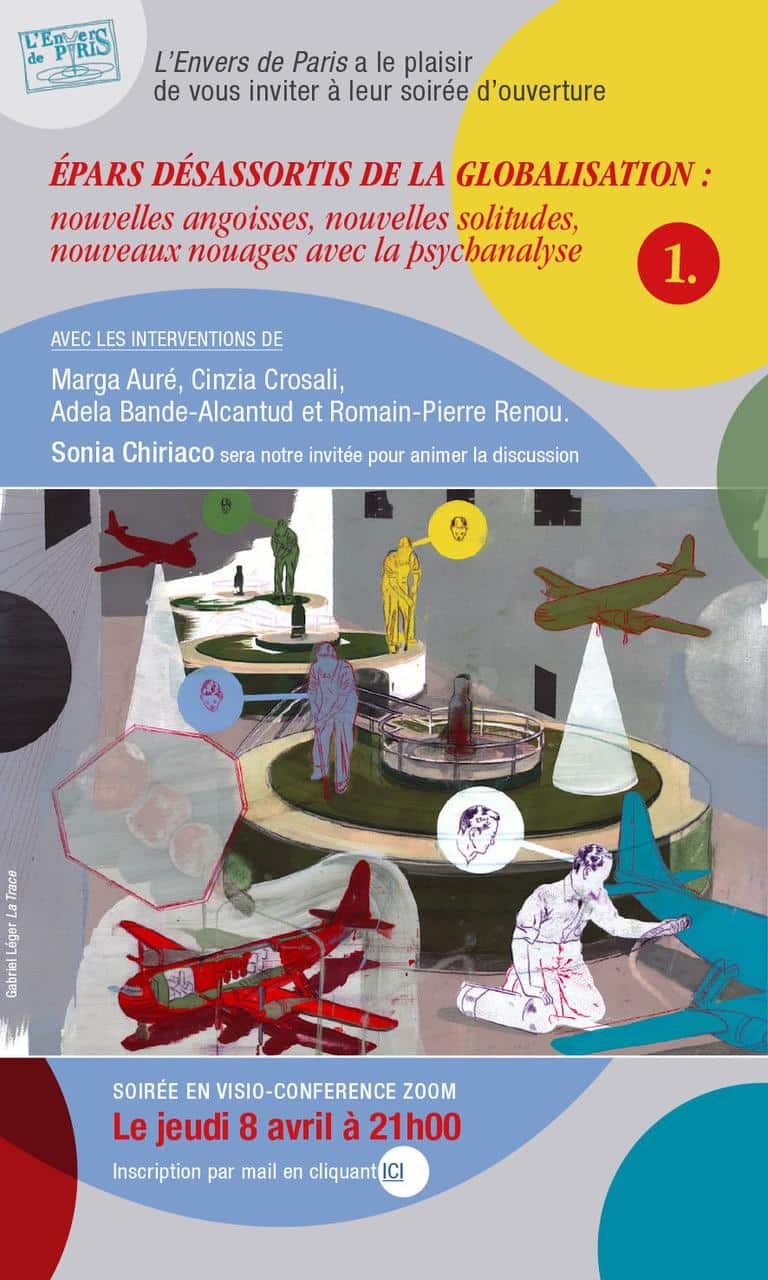Je souhaite revenir plus en détail sur l’emploi non standard que fait Lacan du terme « épars » dans cette formule d’« épars désassortis » que nous avons retenue pour notre titre.
Mais avant cela, quelques petits rappels sur un des derniers écrits de Lacan dont cette formule est tirée, soit la « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI » qui date de 1977. Dans son cours du 6 décembre 2006 consacré au « tout dernier enseignement de Lacan »[i], Jacques-Alain Miller précise que ce texte appartient bien à cette période du tout dernier enseignement de Lacan qu’il fait débuter très exactement au chapitre IX du Séminaire XXIII intitulé : « De l’inconscient au réel » (prononcé le 13 avril 1976) ; chapitre que J.-A. Miller considère comme une introduction à cette « Préface », puisque Lacan, dit-il, y « tire la leçon de son Séminaire du Sinthome et en même temps il l’ouvre sur une partie restée obscure », car « il n’a pas consacré ensuite d’écrit à cette ultime élucubration ». J.-A. Miller parle « de bascule ou d’un tournant historique dans l’enseignement de Lacan » qui élabore une théorie de l’inconscient non plus à partir de l’hystérie et de l’histoire, mais bien plutôt à partir de la psychose et de l’hallucination comme manifestation erratique et coupé de l’Autre. C’est dans cet ultime écrit que Lacan avance, dans une incise, que l’inconscient pourrait être réel[ii] : « l’inconscient, (qui n’est pas ce qu’on croit, je dis : l’inconscient, soit réel, qu’à m’en croire) »[iii]. La suite de cet écrit tire en quelque sorte toutes les conséquences de cette avancée dans l’enseignement de Lacan en ce qui concerne la pratique de la psychanalyse, sa transmission, et la passe.
J.-A. Miller, dans le commentaire qu’il en fait, propose de le renommer « plus familièrement » des tous premiers mots qui l’introduisent : « l’esp d’un laps », comme un possible nom de l’inconscient réel[iv]. Ce terme de « laps »[v] est celui retenu par J.-A. Miller pour intituler son cours de 1999-2000, « Les us du laps ». Il expliquait alors avoir rencontré ce terme sous la plume d’André Gide, « un maître de l’usage contemporain de la langue », dans son article de 1910, « Baudelaire et M. Faguet »[vi], en réponse à un texte où M. Faguet (contemporain de Baudelaire) critiquant la parution des Fleurs du mal écrivait que Baudelaire est un « très mauvais écrivain » et que « sa langue abonde en impropriétés, en gaucheries, en lourdeur, et en platitude ». Ce à quoi répond Gide que « cet espacement, ce laps entre l’image et l’idée, entre le mot et la chose est précisément le lieu que l’émotion poétique va pouvoir habiter »[vii].
Ceci nous ramène de plain-pied à cette formule « des épars désassortis » qui n’est pas sans résonnances poétiques dans sa sonorité et l’usage non conventionnel que Lacan en fait.
En effet, le dictionnaire nous apprend que ce terme d’épars est un adjectif, alors que dans une première lecture de l’usage qu’en fait Lacan, nous pouvons le lire comme en place de nom commun. Il s’agirait alors de la forme substantivée de l’adjectif « épars », soit d’accorder une certaine substance signifiante à ce terme : il existerait un ou des épars ; épars qui seraient, de plus, « désassortis ».
En tenant compte d’un autre aspect qui tient à la particularité du texte d’où est tirée cette formule, une autre piste de lecture se présente à nous. Comme le titre de cet écrit l’indique, « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », il est rédigé à l’attention de lecteurs de langue anglaise. Nous pouvons faire l’hypothèse que dans cette expression Lacan use de la forme syntaxique anglaise qui a coutume de placer l’adjectif avant le nom qu’il qualifie. La formule française plus classique serait donc renversée, soit « des désassortis épars », « épars » retrouvant sa fonction d’adjectif pour exprimer la qualité des « désassortis ». Mais si l’on vérifie cette hypothèse en allant voir du côté de la traduction anglaise, celle-ci s’écroule, car, que ce soit la première traduction qui en a été faite pour la publication en anglais des Quatre concepts en 1977, ou que ce soit celle plus récente (2018) parue dans Hurly-Burly, le choix a été fait de traduire « épars » par un terme anglais qui est également un nom commun[viii].
Après ce détour par ces traductions anglaises qui confirmerait l’usage substantivé d’« épars »[ix], il nous apparaît qu’une autre lecture peut être faite et considérer que nous sommes finalement bien là en présence de deux adjectifs qui se rapportent de façon elliptique à un nom qui n’est pas explicitement mentionné, mais simplement évoqué dans la première partie de la phrase, soient ceux qui tentent « la mise à l’épreuve de l’hystorisation de l’analyse » par ce dispositif que Lacan dit « désigné de la passe ». Nous pouvons donc en déduire que ceux que Lacan qualifie ici d’« épars désassortis » sont avant tout ceux que se frottent à cette mise à l’épreuve.
De cette brève analyse grammaticale, nous pouvons pointer le soin que prend Lacan pour élider, en ne les nommant pas précisément, ceux qui sont dits « épars désassortis ». Si l’on rapporte ces termes à ce qui précède cette formule dans cet écrit de Lacan, ceux-là dont il est question se distinguent d’un Tout, d’une totalité englobante, puisque Lacan précise bien qu’« il n’y a pas de tous en l’occasion » : il s’agit donc de quelques-uns, des uns-tout-seuls. D’une certaine manière, Lacan fait la promotion ici de ce que produit de plus incomparable et d’inédit l’expérience analytique, des uns-tout-seuls épars désassortis[x]. En ce sens, les caractéristiques de « dispersé », « éparpillé », « difficile à cerner », « diffus » auxquelles renvoient le terme d’« épars » interrogent sur le lien auquel peut aboutir ces différents éléments épars, d’autant plus que ces caractéristiques sont renforcées par l’adjonction du qualificatif de « désassortis », soit ce qui ne va pas ensemble. Remarquons qu’une telle définition consonne avec celle que donne J.-A. Miller de la théorie des ensembles dans son cours du 23 mars 2011 : « on met ensemble des choses n’ayant entre elles strictement aucun rapport. Elles ne se ressemblent par aucune propriété, aucune forme, aucune donnée imaginaire, par aucune signification. Le seul point commun entre ces éléments est d’être des Uns et d’appartenir à tel ensemble marqué de telle lettre », mais qui « compte en plus l’ensemble vide […] comme un Un-en-plus »[xi].
C’est sous le trait de la singularité que le discours de la psychanalyse procède à la constitution d’un lien social inédit en se préservant de tout regroupement procédant d’identifications à un idéal ou mode de jouir.
A contrario, à l’orée de notre XXIe siècle, un produit culturel littéraire qui a rencontré un certain succès public et critique, adapté sur grand écran en 2006[xii], puis au théâtre en 2017[xiii], se réfère à un tout autre type d’épars désassortis. Publié en 1998, Les Particules élémentaires[xiv] du roman de Michel Houellebecq renvoient en partie à une société composée d’individus se sentant isolés, séparés les uns des autres et où « la tendance croissante des individus à se percevoir comme des particules isolées, soumises à la loi des chocs, agrégats provisoires de particules plus petites […] rend bien sûr inapplicable la moindre solution politique »[xv] selon les propres propos de l’auteur. Ce dernier imagine, comme destin pour la civilisation, une issue bio-technologique trans-humaniste mettant fin à la fois aux souffrances de l’humanité, et à l’humanité elle-même, supplantée par une nouvelle espèce « génétiquement modifiée, immortelle et stérile »[xvi].
Ce n’est pas la perspective que propose la psychanalyse. L’année précédant la publication de cet ouvrage, J.-A. Miller affirmait que ce séminaire – « L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique » fait avec Éric Laurent –, était un effort « de plonger le lien social analytique dans la société, c’est-à-dire de le resituer dans les bavardages communautaires de notre temps », allant en ce sens contre l’idée que « le lien social analytique est un refuge contre le malaise dans la civilisation » pour « faire pénétrer ce malaise dans la sphère préservée de la séance analytique elle-même »[xvii].
[i] Miller J.-A., L’orientation lacanienne. « Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 6 décembre 2006, inédit.
[ii] Cf. Miller J.-A., « L’Un est lettre », La Cause du désir, n°107, mars 2021, p. 22 : « C’est seulement dans un de ses derniers écrits, entre deux virgules, dans une parenthèse, que Lacan énonce qu’il se pourrait que l’inconscient soit réel. » (Cours du 16 mars 2011, « L’Un-tout-seul »)
[iii] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571.
[iv] Miller J.-A., L’orientation lacanienne. « Le tout dernier Lacan », op. cit.
[v] « Ça serait formidable qu’on arrive à toucher un petit peu à la langue française en redonnant vigueur à ce laps. » Miller J.-A., L’orientation lacanienne. « Les us du laps », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 8 décembre 1999, inédit.
[vi] Gide A., « Baudelaire et M. Faguet », La Nouvelle Revue Française, n°23, 1er novembre 1910.
[vii] Miller J.-A., L’orientation lacanienne. « Les us du laps », op. cit. : « Gide déplace le mot de laps qui, dans la langue, est normalement soudé au temps – on dit un laps de temps –, eh bien il prend laps et il l’introduit dans les connotations de l’espace ».
[viii] Individuals » – « personnes » pour la première traduction, ou « oddments » – « bizarreries, article dépareillé » pour la seconde. Toutes deux gardent la qualité d’adjectif pour le terme « désassortis » (« scattered » – « éparpillé » et/ou « ill-assorted » – « mal assorti ») :
« D’où j’ai désigné de la passe cette mise à l’épreuve de l’hystorisation de l’analyse, en me gardant, cette passe, de l’imposer à tous parce qu’il n’y a pas de tous en l’occasion, mais des épars désassortis. »
- « I have therefore designated as a “pass” that putting of the hystorization of the analysis to the test, while refraining from imposing this pass on all, because it is not a question, as it happens, of all, but of scattered, ill‐assorted individuals.» “Preface to the English edition of The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis”, The Seminar of Jacques Lacan, Book XI, pages vii‐ Alan Sheridan translation.
- « Hence, I designated the pass as putting the hystorization of analysis to the test, taking care not to impose it on one and all because, as it happens, there is no all but only ill‐assorted oddments.», « Preface to the English Edition of Seminar XI », The Lacanian Review. Hurly‐Burly‐ Issue 6, 2018, pages 22‐ Russell Grigg Translation.
[ix] Quelle substance signifiante pourrions-nous alors donner à ce terme à partir de la définition qu’en donne le dictionnaire (Le Robert) de cet adjectif « épars » ? Il est d’abord dit que c’est « le participe passé adjectivé de l’ancien français espadre “séparer, disperser, répandre” », lui-même étant un « verbe issu du latin spargere “répandre”, “parsemer” qui se rattache à une racine indoeuropéenne °spher– “éparpiller”, “semer” » et « employé depuis le XIIe siècle avec le sens de “répandu ici et là” […] spécialement usité à propos des cheveux en désordre » est-il précisé ; et plus tard, « en parlant de personnes » avec la signification « de “répartis et dispersés” ». Dans son emploi au singulier et appliqué à une personne, comme dans « un homme épars », il prend alors le sens de « qui va au hasard ».
[x] Cf. Miller J.-A., « L’Un est lettre », op. cit., (cours du 16 mars 2011), p. 23 : « Le sens se situe au niveau de la description, disons de la fonction en termes logiques, et le réel au niveau du il existe, où s’introduit cet x appelé variable. Le Sinn, la description, se résume logiquement dans la lettre F de la fonction. On décrit ses attributs que l’on applique à on ne sait quoi dont on marque la place en écrivant x entre parenthèses, F(x). Au-delà d’une possible variation, le terme variable signifie qu’on ne sait pas si quelque chose de réel vient à la place de ce trou. La constante est ce qui peut remplir ce trou. Dans tous les cas, ce ne sera qu’un signifiant, un exemplaire du signifiant Un. »
[xi] Miller J.-A., « L’Un est lettre », op. cit., (cours du 23 mars 2011), p. 32.
[xii] Elementarteilchen, film allemand réalisé par Oskar Roehler, 2006.
[xiii] Les Particules élémentaires, adaptation, mise en scène et scénographie de Julien Gosselin, théâtre de l’Odéon, 12 septembre – 1er octobre 2017.
[xiv] Houellebecq M., Les Particules élémentaires, Paris, Flammarion, 1998.
[xv] « Entretien avec Jean-Yves Jouannais et Christophe Duchatelet », in Houellebecq M., Interventions, Paris, Flammarion, 1998, p. 47. Cf. également le passage du roman de M. Houellebecq qui exprime le rapport qu’il établit entre ses personnages et la théorie quantique qui distingue les comportements corpusculaires et ondulatoires de certaines particules : « de même Bruno pouvait apparaître comme un individu, mais d’un autre point de vue il n’était que l’élément passif du déploiement d’un mouvement historique. Ses motivations, ses valeurs, ses désirs : rien de tout cela ne le distinguait, si peu que ce soit, de ses contemporains », Les Particules élémentaires, op. cit., p. 178.
[xvi] Wikipédia, « Les Particules élémentaires ». Et cf. M. Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 156 : « Contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira bien un jour ou l’autre par aboutir à sa dissociation totale d’avec le sexe, et à la reproduction de l’espèce humaine en laboratoire dans des conditions de sécurité et de fiabilité génétique totales. Disparition par conséquent des rapports familiaux, de la notion de paternité et de filiation. Élimination, grâce aux progrès pharmaceutiques, de la distinction entre les âges de la vie. »
[xvii] Miller J.-A. et Laurent É., L’orientation lacanienne. « L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 11 décembre 1996, inédit.