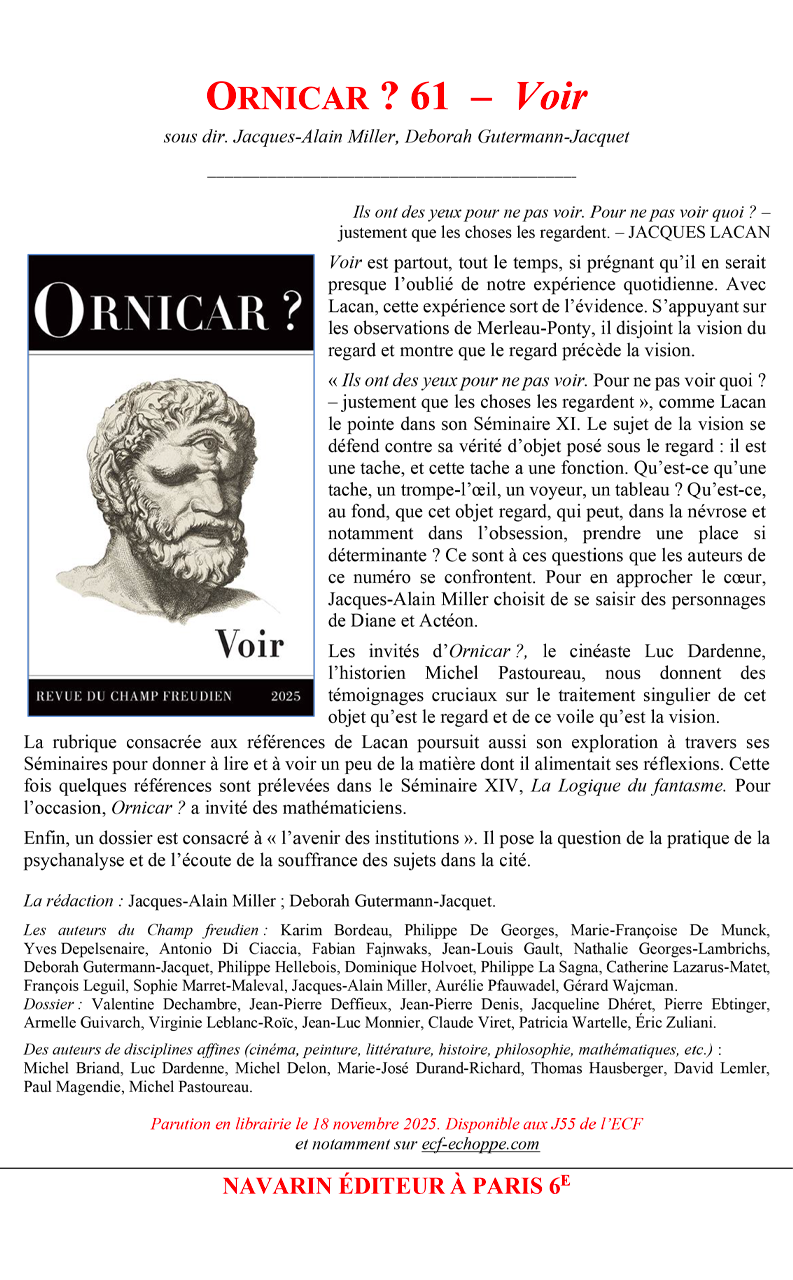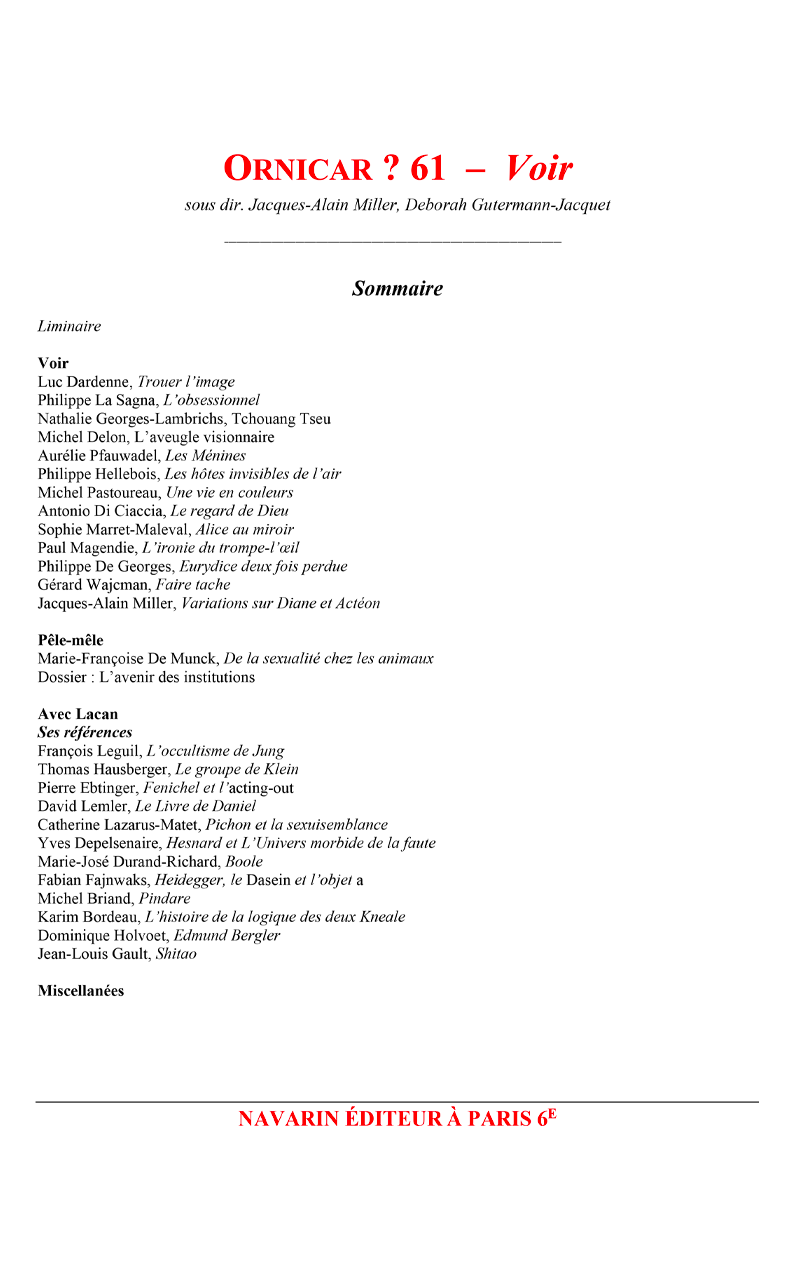Autonomie et morcellement du corps
Autonomie et morcellement du corps
par Florence Mendiondo
Au cours des années 1960, dans un contexte révolutionnaire marqué par de grandes luttes sociales, le féminisme s’est approprié la notion d’autonomie pour revendiquer le droit des femmes à disposer de leur corps. À cette époque, la fameuse devise « mon corps, mon choix » est devenue un cri de ralliement pour l’accès à la contraception et à l’avortement.
La lutte féministe portait alors sur la capacité des femmes à décider de leur propre destin, à s’émanciper de la domination masculine, et à prendre leur place dans un monde où leurs choix étaient souvent ignorés. La reconnaissance de l’autonomie des femmes impliquait une remise en question des structures patriarcales et de l’idée même d’autonomie masculine, souvent perçue comme l’aboutissement d’une autonomie construite sur l’invisibilisation du travail féminin. Ce questionnement a mis en lumière un aspect de celle-ci qui tendait à nier l’existence et la contribution de l’Autre.
Au fil du temps, la révolution collective pour la liberté s’est progressivement transformée en un impératif d’autonomie individuelle, notamment dans une époque où la technologie joue un rôle central dans la gestion des flux d’informations et des décisions personnelles. L’essor de l’intelligence artificielle a donné une nouvelle dimension à cette idée, introduisant une forme d’autonomie avec un Autre toujours prêt à nous fournir des réponses instantanées.
Dans cette ère technologique, l’autonomie n’est plus simplement un idéal social et politique, elle devient également un concept capitaliste qui traverse le champ scientifique. En biologie, la notion d’autonomie s’étend à un corps conçu comme une entité séparée du sujet. Un corps que l’on peut disséquer, analyser, et même modifier, afin de mieux le comprendre et éventuellement l’améliorer.
Cette vision morcelée du corps humain trouve un écho particulier dans le domaine de la bioéthique, où le droit à disposer de son corps, à intervenir dessus, semble désormais se justifier dans de multiples situations, y compris médicales et génétiques. La formule « mon corps, mon choix », autrefois liée à la liberté reproductive, s’étend aujourd’hui à cette logique de fragmentation du corps, mobilisée pour justifier des manipulations corporelles de plus en plus diversifiées.
Le transhumanisme en particulier, incarne cette évolution, exploitant les avancées en génétique et en bioéthique pour légitimer des pratiques telles que la sélection embryonnaire, une intervention qui, bien que légale dans certaines circonstances, évoque une conception du corps comme une machine à fragmenter et à perfectionner. « On peut d’une certaine façon dire bye-bye à ce qui a été la célébration de l’unité du corps, puisque ce qui est au contraire en marche, c’est son devenir morcelé, évidemment pour son plus grand bien. [1] »
L’idéal devient alors celui d’un corps morcelé, où chaque partie gagne une forme d’autonomie, pour finalement donner un modèle imaginaire du Un.
Si la psychanalyse s’intéresse à la vie, c’est en tant que le corps est affecté de la jouissance. C’est ce que Jacques-Alain Miller, a appelé la biologie lacanienne, « la reprise de la symptomatologie à partir des évènements de corps [2] ».
Pour la psychanalyse, le corps du parlêtre est aussi un corps touché, morcelé parce que c’est un corps affecté par le signifiant, marqué par la langue. La biologie lacanienne conçoit le corps, comme un corps vivant, non pas réduit à ses fonctions biologiques, mais pris dans la dimension de la jouissance. En revanche, pour Lacan, c’est le signifiant qui cause la jouissance, dimension que la biologie et la génétique, ne prennent pas en compte.
[1] Miller J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, no 44, février 2000, p. 11.
[2] Ibid., p. 13.