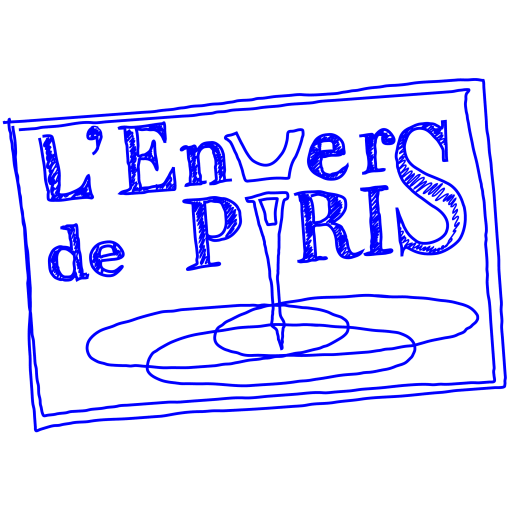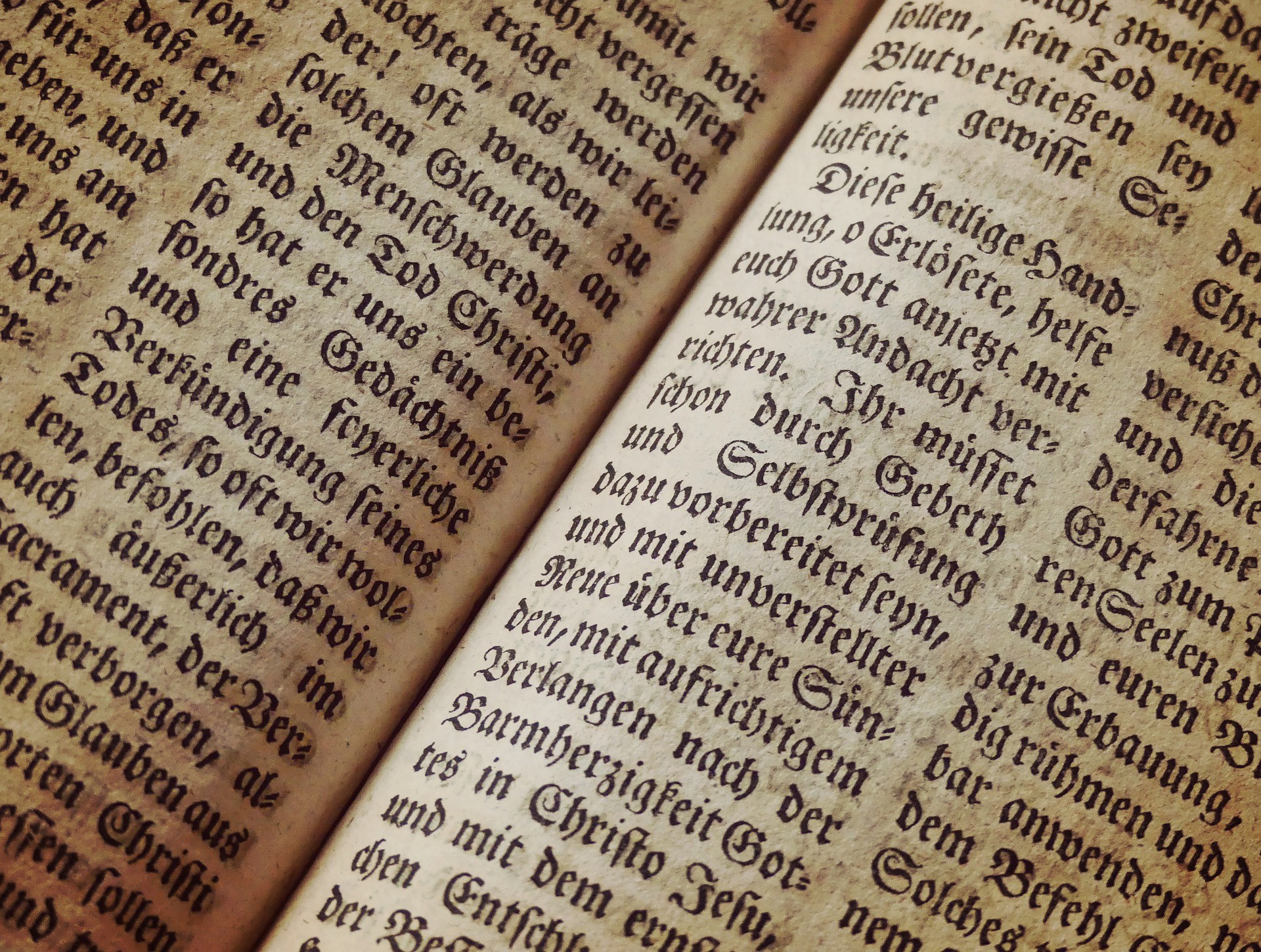ÉDITO AVRIL 2021
ÉDITO AVRIL 2021
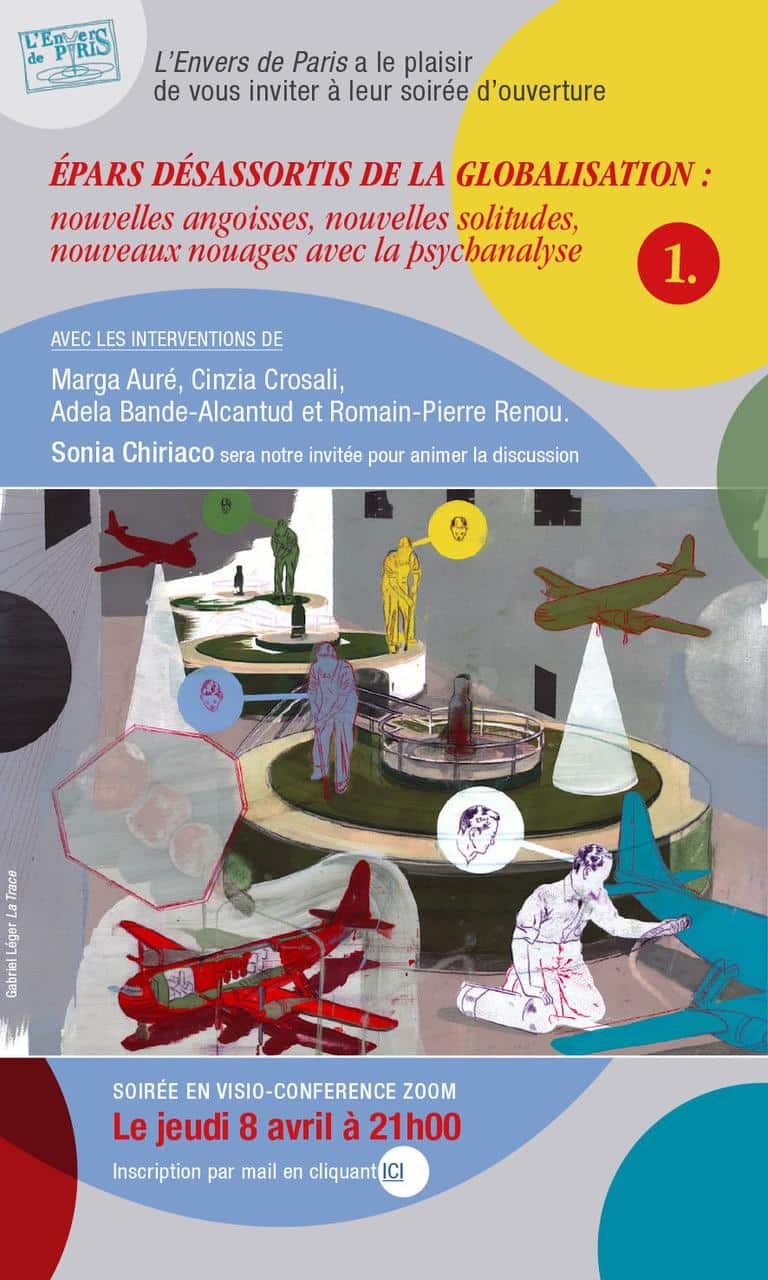
Chères et chers membres et amis de L’Envers de Paris,
Nous étions très nombreux connectés par Zoom pour participer à notre Assemblée générale ordinaire du 24 mars dernier. 79 membres ont assisté à une conversation animée dans laquelle nous avons constaté à quel point L’Envers de Paris avait trouvé en 2020 son élan dans l’affirmation d’un lien d’étude, entre ses membres et amis. Malgré les confinements successifs, les couvre-feux et la prolongation de la pandémie, ce lien de travail et de transmission de la psychanalyse a pu se poursuivre dans la plupart de nos groupes.
Le bureau de L’Envers a souhaité créer un réseau d’élaboration transversal pour notre association avec un thème d’étude commun. Une fois écarté le projet d’organisation d’une journée de L’Envers de Paris en juin prochain, nous avons programmé une série de soirées Zoom en 2021 sur le thème : Épars désassortis de la globalisation : nouvelles angoisses, nouvelles solitudes, nouveaux nouages avec la psychanalyse. Le 8 avril prochain nous tiendrons la soirée d’ouverture et nous aurons le plaisir de travailler avec Sonia Chiriaco qui conduira le débat avec les présentations d’Adela Bande-Alcantud, Cinzia Crosali, Romain-Pierre Renou et moi-même. La deuxième soirée est prévue le jeudi 24 juin, organisée par le Vecteur Lectures cliniques. Laurent Dupont sera notre invité pour orienter le débat et la conversation. D’autres rencontres sur ce thème sont aussi prévues pour le deuxième semestre.
Le Seminario Latino de L’Envers de Paris prévoit une rencontre sur le « racisme » en septembre : Marie-Hélène Brousse sera notre invitée. Puis, probablement, une soirée inter-cartel. Avec ces rencontres, nous tirerons les conséquences de la lecture subversive que la psychanalyse lacanienne permet des nouvelles formes de lien social et des nouages inédits qu’elle propose à la pointe de la contemporanéité.
Un nouveau projet est en cours d’organisation, propulsé par Nathalie Georges-Lambrichs avec une rencontre entre Francesca Biagi-Chai et Patricia Janody. Elles sont toutes deux psychanalystes et psychiatres, avec un long parcours, et désireuses de nous transmettre leur expérience. Notez déjà dans vos agendas la date de cette soirée qui aura lieu le jeudi 10 juin. Nous vous donnerons plus d’information dans le prochain courrier.
Comme déjà annoncé dans l’édito de février, Thérese Petitpierre nous donne des nouvelles du Séminaire Les enfants de la science qui participe à la préparation du Congrès PIPOL 10. Vous trouverez dans notre site l’affiche qui en annonce le thème « Lorsque le désir d’enfant rencontre la science », l’argument, les noms et qualités des intervenants ainsi que les institutions partenaires. Une date vous sera communiquée dès que possible. C’est à partir de leur expérience clinique que François Ansermet et Nouria Gründler interrogeront ces six intervenants, tous enseignants-chercheurs, sur ce monde en mutation qui s’invente à travers les biotechnologies. Comment les contours s’en dessinent-ils aujourd’hui ? Comment l’avenir à plus ou moins long terme s’esquisse-t-il ? Comment les fantasmes des sujets ayant recours à la science pour traiter tel ou tel obstacle sur la voie de leur désir d’enfant rencontrent-ils ou vont-ils rencontrer les possibles qui leur sont/seront proposés ? À quels impossibles ces sujets vont-ils se trouver confrontés ? Quelles inconnues ? À quel réel ? C’est d’abord sous la forme de courtes vidéos que la conversation s’engagera. Le Webinaire Les enfants de la science sera un temps d’approfondissement de ces questions.
Et voici les propositions des rencontres de nos groupes et Vecteurs en avril ouvertes à ceux qui voudront se mettre à l’étude de la psychanalyse :
Le Vecteur Psynéma annonce que la fin du cycle 2020-2021, année marquée par la Covid-19 mais dont les réunions ont été maintenues via Zoom à un rythme soutenu. Une des quatre projections prévues a pu se réaliser en salle par un travail rigoureux et un excellent débat enchanté par le plaisir de se retrouver ensemble. Deux articles ont étés produits : l’un dans le n° 65 de la publication Horizon et l’autre sur le site de L’Envers de Paris. Le vecteur tiendra sa prochaine réunion le 11 avril à 20h00. Nous commencerons notre chemin par une lecture du film The Big Lebowski des frères Coen sorti en 1998. Excellent film à bien des égards, très joycien dans son esprit. Nous ferons le choix des films pour le prochain cycle 2021-2022 ainsi que pour la première projection-débat orientée par le thème des 51e Journées de l’ECF : « La norme mâle ». La lecture du Séminaire XXI de Lacan « Les non-dupes errent » orientera notre travail. Contact :Maria-Luisa Alkorta par mail>> ou Karim Bordeau par mail>>
Le Vecteur Le corps, pas sans la psychanalyse engage sa réflexion sur le thème : « Du corps pulsionnel en pandémie ». Nous sommes repartis du signifiant d’Antigone (Séminaire VII) qui connecte les questions de la Loi dans la Cité, du Désir (« ne pas céder sur… ») et de la Jouissance, liées aux pulsions de vie et de mort. Comment le cas d’Antigone peut-il résonner au temps présent, pour mettre en rapport, autour du Corps, la Pulsion, la Violence et la Transgression ? Prochaine visioréunion le mercredi 14 Avril à 20h30. Contact : Geneviève Mordant par mail>>
Le Collectif Théâtre et psychanalyse se réunira par Zoom le 22 avril pour revenir sur la rencontre Fanny et Alexandre et discuter de la nouvelle pièce pour laquelle nous proposerons bientôt une nouvelle rencontre. Contact : Philippe Benichou par mail>>
Le Seminario Latino aura sa 4ème soirée, cette fois-ci se déroulant en français, autour du thème « Un monde sans dehors : affects et effets du malaise contemporain », le jeudi 15 avril à 21h00 par Zoom. Nous aurons le plaisir de recevoir à Pascale Fari en tant qu’extime de cette soirée qui comptera sur la participation de Juan Aliotti, Francesco Bernardi, Juan Rodriguez et Ana Inés Vasquez. La soirée sera animée par Patrick Almeida et Adriana Campos. Inscription : cliquez ici>>
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre le webinaire.
Le Vecteur Psychanalyse et littérature se réunira par Zoom le Jeudi 22 avril à 20h00. Nous continuerons à déplier et à approfondir comment l’écriture littéraire de Nathalie Sarraute subvertit le Discours Capitaliste lié au Discours de la Science qui impose des objets plus-de-jouir de masse en toc. Par son savoir-faire apparaît la sonorité de la Lettre dans la chaîne discursive de son écriture, non seulement elle traite par la Lettre sa propre jouissance de corps a-normale, irréductible et incollectivisable, mais aussi elle la fait entendre, au-delà du sens, dans les équivoques de sa langue écrite. Son art littéraire fait sa place et donne forme à son Dire symptomatique qui n’est pas à comprendre mais dont on peut rire. Le texte « Taka l’Dire. Quand l’écriture résonne » sera notre appui et l’écrit de Lacan « Lituraterre » notre boussole. Contact : Marie-Christine Baillehache par mail>> ou par téléphone : 06 42 23 37 03.
Le Vecteur Lectures cliniques continue d’organiser des réunions mensuelles par Zoom et poursuit son travail. Nous expérimentons ainsi ces nouvelles modalités d’échange et de discussion. Comme les fois précédentes, la séance s’ouvrira avec un « flash » proposé par un membre de la commission d’organisation sur le texte « Intuitions milanaises » de J.-A. Miller (Mental, n° 11&12). Nous poursuivons la lecture de l’ouvrage de J.-A. Miller, L’os d’une cure (Navarin, 2018) : deux participants exposeront leur lecture de la troisième partie. La deuxième partie de la séance sera consacrée à la présentation, suivie d’une discussion d’un cas clinique par une autre participante. Contact : Adela Bande-Alcantud par mail>> ; et Pascale Fari par mail>>
Le Vecteur Lectures freudiennes, nous informe en contact avec Mme Elise Wiener-Kral, responsable aux éditions Eres de la collection Scripta, pour la relecture de nos traductions des trois derniers textes de Freud : « Constructions dans l’analyse », « Analyse finie et analyse infinie », « La division du Ich dans les processus de défense ». Une publication en version bilingue est prévue pour le second semestre 2021. Par ailleurs nous avons entrepris une première relecture de notre traduction de l’article de Freud de 1915 « Complément métapsychologie à la doctrine du rêve ». Pour nous contacter : 06 47 13 89 91.
Voilà donc tout ce programme de travail ouvert à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’étude de la psychanalyse.
A très bientôt,
Marga Auré